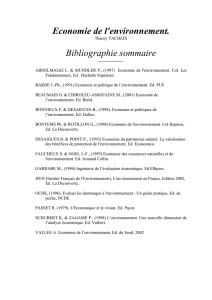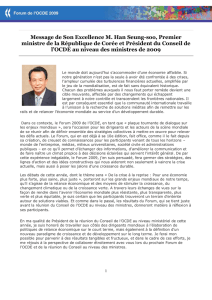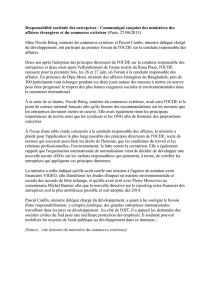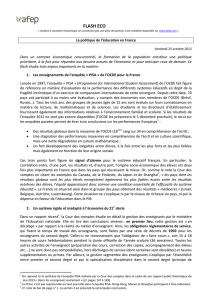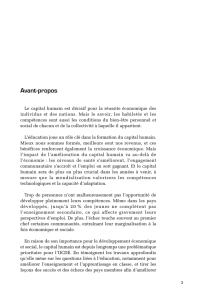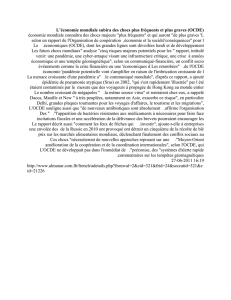Le nouvel ordre éducatif mondial - Institut de Recherches de la FSU

1
Le nouvel ordre éducatif mondial
OMC, Banque mondiale, OCDE, Commission européenne
Christian Laval et Louis Weber (coordination)
Yves Baunay, Roser Cusso, Guy Dreux, Daniel Rallet

2
Table des matières
Introduction
1)L’OMC!: Vers un marché mondial de l’éducation
2)La Banque mondiale!: Le marché scolaire à l'assaut de la pauvreté ?
3)L’OCDE!:La boîte à idées du nouvel ordre éducatif mondial
4)La Commission européenne!: Une politique de l’éducation sous influence
Conclusion

3
Introduction
La mondialisation concerne progressivement tous les aspects de la vie sociale, et en
particulier l’éducation scolaire. Certes, pour des raisons historiques profondes, on a pris
l’habitude de voir dans l’école une réalité essentiellement nationale, parfois même l’un des
socles de l’identité nationale. Nombre de phénomènes obligent pourtant à reconsidérer notre
perception. Il faut désormais prendre en compte les moyens et les tendances qui font entrer les
systèmes scolaires et éducatifs dans la voie de la mondialisation. Formes, contenus, objectifs,
significations des institutions scolaires et éducatives en sont déjà ou peuvent en être changés.
Tous les changements que nous allons examiner dans cet ouvrage ne sont pas négatifs, loin de
là. N’y a-t-il pas dans l’éducation une dimension universelle dont longtemps les humanistes,
les philosophes et les utopistes ont espéré l’avènement dans les âges futurs!? Tous les
phénomènes que l’on relie à la mondialisation de l’éducation ne sont pas nouveaux non plus.
Les mouvements de population, les grandes conquêtes, qu’elles soient venues d’Orient ou
d’Occident, ont généralement visé à créer des situations de domination. Ils ont eu en même
temps pour effet d’exporter des connaissances, des valeurs, des religions hors des espaces où
elles avaient pris naissance. Dans la période récente, l’industrialisation et la colonisation ont
ainsi joué un grand rôle dans l’échange et la transformation des cultures.
L’actuelle phase de mondialisation qui touche l’école a cependant des aspects très particuliers
qui méritent d’être soulignés. Elle se caractérise par la domination d’un nouveau modèle
d’éducation inspiré par une logique économique de type libéral et par la construction d’un
nouvel ordre éducatif mondial. Les gouvernements occidentaux, les élites économiques, les
grandes entreprises de communication, les dirigeants des grandes organisations économiques
internationales proposent dans tous les grands forums mondiaux un certain modèle scolaire
conforme aux règles du libre commerce, aux stratégies des grandes entreprises
multinationales et à l’idéologie qui les sous-tendent. Niant que leurs «!conseils!», leurs
«!rapports!» et leurs «!analyses comparatives!» aient la moindre portée normative et
prescriptive, affirmant qu’elles agissent dans le respect de la démocratie, les institutions
financières et économiques les plus puissantes voudraient aujourd’hui apparaître comme les
porte-parole d’une rationalité universelle. En réalité, le modèle éducatif tel qu’il est conçu
répond aux logiques de la globalisation : l’éducation est regardée de façon réductrice comme

4
un facteur de production conditionnant la productivité, la capacité d’attirer les capitaux, la
compétitivité et l’emploi. En réduire les coûts quand ils sont assurés par la dépense publique,
introduire les mécanismes et les valeurs du marché et privilégier les objectifs économiques de
la formation sont les axes complémentaires de la réforme de l’éducation prônée par les
gardiens de l’orthodoxie.
Le rôle décisif des organisations internationales
Cette mondialisation libérale de l’éducation touche inégalement les degrés d’enseignement et
les pays. Elle passe par des voies diverses et d’abord par toutes les formes de commerce par
lesquelles la formation peut prendre le caractère de marchandise : vente de « produits
éducatifs!», circulation dans le monde des étudiants qui peuvent payer, création de filiales
universitaires à l’étranger, essor du e-learning, etc. La constitution d’un marché mondial de
l’éducation, même s’il a commencé de tenir salon à Vancouver, trouve cependant ses limites,
du moins pour l’instant, dans le fait que les services éducatifs restent dans de nombreux pays
majoritairement publics et nationaux. C’est bien l’enjeu du processus de libéralisation
générale des services engagé par l’Organisation mondiale du commerce avec l’Accord
général sur le commerce des services (AGCS). Mais cette mondialisation passe également de
plus en plus par des voies symboliques et politiques dans lesquelles les organisations
internationales telles que l’OCDE, la Banque mondiale ou la Commission européenne, jouent
souvent un rôle majeur. Elles n’ont pas en effet seulement un rôle de contrôle, d’évaluation,
de prescription ou de financement dans le domaine économique et financier. Elles déploient
depuis déjà longtemps un véritable travail symbolique portant sur toutes les dimensions de la
représentation de la société. L’homogénéisation des concepts, la construction d’évaluations
communes, la fixation d’objectifs semblables participent de cette unification du modèle. Dans
le domaine éducatif, les conséquences de cette représentation commencent à se faire sentir.
Loin des usagers locaux et des professionnels de l’école, qui ignorent souvent la source des
«!évidences!» qui leur sont imposées, en dehors des cadres institués de la démocratie, les
gouvernements nationaux se font volontiers le relais de ces élaborations et contribuent ainsi à
la constitution progressive d’un modèle unifié d’éducation à l’échelle mondiale.
Certes, on objectera avec raison que ces organisations internationales restent l’émanation des
gouvernements qui y participent. A quoi on peut répondre que les gouvernements,
profondément en accord avec la pente générale de la mondialisation économique et
financière, préfèrent déléguer à ces mêmes organisations le soin de définir les «!priorités!» et

5
les «!impératifs!» auxquels doivent s’ordonner des réformes présentées comme
«!incontournables!» et «!indiscutables!». Cette délégation, outre qu’elle contourne les
organisations syndicales et interdit le débat démocratique, permet de légitimer les réformes
d’inspiration libérale par l’obligation de faire «!comme ailleurs!» et «!comme les autres!» pour
rester «!compétitifs!», «!performants!», «!efficaces!», etc. Ce travail de légitimation n’est pas
sans argumentation intellectuelle, sans procédures très concrètes d’influence (dont
l’évaluation, l’expertise et la comparaison internationale), ni sans moyens financiers
également comme le montre suffisamment l’action de la Banque mondiale dans les pays en
voie de développement. On comprend alors mieux l’importance de l’analyse des mécanismes
d’imposition du nouveau modèle éducatif et de la déconstruction des idéologies qui la sous-
tendent.
Une réforme utilitariste
La conception dominante de l’éducation dans les organisations internationales est à la fois
libérale et utilitariste. Précisons ces aspects à la fois distincts et complémentaires. Elle est
libérale par la place centrale qu’elle fait au marché comme type d’organisation du système
éducatif à construire, et plus généralement comme modèle à imiter par l’école. Cette
conception est libérale quand, par exemple, elle conçoit les rapports éducatifs comme la
rencontre entre une «!offre!» et une «!demande!», quand elle invite à introduire des
mécanismes marchands dans la production et l’échange de «!produits éducatifs!», quand elle
transforme l’établissement scolaire en une entreprise agissant sur un marché concurrentiel.
Mais cette conception est aussi utilitariste. L’utilitarisme, qui est à la fois une doctrine
philosophique née au XVIIIe siècle et un état d’esprit très répandu dans les sociétés
occidentales modernes, considère que l’individu poursuit, et doit poursuivre, son intérêt
personnel en toutes choses!; que les institutions sociales, et les contraintes qui les
accompagnent, n’ont de justification que par l’utilité qu’elles ont pour l’individu qui y est
soumis. L’utilitarisme, sans se réduire au domaine économique, y trouve cependant un terrain
de prédilection. Une institution est d’abord un outil qui sert un intérêt individuel ou une
somme d’intérêts individuels. L’école, dans cette optique, n’a pas d’autre fin que de doter les
individus de connaissances ou de compétences qui leur permettront d’accéder à des positions
sociales et de recevoir des revenus plus ou moins élevés. A la limite, et on verra que cette
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
1
/
121
100%