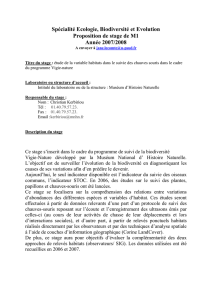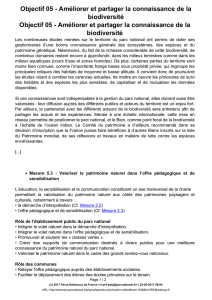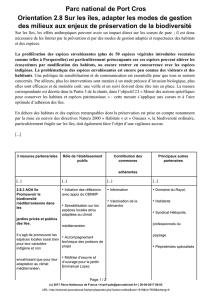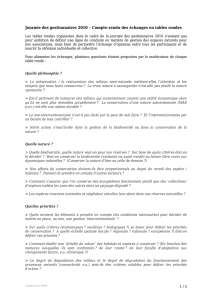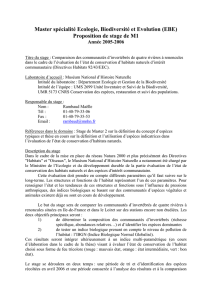Session 1 La biodiversité des habitats littoraux : histoire et évolution

« La biodiversité du littoral » organisé par 3B Conseils
13 et 14 oct. 2006 Océanopolis - Brest
10èmes entretiens Science et Ethique ou le devoir de parole « La biodiversité du littoral »
Session 1 : La biodiversité des habitats littoraux : histoire et évolution – 13 octobre 2006
1/3
Mots clés : habitats, biodiversité, espèce, Bretagne, maërl, écosystème, endémisme,
Erika, pollution, Rade de Brest, espèce invasive
Session 1
La biodiversité des habitats littoraux : histoire et évolution
A visionner sur la TV Web Canal U http://www.science-ethique.org/
Intervenant : Jacques Grall
Biologiste marin, Observatoire du Domaine Côtier, IUEM-OSU-UBO.
Laurent Chauvaud s’est exprimé sur la biodiversité fonctionnelle, sur laquelle j’ai également
travaillé, et je vais insister sur les habitats et de leur biodiversité.
Ce dessin réalisé par Michel Salaün d’Océanopolis, remarquable naturaliste et dessinateur
hors pair, qui vous montre la richesse que peut représenter un habitat particulier, ici un
champ de blocs intertidal avec des ascidies, éponges, crustacés et échinodermes. C’est
d’abord ça la biodiversité.
Quant aux habitats en Bretagne, nous avons de la chance d’en avoir beaucoup. La carte
d’Iwan Le Berre, géographe de l’IUEM, vous montre la mosaïque d’habitats, tous les types
d’habitats qui peuvent être représentés, qui vont des zones vaseuses dans le fond de
l’estuaire jusqu’aux zones de cailloutis des fonds très durs de la mer d’Iroise. C’est un
gradient d’habitats différents qui sont représentés ici dans l’Ouest de la Bretagne. En se
plaçant sur la côte d’Aquitaine, c’est 2 ou 3 habitats qui seraient représentés puisqu’on a des
côtes de sable fin qui sont relativement riches mais la diversité des habitats y est très faible.
Si on regarde la biodiversité en terme de nombre d’espèces en Bretagne, il faut considérer
les différents habitats. Dans le cas des sables dunaires, ce sont des sables déplacés par les
courants ou par la marée qui sont très mobiles. On a des plages de sable fin, que vous
connaissez, et les vases. Ce sont tous des sédiments homométriques, une seule taille de
grains de sable. La diversité, en nombre d’espèces, est relativement faible. Dans les sables
dunaires, on a environ 15 espèces, sur les plages de sable fin environ 35 et dans la vase
environ 100. Il faut ici comparer avec des habitats beaucoup plus complexes et hétérogènes,
comme les champs de blocs intertidaux, des cailloux entassés les uns sur les autres, les
herbiers et un banc de maërl. Ces habitats les plus complexes hébergent plus d’espèces que
les habitats moins complexes et moins hétérogènes. Alors, est-ce qu’il faut plutôt s’intéresser
à ces habitats complexes qu’aux habitats simples ? C’est la question que l’on peut se poser.
Si l’on s’intéresse à l’endémisme ou aux espèces qui ne sont représentées que dans un type
d’habitats, on a pratiquement 100% des espèces, dans les sables dunaires, qui leur sont
uniques. Elles ne vivent que là, sur les plages de sable fin. Il y a aussi un fort taux
d’endémisme dans les vases. Par contre, dans les herbiers de zostères ou dans les bancs
de maërl, il y a très peu d’espèces qui ne sont que là. Dans cette biodiversité, il y a un
turnover d’espèces, et il ne faut donc pas simplement s’intéresser aux habitats complexes,
effectivement très riches en espèces, mais aussi aux habitats qui ont une biodiversité
intrinsèque avec peu d’espèces certes, mais très originales qu’il ne faut surtout pas oublier.
Faut-il hiérarchiser les habitats en terme de nombre d’espèces ou pas ? Un banc de maërl

10èmes entretiens Science et Ethique ou le devoir de parole « La biodiversité du littoral »
Session 1 : La biodiversité des habitats littoraux : histoire et évolution – 13 octobre 2006
2/3
grouille de vie et d’espèces. Il y a des éponges, des vers, des mollusques, … Dans un sable
dunaire, rien n’est apparent. Est-ce qu’il faut hiérarchiser ces habitats ? En terme de
fonctionnement, naturellement Michel Glémarec et moi-même nous sommes intéressés au
banc de maërl – parce que, c’est ce que disait Laurent Chauvaud tout à l’heure, il y a
quelque chose d’affectif, on voit que c’est riche, on est plutôt attiré par le nombre d’espèces,
par les couleurs. On a réussi à montrer que les bancs de maërl pouvaient avoir un rôle
important, en particulier dans les écosystèmes côtiers comme la Rade de Brest. Mais si on
s’était intéressé aux sables dunaires, on ne sait pas ce qu’on aurait trouvé. Il faut peut-être
faire attention à ce côté affectif et ne pas toujours aller dans cette direction.
Abordons un autre côté affectif, l’impact des marées noires sur la biodiversité. Sur les photos
de Belle-Île après l’Erika, on voit le pétrole à la côte, c’est dramatique, on s’interroge
« qu’est-ce qu’il va se passer ? la biodiversité va vraiment être « bousillée » par tout ça ». Au
cours d’une étude réalisée avec la SEPNB de Vannes et un bureau d’études, on s’est
intéressé à une vingtaine de stations dans le Morbihan, principalement sur les îles du
Morbihan. On a fait des cartes des habitats, réalisé des échantillonnages, inventorié la
macrofaune sur tout l’estran, sur toutes les îles et essayé de voir s’il y avait une différence
entre les sites impactés, qui sont en rouge, et les sites non impactés, ici en jaune. Y avait-il
une différence de biodiversité en terme de nombre d’espèces ? Ce que montre notre étude,
c’est qu’à l’échelle du Morbihan, il n’y a pas eu d’impact de la marée noire sur la biodiversité.
En examinant la courbe d’accumulation des espèces en fonction du nombre d’échantillons,
ceux-ci sont environ 450, il n’y a pas de différences entre les deux types de milieux, impacté
ou non. L’Erika n’a donc pas eu d’impact sur la biodiversité. Par contre, si on examine ce qui
se passe au niveau des pollutions chroniques – on utilise ici un indice qui représente la
diversité : à la fois le nombre d’espèces total identifiés sur les stations étudiées mais
également le nombre d’espèces rares présentes et le nombre d’espèces qu’on pourrait
appeler « patrimoniales ». Cet indice varie de 12 à 0 et il y a une différence entre les milieux
insulaires vraiment séparés du continent et ceux du continent. A la sortie du Golfe du
Morbihan, les indices sont beaucoup plus faibles et c’est une pollution chronique qui dégrade
les écosystèmes littoraux plutôt que les pollutions accidentelles. Les écosystèmes côtiers
sont sous l’influence d’agressions multiples, l’eutrophisation bien sûr aujourd’hui, mais il y a
énormément d’autres types d’agression : la pêche, le climat, les espèces invasives – Laurent
Chauvaud en a parlé tout à l’heure – les aménagements, l’aquaculture, la pollution
chronique.
Des naturalistes venus en Rade de Brest au cours du XIXème siècle, ont identifié quelques
espèces dont certaines étaient rares dans certains milieux. Avec la bibliographie, en
retournant sur les mêmes sites, on retrouve toujours les mêmes espèces rares. Ce sont des
mollusques, des tellines, des vers ou des crabes qui aujourd’hui, sont encore présents.
Donc, la biodiversité est résiliente dans la mesure où les habitats sont toujours présents.
L’exemple d’
Atrina fragilis
est assez caractéristique : je pense que la dernière fois qu’on l’a
identifiée vivante en Rade de Brest, nous l’avons trouvée, Laurent et moi, empalée sur une
drague de coquille Saint-Jacques. C’est la seule espèce de mollusques qui disparaît sous
l’effet destructeur des dragues en Rade. Quand les habitats ont disparu, les espèces ont
disparu. Le lien est donc extrêmement fort entre habitat et biodiversité. On peut parler
également de la nucelle, disparue de l’écosystème Rade de Brest du fait du TBT (tributyl-
etain) au cours des années 90, elle est en train de revenir aujourd’hui, mais sous une forme
résistante au TBT.
Il y a aussi un risque majeur pour la biodiversité : la fragmentation de l’habitat. Lucien
Laubier a parlé tout à l’heure des activités de l’Homme. Il y a les activités de loisirs,c’est
l’exemple de quelqu’un qui pêche dans un herbier de zostères. D’autres activités modifient
l’habitat, c’est l’exemple du passage d’une drague à coquille Saint-Jacques sur un banc de
maërl. C’est le cas des espèces invasives comme la crépidule, introduite en Rade de Brest

10èmes entretiens Science et Ethique ou le devoir de parole « La biodiversité du littoral »
Session 1 : La biodiversité des habitats littoraux : histoire et évolution – 13 octobre 2006
3/3
dans les années sa distribution n’a fait que progresser depuis. Tout cela fragmente les
habitats et on sait que les habitats fragmentés sont beaucoup moins résistants aux
perturbations que les habitats qui sont en continuité. Dans un habitat non fragmenté, après
une perturbation, les espèces se réfugient dans des coins où elles ne seront pas trop
atteintes et elles vont pouvoir recoloniser l’habitat dans son ensemble avant la prochaine
perturbation. Dans le cas d’un habitat fragmenté, les perturbations ne laissent les espèces
que dans certains endroits et à la perturbation suivante, elles auront complètement disparu
de l’écosystème.
Je voudrais rebondir sur ce que disait Lucien Laubier tout à l’heure sur la zoologie
aujourd’hui déconsidérée. Un biologiste anglais célèbre, Geoff Moore, qui fait un peu le
même travail que nous, va dans le même sens. Quand il fait des conférences sur la
biodiversité, il ne parle pas des espèces mais des chercheurs en disant qu’il y a une crise
bien connue sur la biodiversité, c’est la disparition des espèces mais l’autre crise, c’est la
disparition des gens qui savent l’étudier et la connaître.
Entretiens Science et Ethique 2006 La biodiversité du Littoral
Président du Comité scientifique des Entretiens Lucien LAUBIER
Professeur émérite à l’université de la Méditerranée
www.science-ethique.org 13 et 14 octobre 06
pour en savoir + : Brigitte Bornemann-Blanc déléguée générale 3B Conseils
33 (0) 2 98 41 46 05 ou 33 (1) 40 51 83 87
1
/
3
100%