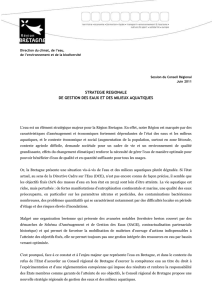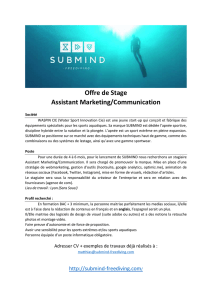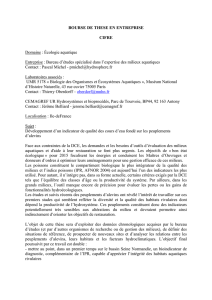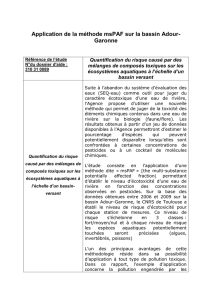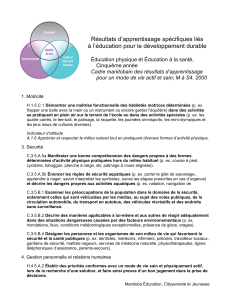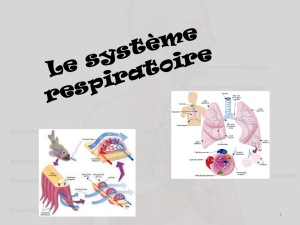en Biosurveillance des milieux aquatiques

1
Projet de Chaire Institutionnelle (Professeur) en Biosurveillance des
milieux aquatiques
Chaire Université Reims Champagne Ardenne - Institut National de l'Environnement
Industriel et des Risques
Court résumé grand public :
Les milieux aquatiques représentent l’exutoire final d’un grand nombre de contaminants émis
par les activités anthropiques. En même temps, l’importance des services rendus à la
société par les milieux aquatiques, aussi bien dans l’approvisionnement en énergie, en eau,
en nourriture, qu’en services culturels et aménités, impose aujourd’hui de les préserver ou
les restaurer, et par conséquent de disposer d’outils performants pour en évaluer et suivre
leur qualité. L’enjeu du projet est la mise en place, sur la base d’espèces représentatives de
nos hydrosystèmes, d’outils sensibles, précoces d’une dégradation de la qualité des masses
d’eau évitant ainsi i) les risques économiques pour les activités liées à ces masses d’eau,
ainsi que ii) les processus longs et coûteux d’une remédiation. Le projet a pour objectif
d’acquérir des connaissances qui contribueront à l’innovation et au transfert de nouveaux
outils d’évaluation des dangers des substances et de caractérisation de la qualité des milieux
aquatiques à des fins de diagnostic, d’évaluation du risque écotoxicologique et de
surveillance des milieux aquatiques. Le projet visera également à promouvoir l’utilisation de
ces outils dans un contexte réglementaire afin de guider les gestionnaires, les utilisateurs
des masses d’eau et les politiques publiques dans l’amélioration de la gestion du risque pour
l’homme et l’environnement vis-à-vis des utilisations des différentes masses d’eau.
Résumé du projet de Chaire :
L’environnement est une préoccupation importante pour la population française. Aussi,
l’impérative nécessité de protéger cet environnement afin que chacun puisse vivre dans un
écosystème sain s’est traduite par un accroissement des exigences réglementaires avec par
exemple la Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) et la Directive Cadre Stratégie pour le
Milieu Marin (2008/56/CE). Aujourd’hui, l’évaluation de la qualité des milieux aquatiques
passe par un suivi de l’état chimique et écologique des masses d’eau, incluant actuellement
diverses métriques biologiques basées sur les communautés et utilisant les invertébrés, les
poissons, les algues. La surveillance des populations et communautés autochtones
d’organismes aquatiques a constitué la principale démarche de l’évaluation des
écosystèmes. Ces mesures ont prouvé leur utilité pour évaluer le « bon état écologique »
des masses d’eau mais à ce stade, la dégradation est installée de longue date et la
remédiation devient extrêmement problématique. Sur la base de réponses biologiques
précoces, le projet vise, par une meilleure compréhension de l’impact des stress
anthropiques sur les organismes animaux, à l’identification de nouveaux outils d’évaluation
des dangers des substances (bioessais et biomarqueurs) et de caractérisation de la qualité
des milieux aquatiques (biosurveillance) à des fins de diagnostic, d’évaluation du risque
écotoxicologique et de surveillance des milieux aquatiques. Le projet se focalisera sur la
fonction de reproduction et sa régulation, apparaissant comme particulièrement pertinente

2
pour identifier des réponses prédictives d’effet toxique pour le maintien de l’individu voire de
sa population via sa descendance. A l’aide d’expérimentations in vitro/ex vivo, in vivo et in
situ, les travaux porteront sur trois axes : 1) Amélioration des connaissances de la
physiologie/écophysiologie de la reproduction des espèces modèles de l’unité et leur
modulation sous la pression des changements environnementaux ; 2) Identification et
caractérisation du potentiel de certaines réponses en tant que biomarqueurs ; 3) Définition
des conditions d’analyse de ces biomarqueurs dans un objectif de les utiliser en diagnostic et
surveillance des milieux.
L’ensemble des travaux visera d’une part à promouvoir l’utilisation de ces outils dans un
contexte réglementaire afin de guider les gestionnaires, les utilisateurs des masses d’eau et
les politiques publiques dans l’amélioration de la gestion du risque pour l’homme et
l’environnement vis-à-vis des utilisations des différentes masses d’eau et des services
écosystémiques rendus et ceci au travers d’une collaboration avec l’Agence de l’eau Seine
Normandie, Direction vallées de Marne. D’autre part, ce projet permettra de renforcer, sur la
base des liens étroits entre un institut (INERIS) et l’université de Reims, la formation des
étudiants sur les problématiques de l’écotoxicologie et la surveillance des milieux aquatiques
au sein de différents cursus.
Mot-clés :
Biomarqueurs, reprotoxicité, surveillance, ressource, animaux aquatiques

3
Projet de Chaire en Biosurveillance des milieux aquatiques
Contexte :
L’environnement est une préoccupation importante pour la population française. Aussi,
l’impérative nécessité de protéger cet environnement afin que chacun puisse vivre dans un
écosystème sain s’est traduite par un accroissement des exigences réglementaires avec par
exemple la Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) et la Directive Cadre Stratégie pour le
Milieu Marin (2008/56/CE). Aujourd’hui, l’évaluation de la qualité des milieux aquatiques
passe par un suivi de l’état chimique et écologique des masses d’eau, incluant actuellement
diverses métriques biologiques basées sur les communautés et utilisant les invertébrés, les
poissons, les algues. La surveillance des populations et communautés autochtones
d’organismes aquatiques a constitué la principale démarche de l’évaluation des
écosystèmes. Ces mesures ont prouvé leur utilité pour évaluer le « bon état écologique »
des masses d’eau mais à ce stade, la dégradation est installée de longue date et la
remédiation devient extrêmement problématique. L’objectif est d’identifier les masses d’eau
qui n’atteignent pas le bon état et de les inscrire dans un réseau de contrôle. Cette
démarche nécessite d’identifier les causes (physique et/ou chimique) de la dégradation
rendant incontournable l’utilisation d’outils écotoxicologiques. Aussi, la recherche en
écotoxicologie s’est attachée, depuis le début des années 80, à la compréhension des effets
des stress environnementaux et au développement d’indicateurs biologiques tels que les
biomarqueurs utilisables afin d’améliorer le diagnostic environnemental (Lagadic et al.,
1997). Cependant, ces outils n’ont jusqu’à présent été utilisés que très rarement dans le
cadre de la surveillance biologique opérationnelle de l’environnement et pour l’appui à la
gestion des milieux. Ceci est notamment lié à l’influence de nombreux paramètres
environnementaux susceptibles de moduler la réponse des biomarqueurs et à des difficultés
liées à la standardisation de leur mesure rendant parfois délicate l‘interprétation des résultats
obtenus (Amiard-Triquet et al., 2013). Il apparaît nécessaire, non seulement d’améliorer la
compréhension des processus biologiques impliqués dans la réponse des organismes à
différents facteurs de stress mais également de préciser les déterminants biologiques et
environnementaux de la variation des différents biomarqueurs. Ainsi, les conditions de
mesures de ces biomarqueurs nécessitent encore d’être précisées et caractérisées afin que
leurs réponses traduisent non seulement une exposition des organismes à ces molécules
mais aussi un risque potentiel pour le maintien de l’individu voire de sa population (De Coen
et al., 2000 ; Xuereb et al., 2009 ; Lacaze et al., 2011 ; Sanchez et al., 2011 ; Charron et al.,
2015).
Pour répondre aux besoins en matière de surveillance des milieux aquatiques, notamment
en considérant la contamination des masses d’eau par les polluants émergents et les effets
de la contamination sur les organismes, il est apparu important d’allier de manière
opérationnelle les compétences de l’INERIS en matière de recherche appliquée et
d’expertise dans le domaine de la biosurveillance et les compétences de l’URCA et de l’ULH
en matière d’écotoxicologie sur différents modèles biologiques caractéristiques des milieux
aquatiques continentaux, estuariens et marins. Ce projet alliant recherches cognitives et
appliquées a pour ambition de lever les verrous scientifiques et techniques limitant
l’utilisation de ces biomarqueurs pour le diagnostic de la qualité des milieux aquatiques et
leur surveillance. Ces questions sont au centre de l’Unité Mixte de Recherche Stress
Environnementaux et BIOsurveillance des milieux aquatiques (UMR-I 02 SEBIO), validée par

4
le ministère début 2014 et labellisée par l'Institut National de l'Environnement Industriel et
des Risques (établissement public à caractère industriel et commercial). L’INERIS a pour
mission de contribuer à la prévention des risques que les activités économiques font peser
sur la santé, la sécurité des personnes et des biens, et sur l’environnement. Il mène des
programmes de recherche visant à mieux comprendre les phénomènes susceptibles de
conduire aux situations de risques ou d’atteintes à l’environnement et à la santé, et à
développer sa capacité d’expertise en matière de prévention. Ses compétences scientifiques
et techniques sont mises à la disposition des pouvoirs publics, des entreprises et des
collectivités locales afin de les aider à prendre les décisions les plus appropriées à une
amélioration de la sécurité environnementale. Ce projet de Chaire s’inscrit totalement dans la
complémentarité de mission des deux établissements (URCA et INERIS) et contribuera au
renforcement de l’expertise du l’unité SEBIO dans le domaine des risques
environnementaux.
Objectifs et développement :
L’objectif principal de la chaire entre l’URCA et l’INERIS est la compréhension de l’impact
des stress anthropiques sur les organismes animaux et l’identification de réponses ayant un
potentiel en tant que biomarqueur. Les connaissances acquises contribueront à l’innovation
et au transfert de nouveaux outils d’évaluation des dangers des substances (bioessais et
biomarqueurs) et de caractérisation de la qualité des milieux aquatiques (biosurveillance) à
des fins de diagnostic, d’évaluation du risque écotoxicologique et de surveillance des milieux
aquatiques. Le projet visera également à promouvoir l’utilisation de ces outils dans un
contexte réglementaire afin de guider les gestionnaires, les utilisateurs des masses d’eau et
les politiques public dans l’amélioration de la gestion du risque pour l’homme et
l’environnement vis-à-vis des utilisations des différentes masses d’eau et des services
écosystémiques rendus.
Développement :
Parmi les grandes fonctions physiologiques étudiées au sein de l’unité, le présent projet se
focalisera sur la reproduction et sa régulation. En effet, la reproduction apparaît comme
particulièrement pertinente pour identifier des réponses prédictives d’effet toxique pour le
maintien de l’individu voire de sa population via sa descendance (Adams et al., 1989 ;
Amiard et al. 2013 ; Gubbins et al., 2013, Santos et al., 2013). Actuellement, les recherches
développées au sein de l’unité (sites de Reims et INERIS) s’inscrivent notamment à la
description de marqueurs en lien avec la qualité des gamètes (intégrité de l’ADN, marqueurs
de l’acrosome…) et de la gamétogénèse (développement d’un indice gonadique par
approche cytométrique) chez un mollusque bivalve continental Dreissena polymorpha.
Parallèlement, l’étude des mécanismes d’action de perturbateurs endocriniens, en particulier
sur la reproduction de poissons modèles et/ou autochtones, a conduit au développement et
à la validation de bioessais in vitro et in vivo et de biomarqueurs (vitellogénine, intersexe,
etc.). Les actions de recherche concerneront les modèles aquatiques continentaux
considérés au sein de l’unité ayant un fort potentiel d’utilisation pour du diagnostic ou de la
surveillance à une large échelle nationale et européenne. De plus, ces recherches
s’inscriront dans un contexte environnemental par la considération de la problématique des
expositions chroniques à faibles doses et de la présence de stress multiples (chimique,
biologique et physique) et intégreront, par la considération de la reproduction, les questions
d’intérêt actuellement en écotoxicologie d’effets transgénérationnels. Compte tenu de la

5
problématique, de l’expertise et des moyens déjà présents sur les différents sites de l’unité,
les travaux de la chaire seront orientés, au travers d’expérimentations couplant des
approches in vitro/ex vivo, in vivo et in situ, vers les axes suivants :
- le premier axe concerne l’amélioration des connaissances de la
physiologie/écophysiologie de la reproduction des espèces modèles et leur modulation sous
la pression des changements environnementaux. Cet axe aura pour objectif de développer
des recherches visant à identifier les mécanismes d’action reprotoxique des contaminants
sur la reproduction et sa régulation chez des organismes modèles représentatifs des
écosystèmes aquatiques continentaux nationaux et européens. Le développement
d’approches globales (protéomique, transcriptomique…) sera privilégié. Le projet prendra
également en considération l’identification de fenêtres critiques d’exposition en lien avec des
périodes sensibles du développement et/ou du cycle de vie des organismes.
- sur la base des mécanismes d’action, le deuxième axe aura pour objectif de
caractériser le potentiel de certaines réponses en tant que biomarqueurs. Cet axe visera tout
particulièrement à définir le caractère prédictif des réponses moléculaires vis-à-vis des effets
sur la descendance. Ainsi, au travers d’une approche intégrative prenant en considération
les différents mécanismes d’action des polluants ainsi que les différents niveaux
organisationnels, le projet visera à préciser les liens entre des réponses d’intérêt mesurées
au niveau moléculaire, individuel (traits de vie, performances reproductrices) voire
populationnel (sex-ratio, aspects transgénérationnels).
- le troisième axe aura pour objectif de définir les conditions d’analyse de ces
biomarqueurs et de leur « standardisation ». Cet axe est indispensable pour assurer le
transfert des réponses d’intérêts en véritable outils de diagnostic et de surveillance. Ces
actions devront considérer de façon importante les attentes des gestionnaires et utilisateurs
des milieux aquatiques au niveau régional (métropole…), national (ONEMA, Agence de
l’eau…) et international (Eawag en Suisse…). Sur le volet « standardisation » les actions
devront s’inscrire dans un cadre national d’AQUAREF. Ce troisième axe aura donc pour
objectif de renforcer les interactions entre le volet cognitif des actions de recherche et la
mission de transfert de l’INERIS. L’apport de ces nouvelles réponses, en association aux
réponses déjà développées au sein de l’unité SEBIO (immunité, métabolisme), dans un
contexte de diagnostic et/ou de suivi de la qualité des masses d’eau, sera évalué dans le
cadre d’une collaboration avec l’Agence de l’eau Seine Normandie, Direction vallées de
Marne. Cette collaboration permettra d’une part de préciser la capacité des biomarqueurs à
discriminer des sites en comparaison des métriques biocénotiques actuellement utilisées.
D’autre part, dans un contexte de diagnostic, le potentiel des biomarqueurs dans
l’identification des causes potentielles de dégradation de la qualité biologique de masses
d’eau sera également testé. En effet différents sites, dont la dégradation biologique ne
semble pas liée à la physico-chimie du milieu, seront sélectionnés et évalués à l’aide de
biomarqueurs afin, si possible, de préciser le diagnostic.
Le présent projet de Chaire est construit sur le modèle de Chaire institutionnelle avec le
soutien important de l’INERIS. Les retombées économiques d’un tel projet sont difficilement
mesurables à court et moyen terme. Cependant l’amélioration des connaissances de l’impact
des différentes pressions anthropiques sur la qualité des milieux aquatiques et ainsi sur le
maintien de leur biodiversité et des services écosystèmiques associés, représente un apport
primordial. En effet, le développement d’outils sensibles et prédictifs, permettront d’identifier
les situations à risque avant que les perturbations n’aient engendré une dégradation trop
importante de la biocénose, évitant ainsi la mise en place de processus de remédiation longs
 6
6
 7
7
1
/
7
100%