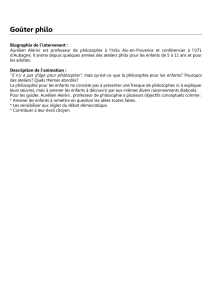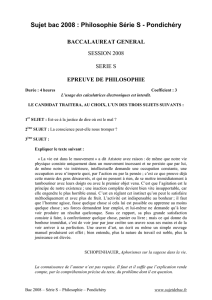Présentation de la philosophie et du programme

Lycée franco-mexicain – Année scolaire 2015-2016
Cours Olivier Verdun

Lycée franco-mexicain – Année scolaire 2015-2016
Cours Olivier Verdun
PRÉSENTATION DE LA PHILOSOPHIE ET DU PROGRAMME
I) LES OBJECTIFS DE LA PHILO EN TERMINALE
L'enseignement de la philosophie en classes terminales a pour objectif de favoriser l'accès de
chaque élève à l'exercice réfléchi du jugement, et de lui offrir une culture philosophique
initiale. Ces deux finalités sont substantiellement unies.
La culture philosophique à acquérir durant l'année de terminale repose elle-même sur la
formation scolaire antérieure, dont l'enseignement de la philosophie mobilise de nombreux
éléments, notamment pour la maîtrise de l'expression et de l'argumentation, la culture littéraire et
artistique, les savoirs scientifiques et la connaissance de l'histoire.
Ouvert aux acquis des autres disciplines, cet enseignement vise dans l'ensemble de ses
démarches à développer chez les élèves l'aptitude à l'analyse, le goût des notions exactes et le
sens de la responsabilité intellectuelle. Il contribue ainsi à former des esprits autonomes, avertis
de la complexité du réel et capables de mettre en œuvre une conscience critique du monde
contemporain.
II) LE PROGRAMME DE TERMINALE
« Dans toutes les séries, la liste des notions s’articule à partir de cinq champs de problèmes,
eux-mêmes désignés par des notions, isolées ou couplées, qui orientent les directions
fondamentales de la recherche. » Le programme se compose d'une liste de notions et d'une liste
d'auteurs. Qu’est-ce qu’une notion ?
Il s'agit d'un mot ordinaire de la langue («le sujet», «la conscience», «l'art»), mais qui s'est
chargé de sens au point de désigner ce qu'on appelle vulgairement une «idée», c’est-à-dire un
champ ou un aspect essentiel de la Réalité : « l'existence », « la Technique », « la Beauté »… A
distinguer du concept qui est une idée générale dont la définition est modifiée, voire créée de
toutes pièces par un auteur en fonction d’un problème et d’un cadre argumentatif déterminés.
Philosopher, c'est d'abord clarifier, ordonner, hiérarchiser le sens des mots, de manière à
construire, à partir d'une notion commune, un ou plusieurs concepts philosophiques. Pour ce faire,
la recherche de l'étymologie d'un mot peut être fort utile en ce qu'elle donne souvent des éléments
de compréhension de la notion. Définir, c'est aussi délimiter, distinguer une notion des mots qui
lui sont associés ou opposés. Interroger la pertinence d'une distinction peut être une manière
habile de faire apparaître un problème.
La 1ère partie du programme des séries générales s'intitule "le Sujet" : le Sujet n'est pas autre
chose que l'Homme en tant que personne ou individu. Il s'agit de savoir ce qui définit ou ce qui
détermine un être humain, non pas en tant qu'être social, d'abord en tant qu'être individuel.
Puis vient la "Culture" : on passe ici de la personne individuelle au genre humain dans son
ensemble, car la culture n'est jamais individuelle mais transmission collective, elle appartient à
l'humanité tout entière. Mais dans ces 2 premières parties, la forme de l'interrogation reste la

Lycée franco-mexicain – Année scolaire 2015-2016
Cours Olivier Verdun
même, elle est de l'ordre d'un "qu'est-ce que", on cherche à définir avant tout les caractéristique de
l'humain. Question kantienne « Qu’est-ce que l’homme ? ».
Arrive ensuite "La Raison et le Réel" : le problème à formuler est ici celui de la
connaissance, autrement dit « Que pouvons-nous connaître ? » ; la Vérité étant précisément
l'objet même de la connaissance, le but ultime, puisque savoir quelque chose revient à savoir que
cette chose est vraie. La partie de la philosophie qui traite cet ensemble de problèmes se nomme
« l'épistémologie » (de "épistémè" en grec, le savoir), ou encore la « philosophie des sciences »,
même si la notion de Vérité renvoie à d'autres problèmes qui n'ont rien de scientifiques : le devoir
de dire la vérité, par exemple, est un problème moral.
La "Politique" est la 4e partie. La politique est le domaine de l'action collective, de la
« pratique » (de "praxis" = action en grec), et non celui de la recherche théorique de la vérité
(problème des sciences, 3e partie) ou celui de la détermination de l'essence de l'homme (1ère et 2e
parties). La philosophie s'intéresse donc à l'être social de l'homme et aux principes qui
pourraient rendre cette existence sociale meilleure et plus juste.
Enfin le programme se clôt avec la "Morale", elle aussi « pratique » puisqu'il s'agit de
déterminer les règles pouvant guider les personnes à agir en vue de la meilleure existence
possible, ce qu'on appelle ordinairement « le Bonheur ».
Le programme forme donc une sorte de boucle qui va de l'homme en tant qu'être individuel
(une "Conscience") à l'homme en tant que personne morale agissant parmi ses semblables.
Où l’on voit que cinq figures de l'Homme se succèdent : l'individu, l'humanité, le savant, le
citoyen, la personne. Si le thème central de la philosophie est l'Homme, le problème d'ensemble
se précise. On pourrait l'énoncer ainsi : « Qu'est-ce que l'Homme, en tant qu'être cultivé, individu
membre d'une communauté, doit connaître et faire pour mener une existence digne et heureuse ? »
Le programme introduit la notion de repères : « L’étude méthodique des notions est précisée et
enrichie par des repères auxquels le professeur fait référence dans la conduite de son
enseignement. » Il s'agit d'une liste, non limitative, de distinctions conceptuelles opératoires, qui
peuvent être impliquées dans des chapitres divers. Ce ne sont pas des "thèmes" mais des
« concepts opératoires » souvent présentés deux par deux sous forme d'oppositions (par exemple
"absolu/relatif", ou "théorie/pratique"). Il n'est pas question de leur consacrer un cours
spécialement, on nous demande seulement de les souligner, de les définir et surtout de savoir les
utiliser au fur et à mesure de l'évolution du cours. En voici la liste complète :
« Absolu/relatif - Abstrait/concret - En acte/en puissance - Analyse/synthèse - Cause/fin -
Contingent/nécessaire/possible - Croire/savoir - Essentiel/accidentel - Expliquer/comprendre - En
fait/en droit - Formel/matériel - Genre/espèce/individu - Idéal/réel - Identité/égalité/différence -
Intuitif/discursif - Légal/légitime - Médiat/immédiat - Objectif/subjectif - Obligation/contrainte -
Origine/fondement - Persuader/convaincre - Ressemblance/analogie - Principe/conséquence - En
théorie/en pratique - Transcendant/immanent - Universel/général/particulier/singulier »

Lycée franco-mexicain – Année scolaire 2015-2016
Cours Olivier Verdun
III) LA PHILOSOPHIE, QU'EST-CE QUE C'EST ?
Cette présentation rapide de l'enseignement de la philosophie en terminale va maintenant nous
permettre d'expliquer sommairement ce qu'est la philosophie. Nous nous contenterons ici de
dégager les grandes lignes du projet philosophique. Nous nous mettrons ensuite directement au
travail, la meilleure façon de définir la philosophie étant d'en faire. Pour ce faire, je vous propose
de répondre à ce petit questionnaire qui nous aidera à cerner la question " qu'est-ce que la
philosophie ? "
1) Questionnaire distribué aux élèves
1. Connaissez-vous l'origine du mot " philosophie " ?
2. Quand on dit de quelqu'un qu'il est " philosophe " ou qu'il faut agir avec " philosophie ", que
veut-on signifier ?
3. Avez-vous entendu parler de certains philosophes ou lu des ouvrages philosophiques ? Si oui,
lesquels ?
4. Voici 14 questions. Distinguez les questions de portée philosophique de celles qui, à votre
avis, ne le sont pas et justifiez votre choix. Ecrire une définition provisoire du questionnement
philosophique et rédiger quatre questions uniquement philosophiques, chacune portant sur un
thème différent.
1. Quels sont les mécanismes de la mémoire ?
2. Pourquoi le TGV va-t-il plus vite que le train corail ?
3. Y a-t-il des usages légitimes de la violence ?
4. L’art est-il utile ?
5. Quelles sont les libertés fixées par la Déclaration des droits de l’homme ?
6. Qu’est-ce qu’un ordinateur ?
7. Faut-il défendre l’ordre à tout prix ?
8. Etre libre est-ce faire ce qui nous plaît ?
9. Peut-on donner son sang une fois par semaine sans être affaibli ?
10. Dieu existe-t-il ?
11. D’après Freud, à quel âge l’enfant passe-t-il par une période de latence ?
12. Existe-t-il des êtres doués de pensée ailleurs que sur la Terre ?
13. Comment s’effectue le dépistage du cancer du foie ?
14. Pensez-vous, comme le dit J.-P. Sartre, que « l'enfer, c'est les autres » ?
2) La signification du mot " philosophie "
La philosophie est pour la plupart d’entre nous une discipline fort étrange et obscure. Si l'on
se tourne du côté du sens commun, le mot "philosophie" reçoit différents usages, comme le
suggèrent un certain nombre d'expressions familières :

Lycée franco-mexicain – Année scolaire 2015-2016
Cours Olivier Verdun
* « prendre les choses avec philosophie » : garder son calme, sa sérénité au milieu des tracas de la
vie quotidienne; la philosophie : une sorte de sagesse entendue comme art de s'accommoder des
événements que l'on ne peut pas changer, un idéal de maîtrise de soi;
* « la philosophie d'un homme d'Etat, d'un programme » : les principes généraux d'un plan
d'action, d'un programme politique, d'une loi;
* « la philosophie bouddhiste » : la vision du monde qui se dégage plus ou moins explicitement
d'un comportement, d'une croyance, d'une doctrine.
Philosophie veut dire en grec ‘’amour de la sagesse’’. Le mot philosophie aurait été introduit
par Pythagore (VI e siècle avant notre ère) parce qu'il était plus modeste, moins ambitieux que
celui de sagesse. La philosophie se caractérise donc, en premier lieu, par son aspiration à la
connaissance, au savoir, à la sagesse. Mais quel type de connaissances et en vue de quoi ?
En premier lieu, remarquons qu'il est rare qu’on demande à une discipline enseignée dans le
secondaire de se définir, sans doute parce qu’elle possède un air de familiarité. Il ne serait peut-
être pas évident de définir les mathématiques à quelqu’un qui n’en aurait jamais fait ; et pourtant,
on fait des maths sans s’interroger sur ce que l’on fait : soit on réussit et c’est valorisant, soit on
échoue et on est nul en math ; mais l’objet des mathématiques n’est pas une question
apparemment pertinente.
Il n’en est pas de même de la philosophie puisque cette matière apparaît pour la première fois
en terminale (spécificité française). On s’interroge légitimement sur son objet. Or la question "
qu'est-ce que la philosophie ? " est déjà elle-même une question philosophique, comme la
question : “ qu’est-ce que les mathématiques ? ” est philosophique.
En effet, quand un mathématicien se demande ce qu’il fait, sur quel type d’objet il travaille, il
se pose des questions qui excèdent les mathématiques, auxquelles il ne peut être répondu par des
théorèmes. Une expérience de chimie est un exemple du travail du chimiste, mais elle ne peut
satisfaire à la question : " qu'est-ce que la chimie ?". Sur ces questions, ou sur les réponses qu’il
convient d’y apporter, tous les mathématiciens ne seront pas d’accord; alors même qu’ils font les
mêmes mathématiques, ils n’auront pas nécessairement la même conception des maths.
Quelles sont alors les caractéristiques du questionnement philosophique ? Pour répondre à cette
question, examinons le petit exercice qui vous a été proposé.
3) Le questionnement philosophique
Correction du questionnaire :
Exemple de quatre questions philosophiques : la mort rend-elle la vie absurde ? Peut-on
concevoir des sociétés sans violence ? Qu’est-ce qu’être maître de soi ? La passion est-elle
toujours un esclavage ?
Les caractéristiques du questionnement philosophique : ce sont des questions qui suscitent
des prises de position, qui demandent un jugement personnel, qui concernent tout le monde.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%