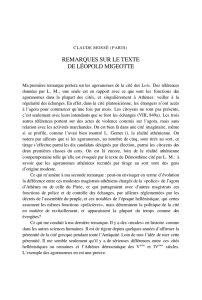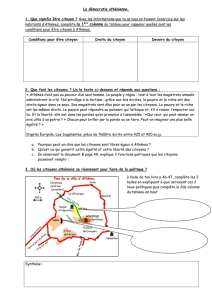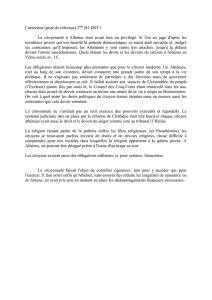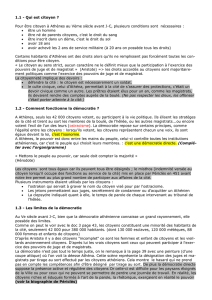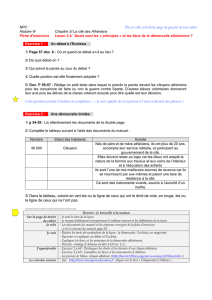Être citoyen à Athènes - Hachette

10
Au Ve siècle avant J.-C., les Athéniens élaborent des principes et des pratiques
de gouvernement qui impliquent la participation des citoyens à toutes les décisions.
C’est la démocratie. Mais cette démocratie, limitée aux hommes, refuse de s’ouvrir
aux étrangers et repose largement sur le travail de nombreux esclaves.
x Quelles sont les caractéristiques de ce régime politique original ?
x Comment les Athéniens jugent-ils leur démocratie ?
1Être citoyen
à Athènes
≥≥> La première démocratie…
« S’il faut délibérer sur le gouvernement de la Cité, alors chacun se lève pour
donner son avis : charpentier, forgeron, cordonnier, marchand ou armateur,
riche ou pauvre, noble ou roturier, indi éremment. »
Platon (428-vers 348-347 av. J.-C.), Protagoras.
La démocratie
couronnant le peuple
(Stèle de marbre portant
le décret contre la tyrannie,
336 av. J.-C., Musée
de l’Agora, Athènes.)

Être citoyen à Athènes 11
« Ô Demos [le peuple], tu possèdes en
vérité un splendide pouvoir ; l’humanité
entière te craint comme un tyran. Hélas
on te mène facilement et tu aimes les
atteries qui te dupent. Tu restes toujours
bouche bée devant les beaux parleurs.
Ton bon sens alors t’abandonne et
te plante sur place. »
Aristophane (vers 445-vers 386 av. J.-C.),
Les Cavaliers.
Athéna pensive
(Relief en marbre, vers 470 av. J.-C.
Musée de l’Acropole, Athènes.)
≥≥> … s’interroge sur elle-même

La journée d’un écolier
au début du Ve siècle
2
vocabulaire
> Gymnase (gymnos : nu) : Le lieu où les jeunes gens (éphèbes) et les adul-
tes pratiquent, nus, divers entraînements sportifs ou militaires. Les en-
fants vont à la palestre (palé : lutte) où ils pratiquent la course, les sports
de combat, le saut en longueur, le lancer du disque et du javelot.
> Lycée : Le nom d’un gymnase à la périphérie d’Athènes près du temple
d’Apollon Lycien (Lucos : loup, animal consacré à Apollon). En 335 av. J.-C.,
Aristote, l’un des plus grands philosophes grecs, y fonda une école.
En 387 av. J.-C., Platon avait fondé une école dans un autre gymnase,
l’Académie (du nom du héros Académos).
> Scholé : Le temps libre consacré à une activité non directement produc-
tive : lecture, musique, sport, conversation, étude, participation à la vie
politique… Tout ce qui fait pour l’Athénien « l’art de bien vivre ». (Le sens
d’étude donnera le mot école.)
« Tout d’abord, il ne fallait pas entendre un en-
fant sou er mot. Ensuite, il fallait marcher dans
la rue en bon ordre quand on se rendait avec tous
ses voisins, en simple tunique, en rangs serrés
chez le maître de musique, neigea-t-il gros comme
farine d’orge. Là, pour débuter, chez le cithariste,
on apprenait à chanter “Pallas destructrice invin-
cible des villes” ou “Un hymne au loin résonne”1,
s’appliquant à conserver la mélodie transmise par
les ancêtres. Si quelqu’un risquait une plaisante-
rie ou quelque in exion de la voix compliquée
à la mode d’aujourd’hui, il recevait une raclée
pour avoir, par cette o ense, fait fuir les muses.
Chez le maître de gymnastique, les enfants de-
vaient, lorsqu’ils étaient assis, garder les cuisses
bien allongées sur le sol de façon à ne rien monter
d’indécent aux passants du dehors […]. À la mai-
son, on ne tolérait ni la gourmandise ni les rica-
nements imbéciles ni une attitude négligée […].
C’est avec des vieilleries de ce genre que mon sys-
tème d’éducation a formé les héros qui combat-
tirent à Marathon2 […]. Avec moi tu apprendras
à ne pas traîner sur l’Agora, à te passer de bains
chauds […]. Tu te lèveras de ton siège avec respect
devant les vieillards, tu ne seras pas grossier avec
tes parents, tu ne feras rien qui pourrait donner
mal à penser à ton sujet. »
Aristophane• (vers 445-vers 386 av. J.-C.), Les Nuées,
423 av. J.-C.
1. Chants patriotiques ; Pallas désigne Athéna.
2. Victoire athénienne contre les Perses en 490 av. J.-C.
12
dossier
L’éducation à Athènes : quelles
valeurs pour le futur citoyen ?
Au Ve siècle avant J.-C.,
l’éducation du jeune Athénien
a un but politique et moral :
former des soldats endurants
et disciplinés, des citoyens
capables de prendre la parole,
de défendre leur point de vue,
d’adopter les bonnes décisions
dans le respect des valeurs
partagées par la communauté.
L’éducation des futurs citoyens
(Coupe attique à fi gures rouges attribuée à Douris [fi n VIe siècle-début du
Ve siècle av. J.-C.], vers 480 av. J.-C., face A : enseignement de la lyre et cours
de déclamation, face B : enseignement de l’aulos. Antikensammlung, Berlin.)
1
A
B

La contestation de la monarchie absolue
Documents 1 à 3
1 Quelles sont les disciplines enseignées au jeune Athénien ?
2 Quel comportement le maître attend-il de son élève ? Quelles
vertus veut-il lui inculquer ?
Document 4
3 Qu’apporte l’éducation proposée par les sophistes ? Quel est son
objet principal ?
Document 5
4 Quels sont les devoirs de l’éphèbe ?
Bilan
À partir de l’étude de l’éducation, expliquez sur quelles valeurs
repose la citoyenneté à Athènes.
questions
13
Être citoyen à Athènes 13
Les éphèbes au service de la cité
5
Entre 18 et 20 ans, les jeunes Athéniens qui combattront comme
soldats reçoivent une formation militaire et civique faite d’entraîne-
ments sportifs au gymnase et de séjours dans les forts des zones fron-
tières. L’éphébie conditionne l’accès à la citoyenneté.
« Je ne déshonorerai pas les armes sacrées que je porte. Je n’aban-
donnerai pas mon camarade au combat. Je lutterai pour la défense
de la religion et de l’État et je transmettrai à mes cadets une patrie
non point diminuée mais plus grande et plus puissante dans toute
la mesure de mes forces et avec l’aide de tous. J’obéirai aux magis-
trats, aux lois établies, à celles qui seront instituées. Si quelqu’un
veut les renverser, je m’y opposerai de toutes mes forces et avec l’aide
de tous. Je vénérerai les cultes de mes pères. Je prends à témoin de
ce serment les divinités Aglauros, Hestia, Enyo, Enyalios, Arès et
Athéna Aréia, Zeus, allô, Auxô, Hégémonè, Héraklès, les bornes
de la patrie, les blés, les orges, les vignes, les oliviers, les guiers. »
Serment des éphèbes gravé sur une stèle provenant du nord de l’Attique,
datée de la seconde moitié du IVe siècle av. J.-C. mais reproduisant
un serment plus ancien.
L’éducation du corps : une scène de lutte
(Coupe à fi gures rouges attribuée au peintre Codrus, vers 430 av. J.-C.)
3
L’enseignement des sophistes
4
Protagoras est un sophiste, maître chargé d’ensei-
gner la rhétorique, c’est-à-dire l’art de la parole.
Il expose à Socrate son programme d’enseignement :
« Protagoras : Celui qui vient me trouver n’aura
pas à craindre ce que lui aurait fait subir la fré-
quentation de quelqu’autre sophiste ; car les
autres maltraitent les jeunes. Contre leur gré, ils
les abreuvent de savoirs techniques comme le cal-
cul, l’astronomie, la géométrie, la musique […].
Tandis que moi, ce que j’enseigne, c’est le bon
conseil. En matière d’a aires privées, celui qui
permet de gérer au mieux sa propre maison. En
matière d’a aires publiques, celui qui permet de
montrer par la parole et par l’action le plus d’e -
cacité dans les a aires de l’État.
Socrate : Si j’ai bien compris, c’est de l’art de la
politique que tu me parles, et tu promets de for-
mer de bons citoyens ? »
Platon (428-vers 348-347 av. J.-C.), Protagoras.

x Répartition de la population
à Athènes vers 432
> Croisade
Il s’agit de la guerre sainte décrétée par
le pape. Elle a pour but de libérer la Terre
sainte de la domination musulmane.
> Djihad
Le terme signifi e « effort ». L’islam prône
la purifi cation du monde et des croyants :
on distingue le grand djihad, effort pour
se purifi er soi-même et le petit djihad, l’ef-
fort pour gagner de nouveaux territoires à
Dieu et les soumettre à la loi de l’islam, la
guerre sainte.
> Reconquista
Ce terme fait référence aux guerres me-
nées par les rois chrétiens d’Espagne pour
conquérir la péninsule, ce qu’ils estiment
être une « reconquête » sur les musul-
notions
>
Cito
y
en
Celui qui participe aux aff
air
es de
la cité.
Ce s
t
atut implique des dr
oits
(prot
ection)
et des de
v
oir
s.
>
Communauté civique
Ell
e es
t c
omposée de cit
o
y
ens, des
futur
s
cit
o
y
ens (enf
ants) et de c
ell
es
qui tr
ans-
mettent la cit
o
y
enneté (fi ll
es
de cit
o
y
ens).
> Magistrature
L’exercice d’une fonction politique, judi-
ciaire, fi nancière ou militaire dans le gou-
vernement de la cité, pour une durée d’un
an en général.
> Sacerdoce
Fonction religieuse exercée par un citoyen,
le plus souvent pour un an, après tirage au
sort ou élection.
1414
1
Le citoyen athénien
À Athènes, la citoyenneté
implique des droits et
des devoirs qui dé nissent
la communauté des citoyens.
Elle est déterminée par
la naissance au sein
d’une famille athénienne,
et donc restreinte.
1
La cité d’Athènes
Le mot grec polis, que nous traduisons par cité, désigne une ville mais aussi
l’État formé par cette ville avec le territoire qui l’entoure et enfi n l’ensemble des
citoyens de cet État. Les cités grecques se sont formées à partir du VIIIe siècle
avant J.-C. La plupart sont des monarchies ou des régimes aristocratiques.
Au milieu du Ve siècle avant J.-C., Athènes est la cité la plus puissante et la plus
prestigieuse de la Grèce. Le territoire d’Athènes (l’Attique) s’étend sur 2 650 km2,
soit à peu près la moitié d’un département français. Les habitants des dèmes
*
les plus éloignés ne sont qu’à une quarantaine de kilomètres de la ville. On
évalue à 400 000 le nombre d’habitants d’Athènes au Ve siècle dont seulement
30 000 à 40 000 citoyens.
2
Le citoyen, des devoirs et des droits
Seuls sont citoyens les hommes adultes (de plus de 18 ans) nés d’un père
athénien et, à partir de la réforme de Périclès
•
(451 avant J.-C.), d’un père et
d’une mère athéniens. La citoyenneté athénienne est une citoyenneté par fi lia-
tion. Elle peut être accordée à des étrangers, mais à titre exceptionnel, au vu des
services qu’ils ont rendu à la cité.
Le citoyen a des devoirs : aimer sa patrie, en respecter les lois, la défendre,
conforter sa puissance. Après avoir effectué l’éphébie
*
, tous les citoyens de 20 à
49 ans peuvent être appelés au combat. Les grands propriétaires dans la cavale-
rie, les classes moyennes dans l’infanterie lourde des hoplites
*
, les plus pauvres
dans l’infanterie légère ou comme rameurs sur les trières.
La participation à la vie de la cité est aussi fonction du niveau de fortune. Le
poids des liturgies
*
, par exemple, repose sur les plus riches qui en tirent orgueil
et popularité.
Le citoyen a des droits : lui seul peut posséder ou acquérir une terre ou une
maison, exercer une magistrature, un sacerdoce, participer aux banquets qui
clôturent certaines fêtes. Il reçoit des indemnités pour assister aux spectacles
de théâtre, des distributions exceptionnelles de blé en cas de disette. Enfi n et
surtout, seuls les citoyens participent à la prise de décision en matière politique
et judiciaire.
3
Les non-citoyens
Les femmes nées de parents athéniens font partie de la communauté civique
puisqu’elles transmettent la citoyenneté et sont associées au culte des dieux.
Mais sur le plan juridique, elles sont considérées comme des mineures placées
sous l’autorité du père puis du mari. Elles ne sortent guère de la partie de la mai-
son qui leur est réservée : le gynécée. Elles n’ont aucun droit politique.
Les métèques sont des étrangers résidant à Athènes. Un citoyen leur sert de
garant. Ils s’acquittent d’une taxe de séjour, peuvent être requis pour des opéra-
tions militaires, participent dans certaines limites aux fêtes religieuses mais pas
à la vie politique.
Les esclaves sont souvent des barbares (des non Grecs), prisonniers de guerre
ou enlevés par des trafi quants. L’esclave est, selon Aristote•, « celui qui tout
en étant un homme est un bien acquis ». Il n’a donc ni liberté, ni droit juridique
ou politique. On estime qu’en moyenne, un Athénien pouvait posséder trois ou
quatre esclaves. Leur travail lui permettait de disposer du temps nécessaire pour
exercer pleinement son rôle de citoyen.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%