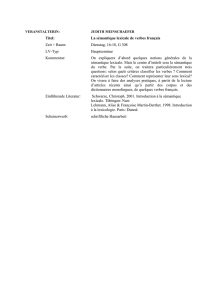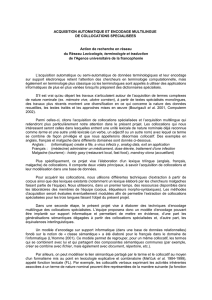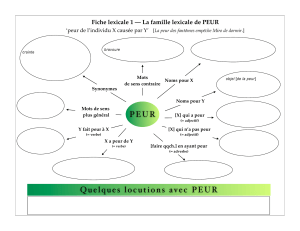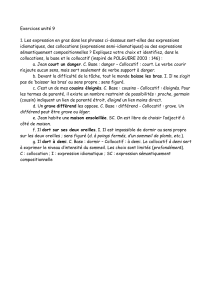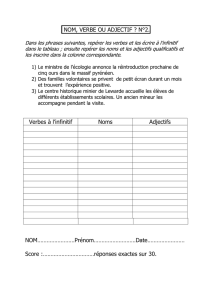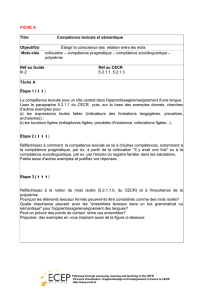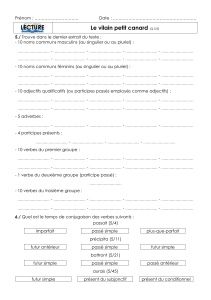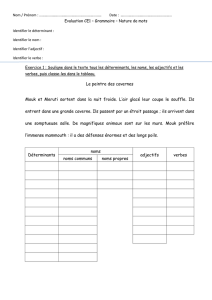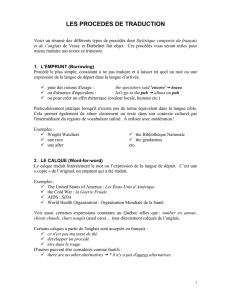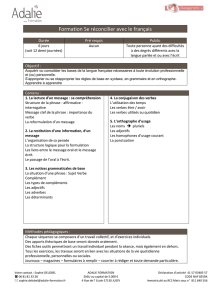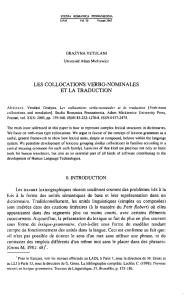Analyse des noms des sentiments négatifs à travers leur

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE FERHAT ABBAS / SETIF
FACULTE DES LETTRES ET DES SCIENCES SOCIALES
DEPARTEMENT DES LANGUES ETRANGERES
ECOLE DOCTORALE DE FRANÇAIS
ANTENNE DE SETIF
MEMOIRE DE MAGISTERE
OPTION : Sciences du Langage
Réalisé par : Fouzia SAYOUD
Thème :
Analyse des noms des sentiments négatifs
à travers leur combinatoire lexicale.
-Avec appui de corpus journalistique.
Devant le jury composé de :
Président : Saïd KHADRAOUI, Professeur, Université de Batna.
Rapporteur : Mireille PIOT, Professeur, Université Grenoble 3.
Examinateur : Samir ABDELHAMID, M.C., Université de Batna.
Examinateur : Abdelouahab DAKHIA, M.C., Université de Biskra.
Université
Sétif2

TABLE DES MATIERES
DEDICACES
REMERCIEMENTS
TABLE DES MATIERES
Pages
INTRODUCTION GENERALE ........................................................... 1
PREMIER CHAPITRE :
ETAT DE LA QUESTION
Introduction partielle……………………………………………….9
I. Les collocations ............................................................................ 9
1.1 Généralités.............................................................................. 9
1.1.1 Où peut-on classer les collocations ? ........................... 9
1.1.2 Les collocations forment-elles un lexique
ou un vocabulaire ?................................................... 12
1.1.2.1 Le lexique..................................................... 12
1.1.2.3 Le vocabulaire .............................................. 12
1.1.3 La place qu’occupent les collocations dans
les phénomènes phraséologiques ............................. 14
1.1.3.1 Les expressions figées.................................. 14
1.1.3.2 Les expressions semi-figées
(ou collocations) .......................................... 15
1.1.3.3 Les expressions libres................................... 17
1.1.4 Le figement lexical..................................................... 18
1.2 Les collocations : un débat théorique................................... 20
1.2.1 L’école contextualiste britannique ............................. 20
1.2.1.1 Malinowski : un soubassement
théorique................................................................... 21
1.2.1.2 Firth et le contextualisme............................... 21
1.2.1.3 Après Firth : Sinclair et Halliday................... 24
1.2.1.3.1 Sinclair ........................................... 24
1.2.1.3.2 Halliday : la grammaire
fonctionnelle..................................26
1.2.2 L’école lexicographique ............................................. 27
1.2.2.1 Haussmann.................................................... 27
1.2.2.2 Tutin & Grossmann....................................... 31
Université
Sétif2

1.2.2.3 Mel’cuk : la théorie Sens Texte
et les collocations ....................................... 35
1.2.2.3.1 Le DEC......................................... 37
1.2.2.3.2 Le DiCo ........................................ 38
1.3 Collocations et combinaisons lexicales spécialisées............ 38
1.3.1 Unités lexicales vs termes .......................................... 39
1.3.2 L’intérêt des collocations dans le domaine
spécialisé................................................................... 40
Conclusion partielle........................................................................ 42
DEUXIEME CHAPITRE :
LA COMBINATOIRE LEXICALE DANS LE FRANÇAIS STANDARD
(DE FRANCE)
Introduction partielle.......................................................................44
I. Les champs sémantiques..............................................................45
1.1 Le Petit Robert (PR) .............................................................46
1.1.1 Les renvois analogiques............................................. 47
1.1.2 Les contextes d’emploi .............................................. 50
1.2 Le Trésor de la Langue Française (TLF) ..............................52
II. La structuration du lexique.........................................................54
2.1. La théorie des combinaisons syntagmatiques et
la théorie des associations de De Saussure .........................55
2.1.1. Les combinaisons syntagmatiques ............................55
2.1.2. Les rapports associatifs ............................................ 55
2.2 Les associations lexicales : un champ associatif ................. 57
2.3 Aperçu sur le lexique-grammaire ........................................ 64
2.4 La distribution des constituants immédiats ......................... 67
2.5 Les classes des unités lexicales de Fries ............................. 69
2.6 Les classes d’objet de Gaston Gross ................................... 70
III. La combinatoire lexicale dans le français...................................... 75
3.1 Définitions possibles de la combinatoire lexicale ................... 75
3.2 Les cooccurrences lexicales..................................................... 76
3.2.1 La prédiction................................................................... 76
Université
Sétif2

3.2.2 L’acceptabilité ................................................................ 77
3.2.3 La restrictions de sélection (ou contraintes)…............... 78
3.3 Les types de combinatoires...................................................... 78
3.3.1 Les combinaisons verbales ............................................. 79
3.3.1.1 Les verbes support ............................................. 79
3.3.2 Les combinaisons nominales.......................................... 80
3.3.2.1 La détermination ................................................ 80
3.3.2.2 Les variations : genre et nombre ........................ 82
3.3.2.3 La coordination................................................... 82
3.3.2.3.1 La coordination par « Et » .................. 83
3.3.2.3.2 La coordination par « Ni ».................. 84
3.3.3 Les combinaisons adjectivales........................................84
3.3.3.1 L’adjectif.............................................................84
3.3.3.2 Les propriétés de l’adjectif..................................86
3.3.3.2.1 L’intensification.................................. 86
Conclusion partielle ............................................................................. 86
TROISIEME CHAPITRE :
ANALYSE ET EXPLOITATION DU CORPUS
Introduction partielle............................................................................. 89
I. Démarche ...........................................................................................90
II. Les données définitoires des Npeur...................................................91
III. La cooccurrence lexicale des Npeur.................................................92
IV. Analyse syntactico-sémantique des Npeur ......................................93
4.1. Npeur + verbe : analyse syntactico-sémantique .......................94
4.1.1. Les constructions à verbe support (CVP) .....................94
4.1.1.1. Les Vsup causatifs............................................99
4.1.1.2. Les Vsup intensifieurs....................................101
4.1.1.3. Les Vsup aspectuels .......................................102
4.1.2 Les Npeur et les manifestations
expressives et physiques ....................................107
4.1.2.1 Attitude / non attitude...........................107
4.1.2.1.1 Attitude ................................107
4.1.2.1.2 Non attitude..........................110
4.1.2.2 Les verbes de contrôle. .........................112
Université
Sétif2

4.2 Npeur + nom : analyse syntactico-sémantique ........................113
4.2.1 Npeur : complément d’un nom ......................................113
4.2.1.1 Manifestations corporelles et expressives ........114
4.2.1.2. L’expression de la durée ..................................115
4.2.2. Le nom : complément du Npeur : .................................116
4.2.2.1. L’expression de la cause.................................116
4.2.3 Npeur coordonné à un nom par et / ni ...........................117
4.2.3.1 Quelques particularités syntaxiques..................119
4.2.3.1.1 La détermination................................119
4.2.3.1.2 Déterminant 0 ....................................120
4.3 Npeur + adjectif : analyse syntactico-sémantique ...................120
4.3.1 Les adjectifs en cooccurrence avec les Npeur ................121
4.3.2 Quelques particularités syntaxiques ..............................122
4.3.2.1 La place de l’adjectif .........................................122
4.3.2.2 Le pluriel............................................................124
4.3.3 Quelques propriétés sémantiques .........................125
4.3.3.1 L’intensité.................................................125
4.3.3.2 L’intériorité...............................................127
4.3.3.3 Appréciation / dépréciation ......................127
4.3.3.3.1 L’aspect positif .........................127
4.3.3.3.2 L’aspect négatif ........................128
4.3.4 Synthèse des propriétés sémantiques des
cooccurrences adjectivales ……………………….128
4.4. Npeur en combinatoire avec quelques adverbes :
analyse syntactico-sémantique...............................................129
4.5. Les collocations imagées .......................................................130
Conclusion partielle ........................................................................... 131
CONCLUSION GENERALE........................................................... 133
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................. 137
ANNEXES (1)
Définitions des Npeur
Corpus du Trésor de la Langue Française
ANNEXE (2)
Corpus du Quotidien (El-Watan)
Université
Sétif2
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
1
/
170
100%