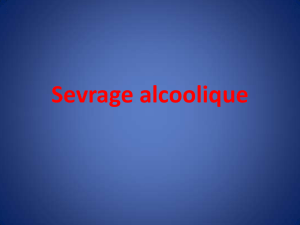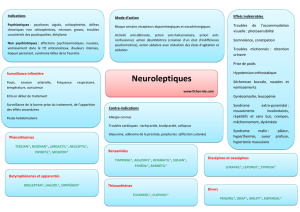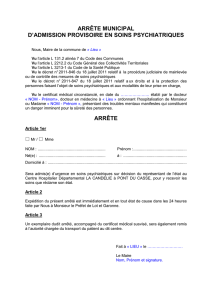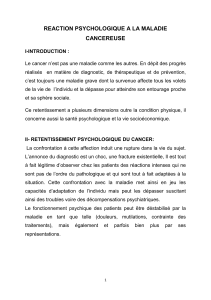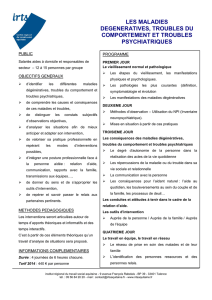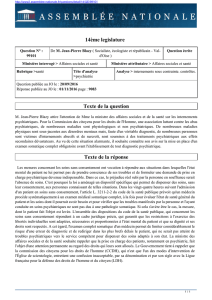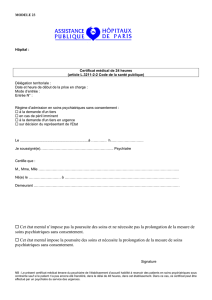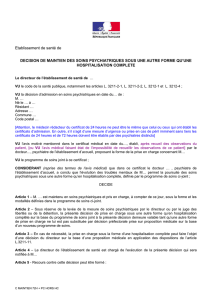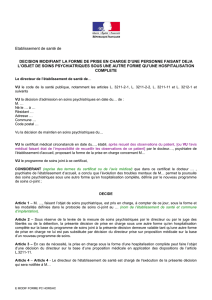Comorbidités psychiatriques associées à la dépendance à l`alcool

CURRICULUM Forum Med Suisse No23 5 juin 2002 562
Introduction
Troubles induits et troubles indépendants
Les personnes qui présentent un syndrome de
dépendance à l’alcool ont plus de risque que la
population générale de présenter des symp-
tômes psychiatriques. Ainsi, près de 50 à 70%
des alcoolo-dépendants ont les critères pour un
trouble psychiatrique majeur [1]. Parmi ces
troubles psychiatriques, Schukit [2] propose de
faire la distinction entre les troubles induits
(tabl. 1) par l’alcool en période d’intoxication
ou dus au sevrage, et les troubles psychiatri-
ques qui sont indépendants de la consomma-
tion d’alcool et des effets du sevrage. Selon le
DSM-IV [3], un trouble mental induit par une
substance est un trouble qui correspond aux
critères diagnostics d’un trouble mental DSM-
IV, mais dont l’apparition a été induite par
la substance. Par exemple, pour retenir le
diagnostic DSM-IV de dépression induite par
l’alcool, les critères d’un trouble dépressif DSM-
IV doivent être remplis.
Pour le pronostic et le traitement cette distinc-
tion est très importante, car si les symptômes
psychiatriques sont apparus en période de
consommation ou de sevrage, ils vont régres-
ser pour la plupart sur une période de 4 à 6
semaines d’abstinence.
Troubles indépendants associés
à la dépendance à l’alcool
Plusieurs troubles psychiatriques indépendants
sont retrouvés plus fréquemment chez les al-
coolo-dépendants que dans la population géné-
rale, ce sont les troubles indépendants associés
[2] à la dépendance à l’alcool; par exemple la
prévalence du trouble bipolaire est de 1% dans
la population générale alors qu’elle est de 4%
chez les alcoolo-dépendants. Les autres trou-
bles associés à la dépendance à l’alcool sont les
Comorbidités psychiatriques
associées à la dépendance à l’alcool
R. Gammeter
Correspondance:
Dr Roland Gammeter
Centre de Traitement d’Alcoologie
clinique d’alcoologie
site de Cery
CH-1008 Prilly
Tableau 1. Troubles induits.
Intoxication alcoolique
Sevrage alcoolique
Delirium par intoxication alcoolique
Delirium du sevrage alcoolique
Démence persistante induite par l’alcool
Trouble amnésique persistant induit par l’alcool
Trouble psychotique induit par l’alcool
Trouble de l’humeur induit par l’alcool
Trouble anxieux induit par l’alcool
Dysfonction sexuelle induite par l’alcool
Troubles du sommeil induits par l’alcool
Figure 1.
Troubles psychiatriques induits
par l’alcool (DSM-IV). Dépendance à l’alcool
50%
Trouble mental
majorité minorité
Troubles induits Troubles indépendants
– Associé au sevrage Troubles associés Troubles
ou à l’intoxication à la dépendance à l’alcool: non-associés
– Ne persiste en général – les troubles de la personnalité à la dépendance
pas au-delà de 4 semaines – les troubles alimentaires à l’alcool
– le trouble bipolaire
– la schizophrénie
– le trouble panique
– la phobie sociale

CURRICULUM Forum Med Suisse No23 5 juin 2002 563
troubles de la personnalité et les troubles ali-
mentaires, la schizophrénie et dans une moin-
dre mesure certains troubles anxieux dont le
trouble panique et la phobie sociale. Ces co-
morbidités psychiatriques indépendantes asso-
ciées à la dépendance à l’alcool sont relative-
ment fréquentes et doivent être reconnues, car
le trouble mental et le trouble lié à l’alcool ont
des répercussions pronostiques négatives l’un
envers l’autre, si l’un des deux n’est pas traité.
La figure 1 schématise ces 3 niveaux de dis-
tinction.
Cet article passe en revue les principaux
troubles psychiatriques qui peuvent être en re-
lation avec à la dépendance à l’alcool et aborde
les principes de base de la prise en charge de
cette comorbidité.
Les troubles de la personnalité
et les troubles alimentaires
Troubles de la personnalité
Les études épidémiologiques montrent une pré-
valence de troubles de la personnalité en cas
de dépendance à l’alcool qui oscille entre 30 et
80% [4], les taux les plus élevés étant obtenus
chez des patients hospitalisés. Ces études ont
infirmé les concepts de personnalité addictive
et celui de personnalité pré-alcoolique des psy-
chanalystes. Il n’existe pas un type particulier
propre aux alcoolo-dépendants, par contre on
peut retrouver dans cette population tous les
types de troubles de la personnalité. La préva-
lence des troubles de la personnalité est sou-
vent surévaluée du fait de la présence surajou-
tée de troubles de l’axe I au début du traite-
ment, ce qui peut biaiser le diagnostic. L’utili-
sation d’un entretien semi-structuré peut per-
mettre d’éviter cet écueil [5].
La personnalité antisociale
La personnalité antisociale mérite une atten-
tion particulière, car c’est un trouble de la per-
sonnalité rare dans la population générale mais
fortement représentée chez les alcoolo-dépen-
dants. La prévalence à vie de la personnalité
antisociale chez les alcoolo-dépendants est
d’environ 15% chez les hommes et de 5% chez
les femmes; elle est 10 fois supérieure à celle de
la population générale [1]. Schuckit [2] recom-
mande une définition restrictive de ce trouble
qu’il applique à des individus présentant des
problèmes antisociaux, débutant avant l’âge de
15 ans, qui consistent en un mépris et une
transgression des droits d’autrui, dans tous les
4 domaines de vie suivants: la famille, l’école,
la justice et les camarades. Ces problèmes
doivent être apparus avant l’installation d’une
dépendance à l’alcool ou aux drogues. Ces per-
sonnes ont un risque plus élevé de polytoxico-
manie et présentent en général un grave par-
cours de délinquance et de violence. Sur le plan
thérapeutique, il faut savoir que les program-
mes de traitement résidentiels ne changent pas
significativement le trouble de la personnalité
antisociale; la philosophie de l’approche réside
dans le fait que moins ce type de patient
consomme, plus réduit sera le risque d’aggra-
vation des problèmes juridiques et sociaux, et
plus élevées seront les chances de maintenir
une certaine insertion sociale.
Alcoolisme et trouble alimentaire
Cette association que l’on rencontre avant tout
chez les femmes est fréquente et doit être re-
cherchée. On peut la trouver avec tous les types
de troubles alimentaires; dans la plupart des
cas l’alcoolisme est secondaire et fait partie in-
tégrante d’un trouble global de la personnalité
qui se situe généralement dans le registre des
états limites.
Les troubles de l’humeur
Le trouble bipolaire
Le trouble bipolaire est 4 fois plus fréquent
chez les alcoolo-dépendants par rapport à la
population générale. Les études qui explorent
l’agrégation familiale des troubles psychia-
triques et des abus de substance vont proba-
blement permettre dans un proche avenir de
faire la part des choses entre l’existence d’un
lien de causalité entre les 2 troubles (la désin-
hibition de la phase maniaque ou hypomane
supprimerait le frein à la consommation d’al-
cool et entraînerait l’alcoolo-dépendance) ou
l’existence d’une vulnérabilité génétique com-
mune entre ces 2 affections.
La dépression
La dépression est très fréquente chez les al-
coolo-dépendants. Une étude montre que 40%
d’entre-eux sont déprimés au moment de l’en-
trée en traitement, mais 4 semaines après un
sevrage hospitalier ce taux chute à 4% sans an-
tidépresseur [6]. Cependant du fait que la pré-
valence à vie de la dépression est de 15% dans
la population générale, une proportion sub-
stantielle d’alcoolo-dépendants va également
développer un épisode dépressif indépendant
du problème d’alcool, qu’il s’agira de traiter.
Une attention particulière doit être donnée aux
idées suicidaires qui sont majoritairement se-
condaires aux distorsions psycho-affectives et
cognitives dues à une consommation massive
d’alcool. Malgré le caractère secondaire de ses
idées suicidaires, elles doivent être considérées
comme le symptôme d’un risque vital car la
prévalence du suicide chez les alcooliques est
8–10 fois plus élevée que celle de la population
générale.

CURRICULUM Forum Med Suisse No23 5 juin 2002 564
Les troubles anxieux
Près de 90% des alcoolo-dépendants n’ont
aucun trouble anxieux indépendant ni induit,
mais plusieurs études ont montré chez cette
population des taux de prévalence à vie de
trouble panique indépendant et de phobie
sociale environ trois fois supérieurs à ceux de
la population générale [1, 7, 8]. A noter que
certains patients décrivent des accès matinaux
d’attaque de panique typique qui sont dus en
fait au sevrage, et qui s’amendent sans traite-
ment spécifique en cas de maintien d’une abs-
tinence prolongée.
Concernant l’état de stress post-traumatique
(PTSD) et l’anxiété généralisée, certaines
études [9] parlent en faveur d’une association
entre ces troubles et l’alcoolo-dépendance,
mais ces résultats doivent être encore confir-
més par d’autres recherches, avant que l’on
puisse effectivement conclure qu’il existe une
association.
Les troubles psychotiques aigus
et la schizophrénie
Syndrome de Wernicke, delirium et
trouble psychotique induit par l’alcool
5% des alcoolo-dépendants vont développer
en cas de forte consommation et parfois en cas
de sevrage un trouble psychotique induit par
l’alcool d’allure paranoïde, qu’il s’agit de dis-
tinguer d’un délirium ou d’un syndrome de
Wernicke; ces 2 derniers troubles se caractéri-
sent notamment par la présence d’une confu-
sion avec désorientation. Les hallucinations du
trouble psychotique induit sont auditives, alors
que dans le délirium ce sont des hallucinations
tactiles et/ou visuelles. Le syndrome de Wer-
nicke est rare, mais il faut néanmoins exclure
la présence de troubles de la mémoire récente
avec confabulation et des signes neurologiques
associés (ataxie, nystagmus, ophtalmoplégie),
car environ un tiers des patients avec un Wer-
nicke vont présenter des troubles mnésiques
durables (syndrome de Korsakoff). Par précau-
tion dans ces 3 cas de figure, un traitement
parentéral de thiamine est de rigueur.
Le trouble psychotique induit peut nécessiter
une hospitalisation pour protéger le patient
contre lui-même et l’usage temporaire d’une
médication antipsychotique. En l’absence d’un
trouble sous-jacent du spectre de la schizophré-
nie, la symptomatologie du trouble psychotique
s’amende généralement en l’espace de quelques
jours à 4 semaines.
La schizophrénie
La majorité des troubles psychotiques chez les
alcoolo-dépendants sont d’origine toxique, mais
il existe néanmoins une co-occurrence particu-
lière entre l’alcoolisme et la schizophrénie.
La prévalence de la dépendance à alcool dans
la population générale est de 5%, mais 20 à 50%
des schizophrènes ont les critères d’abus ou de
dépendance à l’alcool [10].
Les schizophrènes sont également davantage
dépendants de la nicotine (prévalence de 78 à
88% selon les études) et des psychostimulants
(prévalence de 2 à 5 fois supérieure à la popu-
lation générale). Batel [10] a fait une revue ré-
cente de la littérature du problème des abus de
substance chez les schizophrènes et développe
les 2 hypothèses les plus souvent formulées
concernant cette forte association:
1. L’hypothèse d’une prédisposition génétique
commune entraînant l’installation des deux
troubles comme conséquences de mécanis-
mes neurobiologiques.
2. L’hypothèse de l’auto-médication: les schi-
zophrènes recourent aux psychotropes pour
se traiter contre les symptômes négatifs (re-
trait, émoussement affectif …) et déficitaires
de leur maladie.
Les études d’adoption et de jumeaux n’ont pas
pu démontrer de manière consistante un lien
génétique entre l’alcoolisme et la schizophré-
nie. Des études cliniques ont été faites auprès
de patients schizophrènes pour leur demander
quels étaient les effets qu’ils recherchaient à
l’aide des substances consommées (self-report
studies). Ces recherches montrent des résultats
contradictoires, une même substance pouvant
à la fois être considérée comme bénéfique (car
diminuant les symptômes négatifs et les effets
secondaires des neuroleptiques) et comme né-
faste (accentuation du délire et des hallucina-
tions).
Démarche diagnostique
et aspects thérapeutiques
Troubles psychiatriques induits
1. Distinguer trouble induit / trouble
indépendant: Premièrement, en cas de
consommation à problème, le praticien doit
toujours considérer le diagnostic différentiel
d’un trouble induit face à un trouble psy-
chiatrique surajouté. Les troubles induits
étant plus fréquents, il s’agit d’exclure le dia-
gnostic de trouble psychiatrique indépen-
dant. Pour ce faire, il faut s’assurer que le
trouble n’est pas apparu avant l’installation
de l’abus ou de la dépendance, ou durant
une période prolongée d’abstinence, et qu’il
ne persiste pas après l’arrêt de la consom-
mation (délai d’un mois environ).
2. Informer le patient du caractère causal:
Une fois qu’un trouble indépendant a pu être
exclu, le patient doit être informé du carac-
tère induit et temporaire de ses symptômes

CURRICULUM Forum Med Suisse No23 5 juin 2002 565
anxieux, dépressifs ou psychotiques; le trai-
tement est causal. Si nécessaire, une médi-
cation adaptée peut être prescrite temporai-
rement.
3. Etre attentif à la péjoration du trouble
pendant le sevrage: Si le patient accepte
d’entreprendre un sevrage ambulatoire
pour une dépendance par exemple, il faut
également l’informer que les symptômes
(anxieux particulièrement) tendent à être
plus intense durant le sevrage, mais seront
soulagés par la médication et vont s’amélio-
rer rapidement.
Troubles psychiatriques indépendants
Principe de base: chez un consommateur d’al-
cool à risque ou à problème présentant un
trouble psychiatrique indépendant, chacun des
2 troubles doit être pris en charge.
–Le praticien ambulatoire jugera d’en réfé-
rer à des spécialistes selon ses compétences
dans ces différents domaines et la gravité
des troubles en question. Deux exemples: en
présence d’un syndrome de dépendance à
l’alcool chez un patient avec une affection
psychiatrique majeure, une prise en charge
de réseau est indiquée (médecin traitant,
psychiatre, et intervenant du réseau alcoo-
logique spécialisé). Un patient présentant un
trouble panique, qui s’auto-médique avec de
l’alcool sur le mode d’une consommation à
risque, devrait rencontrer un psychiatre et
pourrait bénéficier d’une intervention brève
[11] de la part du praticien.
–Pour la pratique hospitalière, Schuckit
donne les conseils suivants: établir une
solide collaboration entre les équipes d’abus
de substance et les équipes de soins psy-
chiatriques. Il s’agit d’éviter de tomber dans
le piège de considérer que le patient relève
de la responsabilité de «l’autre équipe» ou
que de la responsabilité de «notre équipe».
La responsabilité du patient doit être parta-
gée entre les 2 dispositifs de soins. Ce sont
des situations très difficiles à guérir qui
confronte les équipes à des échecs dans leur
volonté de guérir. Finalement le patient peut
se retrouver implicitement exclut des 2 sys-
tèmes de guérir. Pour éviter cet écueil, les 2
équipes doivent communiquer régulière-
ment et accepter avec les patients les plus
difficiles un niveau de soins bas seuil. Cette
forme de collaboration associée à des at-
tentes réalistes peut apporter de grands bé-
néfices à certains patients.
–La pharmacothérapie de la dépendance à
l’alcool en présence d’une affection psychia-
trique majeure offre plusieurs alternatives.
Chez un patient motivé qui maîtrise son im-
pulsivité, le disulfiram peut être utilisé (ad-
ministration par un tiers neutre) en complé-
ment d’un soutien psycho-social aux condi-
tions suivantes: absence de contre-indica-
tion somatique, absence de psychose aiguë,
de trouble psycho-organique et de dépres-
sion [12]. L’acamprosate qui diminue l’ap-
pétence pour l’alcool et la naltrexone qui
agit en réduisant les effets agréables liés à
la consommation, offrent une meilleure
sécurité d’utilisation chez les patients psy-
chiatriques, excepté le cas de figure parti-
culier des consommateurs d’opiacés pour
lesquels la naltrexone est contre-indiquée.
Conclusion
En présence d’abus de substance, les troubles
psychiatriques peuvent être classé en 2 grandes
catégories: premièrement ceux qui sont induits
par la substance et qui vont régresser durant
les 4 semaines qui suivent l’entrée en traite-
ment; deuxièmement les troubles psychia-
triques indépendants dont un certain nombre
sont plus fréquents chez les alcoolos-dépen-
dants que dans la population générale.
Sur le plan thérapeutique, le traitement du
trouble induit est causal et ne nécessite géné-
ralement pas de médication. Le traitement du
trouble psychiatrique indépendant doit être
confié en général à un spécialiste; le traitement
global s’effectue en réseau et requiert une col-
laboration étroite entre les équipes lors d’hos-
pitalisation.

CURRICULUM Forum Med Suisse No23 5 juin 2002 566
1 Kessler RC, Crum R.M, Warner LA,
Nelson CB, Schulenberg J, Anthony
JC. Lifetime co-occurrence of DSM-
III-R alcohol abuse and dependence
with other psychiatric disorders in
the national comorbidity survey.
Arch Gen Psychiatry 1997;54:
313–321.
2 Schuckit MA. Drug and alcohol
abuse. A clinical guide to diagnosis
and treatment. Fifth edition. New
York; Kluwer Academic/Plenum
Publishers: 2000.
3 American Psychiatric Association-
DSM-IV, Washington DC, 1995.
4 Bailly D, Venisse JL. Addictions et
psychiatrie. Paris, Masson, Méde-
cine et Psychothérapie: 1999.
5 Verheul R, Kranzler HR, Poling J,
Tennen H, Ball S, Rounsaville BJ.
Axe I and axe II disorders in alco-
holics and drug addicts: Fact or
artifact? J. Stud Alcohol 2000;61:
101–10.
6 Schuckit MA, Tipp JE, Bucholz KK.
The life-times rates of three major
mood disorders and four major
anxiety disorders in alcoholics and
controls. Addiction 1997;92:1289–
304.
7 Stein MB, Chartier MJ, Hazen AL.
A direct-interview family study of
generalized social-phobia. Am J
Psychiatry 1998;155:90–7.
8 Chilcoat HD. PTSD and drug disor-
ders: testing causal pathway. Arch
Gen Psychiatry 1998;55:913–7.
9 Batel P. Addiction and schizophre-
nia. Eur Psychiatry 2000;15:115–
22.
10 Daeppen JB, Gammeter R: Inter-
ventions brèves. Med Hyg 2000;58:
2163–6.
11 Wilkins JN. Pharmacotherapy of
schizophrenia patients with comor-
bid substance abuse. Schizophre-
nia Bulletin 1997;23:215–28.
Références
1
/
5
100%