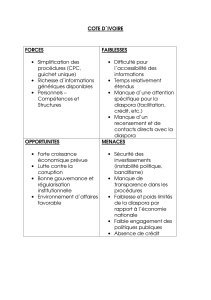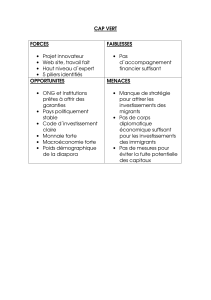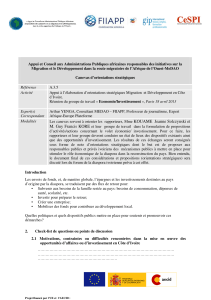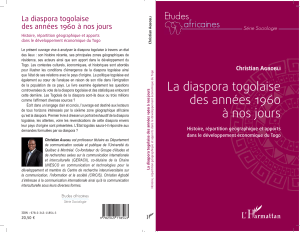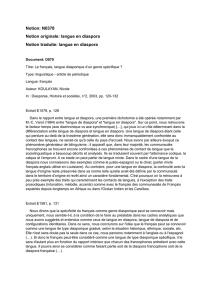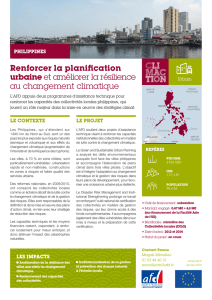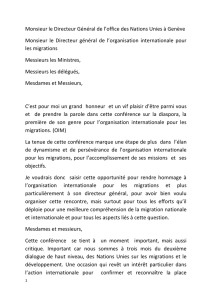Diaspora Philippine : Organisation et Impact Économique

DIASPORA PHILIPPINE
La diaspora des philippines est un cas particulier car c'est la seule diaspora qui est organisée
par son État.
Diaspora est un terme pour décrire tout d'abord un phénomène de dispersion d'une partie d'une
population au-delà de ses frontières nationales. Pour constituer une diaspora, les communautés
d'expatriés doivent cependant conserver des attaches avec le pays d'origine, ou des pratiques ou des
habitudes propres au pays. Ce niveau d'attachement est cependant variable; les liens peuvent être
économiques, politiques ou culturels. Si les liens sont rompus voire inexistants, il ne s'agit pas d'une
diaspora. Les communautés dispersées se donnent souvent des organisations, des porte-parole ou
des rituels permettant le maintien du lien. La dispersion est souvent le fait d'une guerre, d'une
révolution, d'une répression, d'un génocide ou d'un phénomène collectif; la référence à l'événement
déclencheur constitue une composante essentielle de la construction de l'identité des communautés
dispersées.
Cette diaspora est importante. En effet, grâce à elle, les Philippines sont devenues les premiers
exportateurs mondiaux de main-d’œuvre et représentent ainsi, environ 10 millions de travailleurs
migrants (soit 10% de la population).
I/ L’organisation de la diaspora philippine
Implantation
Aujourd’hui, la diaspora philippine se situe principalement aux USA, au Canada, en Australie, au
Japon, au Royaume-Uni ainsi qu’en Allemagne. Par ailleurs, elle est également présente, de
façon temporaire, en Arabie-Saoudite, à Taïwan, à Hong-Kong, et en Italie.
Par exemple, en 2009 : 41.7% des 8 579 3789 philippins travaillaient sur le continent Américain
(dont 33.5% aux USA, 7.4% au Canada) ; 28.2% travaillaient au Proche-Orient ; 8.4% travaillaient
en Europe, et enfin, 12.52% en Asie. (d’après la Commission des philippines expatriés)
L’archipel philippin est le premier exportateur mondial de sa main d’œuvre. En effet, le nombre de
travailleurs migrants s’est considérablement accru ces dernières années. En outre, ces
exportations sont soutenues par les gouvernements.
Histoire, évolution
La diaspora philippine débuta en 1974. Le dictateur de l'époque, Ferdinand Marcos, lança une
politique d'exportation. Le départ de la population est donc planifié par l’État. Le gouvernement est
depuis devenu la première agence de travail temporaire du pays.
notamment après le 1er choc pétrolier de 1973: "départs temporaires"
en 1974: 35 milles d'entre eux étaient embauchés à l'étranger
Cette diaspora a énormément évoluée depuis sa mise en place. Par exemple, le terme
d'Overseas Filipino Workers (OFWs) a été officialisé sous la présidence de Fidel Ramos, pour
reconnaître enfin à des millions de Philippins un statut juridique et économique minimal (garantit
projets_valeurs, être humain). Le statut d'Overseas Contact Workers (OCWs), travailleurs sous
contrat de six mois à trois ans, permet aux consulats de leur venir en aide officiellement. En 1995, le
Migrant Workers and Overseas Filipinos Act reconnaît les difficultés spécifiques auxquelles est
confrontée cette population. En 2001, la présidente Gloria Arroyo déclare le mois de décembre
comme le "mois des travailleurs philippins expatriés". Tenant compte de ces spécificités, le
gouvernement de Manille (région des philippines le plus touchée par l'immigration) a engagé au début
des années 2000 ce qu'il appelle une Labor Diplomacy, qui dicte partiellement sa politique étrangère.
De plus, deux institutions gouvernementales gèrent cette politique à travers leurs nombreuses

agences spécialisées, la Philippine Overseas Employment Administration (POEA) et l'Overseas
Workers Welfare Admnistration (OWWA). Cofinancées par les salariés et les employeurs, ces
institutions gèrent un double réseau: aux Philippines, 14 bureaux répartis sur l'ensemble du territoire
drainent les demandes et régulent officiellement les 1 300 agences privées de recrutement. Ces
agences traitent entre 85 et 95% des personnes voulant migrer; à l'étranger, 27 bureaux coordonnent
les demandes et les flux.
Les raisons qui poussent les philippins et l’État à organiser ce flux migratoire sont diverses. Ils sont en
quêtes d'une vie meilleur, recherchent une meilleure éducation et des meilleurs conditions de travail.
Les philippins quittent leur pays car il existe une crise économique aux Philippines ainsi qu'une
surpopulation. De plus, il y a des problèmes de paix et de sécurité dans ce pays.
En effet, cette volonté de quitter le pays s'explique, à la fois, par la qualité de la main-d’œuvre et par
une situation sociale explosive :
Premièrement, la misère que l'on trouve dans ce pays pousse à la mobilité. Le taux de pauvreté
s'élève à 33,7% en 2000 et un tiers de la population vit avec moins d'un dollar par jour en 2003. De
plus, c'est un pays où les richesses sont très inégalement réparties.
Deuxièmement ,l'augmentation de 2,5% par an de la population active, grâce à la croissance
démographique, entraîne l'arrivée de 800 000 jeunes sur le marché du travail chaque année. Le
chômage officiel touche directement 10,3% de la population active, en particulier les jeunes de 15 à
24 ans (qui en constituent la moitié) et les zones urbaines (deux tiers des chômeurs). On peut y
ajouter les 5 millions d'actifs sous-employés (17% de la population active), aux deux tiers en zones
rurales, à cause d'une structure agraire particulièrement concentrée, héritée de la période coloniale
américaine. L'économie présente encore une structure sectorielle de pays en développement, avec
37% d'emplois dans l'agriculture, contre 15,5% dans l'industrie et 47,5% dans les services.
Troisièmement, il existe aussi une violence sociale et une corruption généralisée. Quelques grandes
familles affairistes contrôlent, à partir de véritables fiefs régionaux, la politique et l'économie, en étroite
relation avec la haute hiérarchie militaire.
Stratégie : Les personnes qui migrent à l’étranger sont généralement désignées par les habitants d’un
village. Elles ont pour objectif de trouver un emploi dans un autre pays et par conséquent de subvenir
aux besoins financiers de ce village.
Par ailleurs, les politiques d’immigration ont également pour but de protéger la population (lors de
catastrophes naturelles…)
La spécificité de la politique d'émigration philippine est de chercher à correspondre le plus possible
dans la demande émanant des pays riches en déficit ponctuel ou structurel de main-d’œuvre.
Attention, les flux, les ressources et les émigrés sont sous la menace permanente. Le pays d’accueil
n’est pas à l’abri d’une détérioration économique ou d’une crise politique.
Exemple : lors de la crise asiatique de 1998, Hong-Kong a réduit de plus d’un tiers les salaires du
personnel domestique étranger.
II/ Les émigrés philippins
Dispersés sur différents territoires,
Composition
Les émigrés philippins exercent différents types de métiers. En effet, certains travaillent comme
domestiques, comme cadres, ou bien dans le secteur médical (notamment au Royaume-Uni)…
En outre, deux grandes catégories de main d’œuvre se dessinent. Parmi elles, on compte : les
seabased marins, localisés en grande partie au Japon (1er employeur) et les landbased salariés sous-
contrat à terre. Par exemple, dans les années 2000, il y avait environ 205 milles seabased et environ
662 milles landbased.

Par ailleurs, aujourd’hui ¼ des flux est constitué de personnes qualifiées, ce qui entre autre accentue
les difficultés de l’économie du pays (Philippines) et, chaque année, plus de 100 milles philippins
s’exilent pour œuvrer dans le secteur des services.
Les émigrés philippins appartiennent en majorité à la catégorie des 25-45ans. De plus, sur ces
dernières années (de 35 à 10ans), le flux migratoire s’est transformé en un mouvement à forte
dominance féminine, 8millions et demi de philippins. Les femmes immigrées occupent principalement
les emplois non-qualifiés féminisés (domestique…).
Economie
D’un point de vue économique, ces travailleurs philippins ont permis à leur pays de se développer. En
effet, en 2010 (selon la Banque Mondiale), les expatriés assuraient 12% du PIB philippin, soit environ
21 milliards de dollars. Par ailleurs, en 20ans les transferts annuels (des émigrés) sont passés de 357
à 5 365 millions de dollars, (selon la Banque centrale des Philippines).
Par ailleurs, d’après le graphique :
- Les transferts financiers ont été multiplié par 54, en 22ans. Ils sont passés de 0.1 milliard de
dollars à 5.4 milliards de dollars.
- La croissance s’est accélérée vers 1994, et a atteint un maxima vers 1999 (croissance rapide,
*3) en parallèle avec l’augmentation du nombre de travailleurs migrants, évolution de la
diaspora.
De plus, on constate que 72% des transferts financiers proviennent de l’Amérique, que 12.5%
proviennent de l’Asie et que 6% des transferts financiers proviennent du Moyen-Orient.
Ces estimations placent les Philippines au 4ème rang mondial en ce qui concerne les transferts issus
de l’émigration, derrière la Chine, l’Inde, et le Mexique.
Culture / liens
Le lien social entre les migrants et le reste du pays est très peu développé même si les
télécommunications permettent aux familles de rester en contact. De plus, afin de renforcer des liens
politiques, économiques ou encore culturel, une commission d’expatriés philippins a été créée en
1980. Il s’agit d’une agence gouvernementale chargée de promouvoir et de défendre les intérêts des
philippins à l’étranger et également de renforcer les liens avec les communautés à l’étranger. Par
ailleurs, cette commission a lancé un programme : « Arts et culture exchange » dans le but de
maintenir une identité culturelle. Pour atteindre cet objectif, la CFO (commission d’expatriés philippins)
souhaite développer des entreprises, instaurer/mettre en place un tourisme culturel dans les différents
pays d’accueil (d’autant plus que cette stratégie serait/est bénéfique à la fois aux pays d’accueil et aux
migrants).
Toutefois, bien que la culture soit importante pour les philippins, elle reste peu marquée. En effet, les
Philippines restent un pays divisé, notamment à cause du nombre de langues qui y est parlées (+ de
100 langues parlées, la principale étant le tagalop filipino). De plus, on peut observer un isolement
entre les villages et les îles qui composent le pays. C’est pourquoi les migrants n’ont pas gardé une
forte identité culturelle de leur pays d’origine. Ils ont cependant conservé des traditions religieuses _
leur religion étant le christianisme.
Intégration
L’intégration dépend du pays d’accueil (et de la catégorie sociale).

Aujourd’hui, 2.55 millions des philippins sont devenus des résidents par acquisition d’une carte de
séjour longue durée, par naturalisation ou par mariage.
La langue est un facteur essentiel. Elle est souvent à l’origine de leur bonne intégration. En effet,
grâce à la forte présence américaine :
_ d’abord sous forme coloniale de 1898 à 1945
_ puis sous forme de quasi-protectorat jusqu’à nos jours (pour des raisons stratégiques)
l’anglais prédomine dans l’administration, les médias, l’enseignement. Cette situation se révèle être un
atout pour trouver du travail à l’étranger, notamment.
De plus, on sait aussi que les infirmiers exerçant en Angleterre se sont bien intégrés et vivent dans de
bonnes conditions.
Par ailleurs, en Israël, l’intégration se fait de façon rapide. Effectivement, il y a des enfants qui se sont
bien adaptés puisqu’ils participent à des concours de chant (par exemple) où ils chantent dans la
langue locale. En outre, les philippins peuvent obtenir le statut d’israélien s’ils travaillent dans l’armée
un certain temps et s’ils parlent l’hébreux.
En outre, le Canada est un pays qui s’investit beaucoup dans l’intégration des immigrés, en particulier
depuis le Typhon.
Récemment, le 8 novembre 2013 une catastrophe naturelle est survenue aux Philippines (= cyclone).
Il s’agissait d’une succession de vagues géantes, de vents à plus de 300km/h.
Csq : effet dévastateur, familles, villages anéantis, détruites.
Pour soutenir les Philippines, des appels aux dons ont été lancés, notamment par l’UNICEF. Mais
également, on a incité les populations à migrer vers un pays étranger. Par exemple, le Canada leur a
ouvert ses frontières. L’ambassade fournit une gamme complète des services de visa, d’immigration
et de passeport (=pays d’accueil ouvert).
Tout comme le maintien culturel, l’intégration des immigrés philippins dans les pays étrangers n’est
pas toujours évidente. Aujourd’hui, près de 3millions des travailleurs sont des travailleurs temporaires
(témoigne d’une situation pas très stable). De plus, la vie des travailleurs migrants semble quelquefois
difficile.
exemple, Le Monde Diplomatique.
Sources : Le Monde Diplomatique _
http://translate.google.com/translate?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dcommission%2Bdes%2Bphilippins%2Bexpatri%25
C3%25A9s%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3DnE6%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26channel%3Dfflb%26biw%3D833%26bih%3D742&rurl=translate.google.fr&
sl=en&u=http://artsandcultureexchange.cfo.gov.ph/index.php/about _
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/communiques/2013/2013-11-14a.asp
Laurent Carroué : « Alternatives économiques » n°215 (06/2013) ENS Lyon
1
/
4
100%