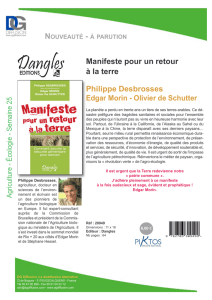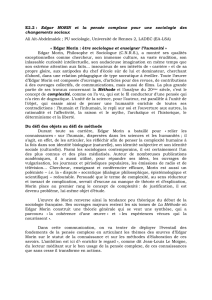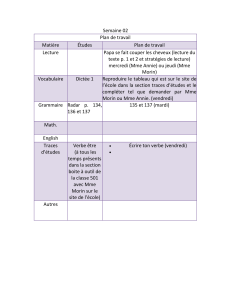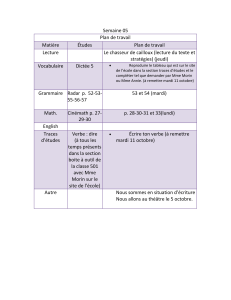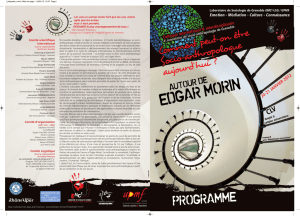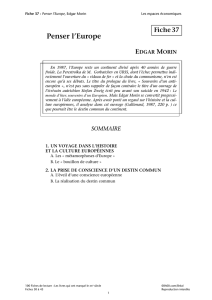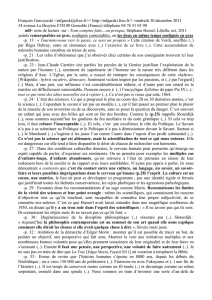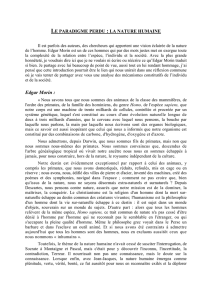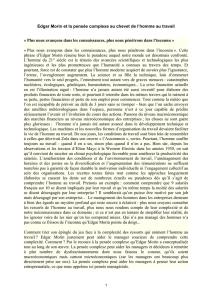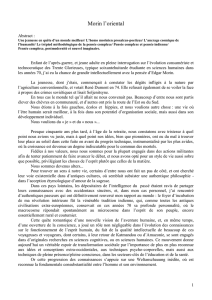De L`ŒUVRE au CYCLE PEDAGOGIQUE d`Edgar MORIN

1
DE L’ŒUVRE AU CYCLE PEDAGOGIQUE D’ EDGAR MORIN
par
Françoise BIANCHI
« El camino se hace al andar. »
Antonio Machado
Dans sa dédicace à Relier les connaissances, Edgar Morin m’écrivait :
Voici « la deuxième partie de mon cycle pédagogique ; la troisième arrive. » Et dans l’Avant-
propos, il présente Les Sept savoirs comme « l’ultime d’une trilogie pédagogique »1.
Cette œuvre immense, qui débute à la moitié du XX°siècle, trace donc ainsi, après les six tomes
de la Méthode, un chemin vers un « enseignement éducatif »2.
On peut bien sûr faire remarquer, d’entrée de jeu, que tous les grands écrivains, particulièrement
ceux que l’on rattache en France au genre de la littérature d’idée Ŕ « littérature à caractère
philosophique ou philosophie à caractère littéraire »3- , genre transdisciplinaire par nature, se sont
essayés, à un moment ou à un autre de leur œuvre, à cette réflexion sur l’enseignement et
l’éducation, comme fleuron de la pensée, en somme l’apothéose de la transmission. On peut
encore souligner que parmi ceux-la, ceux que retient Edgar Morin, Montaigne notamment
auquel renvoie explicitement le titre La Tête bien faite de la trilogie pédagogique, furent à la fois les
témoins et les acteurs d’une époque de crise et de métamorphose mais aussi d’enthousiasme, un
contexte culturel, celui de la Renaissance, qui n’est pas sans lien avec le nôtre.
1 Edgar Morin, Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, Paris, Seuil, septembre 2000, p. 7.
2 Edgar Morin, La Tête bien faite, Paris, Seuil, mai 1999, p. 11.
3 François L’Yvonnet, « La Littérature d’idée » in Relier les connaissances. Le défi du XX° siècle, Paris, Seuil, octobre 1999,
p. 255.
Lors du Colloque de Viseu «
Complexité, Valeurs et Education du Futur, autour de l
‘œuvre d’Edgar Morin
» organisé par ‘l’Instituto Piaget’ le 22 Mai 2009 pour son trentième
anniversaire sur son Campus Universitaire avec la participation d’Edgar Morin, notre amie
Françoise BIANCHI a présenté une étude particulièrement intéressante sur la formation du ‘chemin
vers un « enseignement éducatif à travers l’œuvre immense d’Edgar Morin. Peut-on l’introduire en
évoquant quelques lignes de son introduction ? :
Dans sa dédicace à
Relier les connaissances
, Edgar Morin m’écrivait : Voici « la deuxième partie de
mon cycle pédagogique ; la troisième arrive. » Et dans l’Avant-propos, il présente Les Sept savoirs comme « l’ultime
d’une trilogie pédagogique »1. Cette œuvre immense, qui débute à la moitié du XX°siècle, trace donc ainsi, après les
six tomes de la Méthode, un chemin vers un « enseignement éducatif …. Je souhaiterais plutôt interroger la genèse du
cycle pédagogique morinien, les jalons qui figurent dans l’œuvre antérieure, les racines de ces propositions dans l’œuvre et
la vie d’Edgar Morin, sans en oublier l’objectif général, les finalités - et j’examinerai le contenu de cette trilogie :
La
Tête bien faite
(mai 1999),
Relier les connaissances
(octobre 1999),
Les Sept savoirs nécessaires
à l’éducation du futur
(septembre 2000). … ;
Nous remercions Françoise Bianchi et nos amis portugais de l’Instituto J Piaget de leur accord pour
donner ici à nos lecteurs la primeure de cette vivifiante reliance de la genèse de l’Œuvre et de la
formation d’un ‘enseignement éducatif’.

2
Ainsi, après Rabelais, au chapître VIII de Pantagruel (1532), puis aux chapîtres XXIII et XXIV de
Gargantua (1534), qui récuse et raille un enseignement scolastique sclérosé car fondé sur la
mémoire et la répétition, et qui met au contraire en scène le rêve d’une connaissance universelle
et totale débouchant sur une formation morale, Montaigne, à son tour, dans le chapître XXVI du
Livre I des Essais (1580), « De l’institution des enfants », souligne la nécessité non pas d’enseigner
beaucoup de choses, mais d’apprendre à l’élève à réfléchir et de développer son intelligence et sa
personnalité ; tout le monde connaît quelques citations emblématiques tirées de ce célèbre
chapître : « savoir par cœur n’est pas savoir - instruire, c’est former le jugement Ŕ », Montaigne
préconisant la recherche de méthodes nouvelles, et on notera au passage que c’est à l’enseignant
qu’il souhaite une « tête bien faite » : « je voudrais aussi qu’on fût soigneux de lui choisir un
conducteur qui eût plutôt la tête bien faite que bien pleine », pour ajouter tout de suite que les
deux sont nécessaires mais surtout la valeur morale. Enfin on connaît, au temps des Lumières, le
retentissement de l’œuvre de Rousseau, Emile (1762), pour le meilleur et pour le pire, et se
souvient-on que Diderot lui-même avait conçu un Plan d’université pour le gouvernement de la Russie,
dans lequel il assignait à l’artiste une fonction d’édification morale et de propagande !
Edgar Morin se présente d’ailleurs très tôt, dès Le Vif du sujet, comme « fils de Montaigne et de
Rousseau »4 :
« Je me trouve dans la tradition de mes deux classiques bien-aimés (avec Pascal), Montaigne et
Rousseau. Du premier, et en dépit du discrédit jeté par les sciences de l’homme, en leur premier
siècle débile, sur les vertus de l’introspection, je tiens le sentiment que la plongée en soi débouche
sur l’humaine condition, surtout lorsque l’auto-scaphandrier est faiblement déterminé, cloisonné,
spécialisé.[…] De Rousseau qui se tint au foyer central de la science de l’homme, de la doctrine
politique, de la sensibilité moderne, de l’âme et de la rêverie, je tiens l’évidence d’une connexion
mystérieuse entre les diverses dimensions de notre existence, en même temps que cet irrésistible
exhibitionnisme que nous nommons, quand il vient de nous, sincérité. »5
Ou encore plus loin toujours dans Le Vif du sujet : « à quinze ans, ce qui me fascinait, c’était Les
Essais de Montaigne. »6
Tout est dit de cette filiation, ou presque ; et on aura déjà noté la parenté de vocabulaire et des
préoccupations à quelques quarante ans de distance, puisque Edgar Morin aura largement
pratiqué non seulement la science de l’homme, mais aussi très largement l’introspection - la
diversité de son œuvre en témoigne - et dorénavant l’utopie éducative Ŕ utopie au sens
étymologique du terme comme il le rappelle lui-même, ce qui n’ existe encore en aucun lieu 7-.
Mais notre propos ne vise pas ici à situer exactement Edgar Morin dans cette tradition
philosophique et didactique pour aussi pertinente qu’elle soit. Je souhaiterais plutôt interroger la
genèse du cycle pédagogique morinien, les jalons qui figurent dans l’œuvre antérieure, les racines
de ces propositions dans l’œuvre et la vie d’Edgar Morin, sans en oublier l’objectif général, les
finalités - et j’examinerai le contenu de cette trilogie : La Tête bien faite (mai 1999), Relier les
connaissances (octobre 1999), Les Sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur (septembre 2000), à
laquelle il faudrait ajouter Dialogue sur la connaissance. Entretiens avec des lycéens, conçus et animés par
Bernard Paillard et Alfredo Pena-Vega (2002), ainsi que Eduquer pour l’ère planétaire avec Raoùl Motta et
Emilio-Roger Ciurana (2003), comme praxis de cette vision d’un « enseignement éducatif », mais
que je n’étudierai pas ici en détail.
4Edgar Morin,Le Vif du sujet, Paris, Seuil, 1969, réed. Points Seuil, 1982, Post-préface, p. 11.
5 Ibid.p. 11.
6 Ibid, p. 326.
7 Edgar Morin, Vers l’abîme ? Paris, L’Herne, 2007, p. 131, repris de « Réalisme et utopie », Diogène,n°209, 2005,
rééd.

3
La genèse
Bien que, jeune lycéen, il ait envisagé de devenir professeur, Edgar Morin n’avait pas de vocation
d’enseignant. Dans les années 1946 et suivantes, après le succès de L’An zéro de l’Allemagne, puis
l’échec de L’Allemagne notre souci, outre l’entrée dans l’écriture avec la rédaction de plusieurs
romans, Une Cornerie (1947) et L’Ile de la mort (non publié) notamment8, se pose à lui la question
du métier, bien qu’il soit alors journaliste dans divers périodiques. Il avoue dans Autocritique
(1958) :
« Je n’envisageais aucune carrière dans la vie bourgeoise [ … ]. J’aurais eu vraiment honte et
dégoût de travailler dans la presse bourgeoise. Je me serais senti coupable d’être bien payé. Je ne
voulais pas non plus devenir un petit professeur, courbé sous le joug du métier jusqu’à la
retraite. »9
Et je n’étudierai pas ici les connotations du vocabulaire qui ne sont guère flatteuses… C’est
Violette Morin, sa première épouse, qui assure alors des remplacements dans quelques lycées
parisiens.
On est dès lors fondé à se demander quand apparaît dans cette pensée en construction la
nécessité de réfléchir à la conception d’une éducation du futur.
Le premier jalon explicitement mentionné se situe dans Introduction à une politique de l’homme, en
1965. L’ouvrage est dédié à ses filles qui ont alors 17 et 18 ans et se préparent aux épreuves du
baccalauréat. Mais ce texte court figurait lui-même au chapître « Méandre » d’un livre, Le Vif du
sujet, publié plus tardivement, en 1969, et où l’on voit émerger la construction d’une
anthropocosmologie dont l’anthropolitique est une dimension, la pensée complexe ne disant pas
encore vraiment son nom, bien que nécessitée par la vision du monde qu’élabore l’écrivain. C’est
donc dans le contexte d’une méditation qui le conduit à repenser le monde et l’homme
qu’émerge logiquement l’exigence de repenser l’éducation, afin de « constituer une politique du
développement de l’être humain. »10
Dans Introduction à une politique de l’homme, l’auteur constatait que « la planète est livrée à une
révolution déchaînée » dont il se demandait ce qu’elle est : « Désintégration ? Nouvelle genèse ?
Métamorphose ? »11 C’est la science qui est partie prenante de ce devenir car « elle tend de plus
en plus à se confondre avec l’aventure humaine dont elle est issue »12, d’où la nécessité d’un
néoscientisme comme « composante radicale de l’anthropologie »13écrivait-il :
« Nous sommes à l’aube du troisième millénaire, c’est-à-dire du deux millionnième anniversaire
de l’humanité. Nous sommes entre deux mondes, l’un pas encore mort, l’autre pas encore né. Il
nous faut discerner le périlleux parti de l’anthropolitique dans cette gestation tourbillonnante,
dans ce chaos où destruction est création, création destruction, où toutes les forces sont
ambivalentes, y compris la conscience. La survie est désormais liée à une renaissance, le progrès à
un dépassement, le développement à une métamorphose. »14
Et on aura reconnu les accents messianiques d’œuvres plus tardives, Pour sortir du XX° siècle
(1980) ou Terre-Patrie (mai 1993) notamment, pour ne rien dire de plus récentes comme Vers
l’abîme ?( 2007) en particulier.
8 Françoise Bianchi, Le Fil des idées, une éco-biographie intellectuelle d’Edga Morin, Paris, Seuil, 2001, ch. 7 et 8 ; trad. en
portugais de Joana Chaves, Instituto Piaget, coll. Historia e biografias, Lisboa, 2003.
9 Edgar Morin, Autocritique, Paris, Seuil, 1970, coll. « Politique », 1975, p. 75.
10 Edgar Morin, Introduction à une plitique de l’homme, Paris, Seuil, 1965, coll. Points Seuil Politique, 1980, p. 12.
11Ibid. p. 30.
12 Ibid. p. 46.
13 Ibid. p. 47.
14 Ibid. p. 125.

4
Afin d’accompagner cette nouvelle étape de « l’hominisation de l’homme »15, Edgar Morin
proposait donc d’ « opérer sur tous les fronts, [de] repenser totalement le problème dit de
l’éducation » et il ajoutait : « (une étude Ŕ contribution à un Nouvel Emile - viendra là
dessus) ».16
Et d’ailleurs, il n’est pas un tome de La Méthode qui ne revienne, bien des années plus tard, sur la
nécessaire réorganisation des savoirs :
« Ce qui est vital aujourd’hui, ce n’est pas seulement d’apprendre, pas seulement de réapprendre,
pas seulement de désapprendre, mais de réorganiser notre système mental pour réapprendre à
apprendre »17, écrit-il dès le tome 1, en 1977.
On trouverait ainsi d’autres jalons dans toutes les autres œuvres. Ainsi, par exemple, dans Terre-
Patrie, en 1993 :
« Bien entendu, la réforme de pensée nécessiterait une réforme de l’enseignement (primaire,
secondaire, universitaire) qui elle-même nécessiterait la réforme de pensée. »18
Les échos des œuvres sont évidents, au point qu’à trente ans de distance, dans l’Avant-propos de
La Tête bien faite, Edgar Morin souligne lui-même aujourd’hui aussi la continuité souterraine de sa
réflexion :
« J’avais, sur la suggestion de Jack Lang alors ministre de l’Education (1994), énoncé ‘quelques
notes pour un Emile contemporain’. J’avais envisagé un ‘manuel pour écoliers, enseignants et
citoyens’, projet que je n’ai pas abandonné . »19
Dès Le Vif du sujet donc, une œuvre rédigée en 1962/1963 Ŕ et dont Introduction à une politique de
l’homme n’était qu’un chapître -, figurait déjà la première mention du besoin de repenser
l’éducation, puisque dorénavant il était devenu manifeste que la cosmologie contemporaine
participait d’une anthropocosmologie. Au chapître « Anhropo-cosmologie » il écrivait :
« Thèse de départ : tout ce qui est cosmologie concerne essentiellement l’homme, tout ce qui est
anthropologie concerne essentiellement le cosmos. »20
Et j’en profite pour reprendre la métaphore de lecture du travail d’Edgar Morin que j’avais
proposée au colloque de Cerisy (1986), celle de l’hologramme : récusant l’apparente diversité de
l’ensemble, j’insistais au contraire sur « l’unité profonde de sa multiplicité »21, rappelant que
« l’image holographique est constituée de points (les parties) qui sont chacun, en même temps
qu’un fragment singulier d’un tout, le porteur de l’information quasi totale que représente
l’hologramme. »
On peut dire dans cette perspective que Le Vif du sujet contenait l’ensemble de l’œuvre à venir en
gestation, y compris les plus autobiographiques, même si chacune des suivantes visera à déployer
toutes les potentialités d’un point de vue sur une problématique spécifique.
Dans cet ouvrage encore, au chapître « Emile et Moïse », et dans le paragraphe « l’éducation
perdue et retrouvée », Edgar Morin poursuivait :
« Tout l’effort pour faire évoluer, améliorer l’homme nous renvoie au problème de l’éducation,
lui-même renvoyé aux orties, par Marx. »
15 Ibid. p. 31.
16 Ibid. p. 124.
17 Edgar Morin, La Méthode 1, La Nature de la Nature,Paris, Seuil, 1977, p. 20.
18 Edgar Morin, Terre-Patrie, Paris, Seuil, 1993, coll. « Points », 1996, p. 197.
19 Edgar Morin, La Tête bien faite, op. cit. p. 9.
20 Edgar Morin, Le Vif du sujet, op. cit. p. 327.
21 Françoise Bianchi, « Lecture hologrammatique de l’œuvre d’Edgar morin », in Colloque de Cerisy, Arguments pour une
méthode, Paris, Seuil 1986, p. 11.

5
Et mentionnons au passage la lecture possible de l’œuvre entière comme dépassement et
recadrage des anthropologies marxiste et freudienne dont l’analyse occupe d’ailleurs toute la
première partie de l’ouvrage…
Il ajoutait :
« Je ne discuterai ici ni des possibilités, ni des limites de l’action éducative, ni de la crise actuelle
de tout le système d’enseignement. [ … ] J’éliminerai la question, à mon avis technique dans son
principe de l’acquisition et de l’accumulation du savoir, qui sera résolue [ … ]. Je repousserai
également le problème qui m’a toujours préoccupé, de la nécessaire contradiction entre l’activité
autodidacte, qui tend à rejeter la pédagogie, et la pédagogie, qui tend à asphyxier l’auto-
didactisme.
Je m’en tiens à la question de principe. Les humanités constituaient un savoir systématique à
partir duquel se dégageaient les normes de ‘l’honnête homme’. Aujourd’hui ces humanités sont
en complète obsolescence et le vide n’est nullement rempli par les disciplines scientifiques. Le
problème central est celui de ‘nouvelles humanités’ qu’il faut songer à élaborer avant que
d’enseigner, d’où la crise actuellement sans issue de l’enseignement. »22
Le constat date, je le rappelle, de 1962/1963 ; on aura noté la similitude du vocabulaire qu’on
retrouve inchangé dans la trilogie pédagogique, et enfin le chemin, c’est-à-dire au sens
étymologique la méthode, entrevus pour refonder l’éducation, toujours dans Le Vif du sujet :
« Thèse 1 : Seule l’anthropo-cosmologie (c’est-à-dire une perspective éclairant l’ensemble des
sciences de l’homme et de la nature, posant leur problématique) peut constituer la clé de voûte
des nouvelles humanités.
Thèse 2 : une nouvelle pédagogie de la personne doit être instituée.
D’où quelques principes :
1. L’anthropo-cosmologie ne doit pas être le couronnement terminal (classe de philo) du
secondaire, mais doit être le principe interrogatif d’où rayonne l’enseignement de
l’instituteur.
2. Un enseignement fondé sur l’analyse de la pensée et l’élucidation du vécu doit être
également entamé dès l’éducation primaire et doit être poursuivi sans relâche tout au long
du cycle pédagogique. [ … ]
3. La formation de la personne doit être tentée, non par l’endoctrinement moral, mais par
l’effort continu pour développer »23 ce qu’il nommait plus haut « la conscience auto-
critique. »24
On l’aura compris cette méditation, comme il la nomme alors, brosse la fresque de l’ensemble de
l’œuvre à venir et de ses multiples dimensions, anthropologique, politique, épistémologique,
éthique, culturelle et en dernier ressort éducative. Il aura fallu un détour de près de quarante ans
pour que l’œuvre entière fonde conceptuellement, avec les six tomes de La Méthode, sans compter
les autres ouvrages qui l’accompagnent, cette anthropocosmologie et cette anthropolitique dont
le philosophe posait la nécessité du principe dès les années soixante, avant que la boucle de
l’œuvre ne se replie sur elle-même en spirale, pour s’ouvrir sur la révolution de l’éducation
comme début et couronnement de l’anthropologie générale qu’elle construit depuis toujours.
N’écrivait-il pas dans le Vif du sujet encore :
22 Edgar Morin, Le Vif du sujet, op. cit. p. 291.
23 Ibid., p. 291, 292.
24 Ibid., p. 199.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%