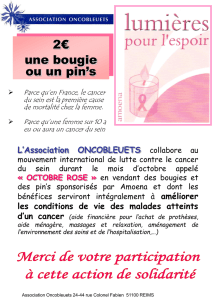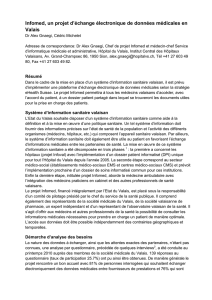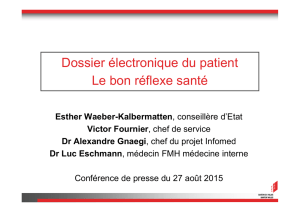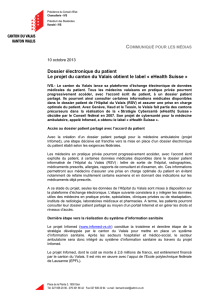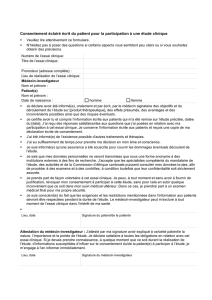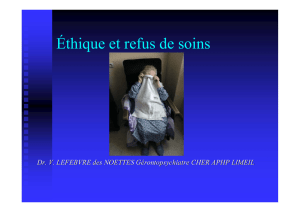Infomed: dossier patient partagé en Valais

31
Proceedings 2011
Swiss Medical Informatics 2011; no 72
Objectifs
La mise en œuvre du système d’information sanitaire doit
répondre à deux objectifs stratégiques: améliorer la prise
en charge des patients et fournir des informations pré-
cises sur l’état de santé de la population et l’activité des
différents organismes (médecins, hôpitaux, etc.) qui com-
posent l’appareil sanitaire valaisan.
1. Améliorer la prise en charge des patients grâce
à un accès facilité à l’information
Il s’agit d’offrir aux médecins et aux autres profession-
nels de la santé la possibilité de consulter les informations
médicales nécessaires pour prendre en charge un patient
de manière optimale. L’accès aux données doit être pos-
sible indépendamment des contraintes géographiques et
temporelles.
2. Etat de santé de la population et activité médicale
ambulatoire
Ce deuxième objectif stratégique du projet Infomed ré-
side dans l’obtention de données sur l’activité médicale
ambulatoire. Alors que l’on dispose d’informations très
précises dans le secteur hospitalier au travers de la sta-
tistique médicale de l’Office fédéral de la statistique, force
est de constater l’absence quasi complète de données sur
le secteur ambulatoire.
Ces objectifs seront réalisés par la mise en place d’un dos-
sier patient partagé (DPP).
Le projet concerne en principe tous les établissements sa-
nitaires situés en Valais qui figurent dans le tableau 1.
En outre, l’échange de données avec d’autres institutions
sanitaires extra cantonales doit être possible dans le cadre
des spécifications prévues par la stratégie eHealth de la
Confédération [3].
Summary
The project Infomed is part of the strategy of the health
information system in the canton of Valais. It aims to im-
plement a shared electronic patient record according to
the recommendations of the Confederation eHealth strat-
egy. Its two main goals are firstly to improve the manage-
ment of patients by sharing medical data, and secondly
the provision of indicators about the health status of the
population. These objectives involve taking special atten-
tion of the patients’ consent. In the absence of insurance
cards containing an X509 certificate, a temporary solu-
tion based on a PIN code has been developed. The project
is divided into several phases to gradually integrate the
various components into the system. The first pilot phase
will be put into production in early 2012.
Introduction
L’Etat du Valais souhaite disposer d’un système d’infor-
mation sanitaire comme aide à la définition et à la mise
en œuvre d’une politique sanitaire [1]. Cette informatisa-
tion du système sanitaire valaisan a été décomposée en
3 phases:
1. l’informatisation des hôpitaux (projet Infoval) qui a
vu l’implémentation d’un dossier patient informatisé
unique à tous les sites de l’Hôpital du Valais (ancienne-
ment RSV) et ceci depuis 2005.
2. l’informatisation du secteur médico-social, établisse-
ments médico-sociaux (EMS) et centres médico-sociaux
(CMS) qui a vu l’implémentation d’un système d’infor-
mation administratif commun en 2010, et qui prévoit
un système d’information clinique en 2011.
3. l’intégration de la médecine ambulatoire (projet Info-
med) qui prévoit la collaboration avec les cabinets des
médecins praticiens ainsi que les autres institutions sa-
nitaires valaisannes non intégrées dans les précédant
projets.
La dernière étape, Infomed, à fait l’objet d’une étude sur
les besoins des différents acteurs
du système ainsi que les données à
échanger [2]. Sur cette base, la stra-
tégie de mise en place du projet Info-
med, ainsi que les contraintes tech-
niques et sécuritaires, ont pu être
définies.
Infomed – dossier patient partagé en Valais
Cédric Michelet, Frédéric Fragnière, Alex Gnaegi
Service d’informatique médicale et administrative (SIMA), Institut Central des Hôpitaux Valaisans, Hôpital du Valais, Sion
Correspondance:
Cédric Michelet
Service d’informatique médicale et administrative
Institut Central des Hôpitaux Valaisans
Av. Grand-Champsec 86
CH-1950 Sion
cedric.mic[email protected]
Les auteurs n’ont pas
déclaré des obligations
financières ou personnelles
en rapport avec l’article
soumis.

32
Proceedings 2011
Swiss Medical Informatics 2011; no 72
Matériel et méthodes
L’échange de données et documents médicaux s’effectue
sur la base d’une plateforme qui doit respecter les prin-
cipes et recommandations préconisées par l’association
IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) et par la stra-
tégie cybersanté de la Confédération. Par plateforme, on
entend une application informatique capable d’intégrer
des documents et données provenant d’autres applica-
tions, ainsi que de rendre disponible cette information
aux personnes ou applications informatiques autorisées.
La plateforme contient également un portail Internet per-
mettant aux utilisateurs concernés de consulter les divers
documents par l’intermédiaire d’un navigateur web, sous
réserve des droits d’accès. La plateforme s’appuie sur un
serveur d’identité qui permet d’assurer une identification
univoque du patient.
Après analyse approfondie, il a été décidé de faire l’acqui-
sition d’une plateforme commercialisée en lieu et place
d’un développement en interne.
Résultats
Le projet est décomposé en 6 étapes en fonction de l’ana-
lyse des besoins et des contraintes technologiques et juri-
diques, permettant ainsi une intégration progressive des
différents acteurs.
Etape 1 – transfert des données médicales hospita-
lières vers les cabinets médicaux
L’objectif est de mettre à disposition des médecins prati-
ciens l’information issue du dossier patient informatisé
(DPI) de l’Hôpital du Valais. Dès la validation d’un docu-
ment, celui-ci est envoyé depuis le DPI hospitalier à la
plateforme Infomed au format HL7 CDA-CH [4] à un des-
tinataire spécifique. Le document peut ensuite être im-
porté dans le dossier patient électronique du destinataire
ou être consulté sur le portail. Seuls les destinataires des
documents peuvent consulter ou importer les documents
CDA.
Etape 2 – transfert de données médicales entre parte-
naires médicaux
En proposant aux autres acteurs de contribuer à l’échange
de données médicales, l’étape 2 doit intégrer les données
médicales des cabinets, ainsi que des autres institutions
sanitaires comme les cliniques privée et de réadaptation,
ainsi que les laboratoires d’analyses médicales et patho-
logie et les instituts d’imagerie médicale. En fonction du
degré d’informatisation du dossier médical du partenaire
concerné, il est proposé plusieurs méthodes. S’il dispose
d’un DPI, celui-ci peut s’interfacer avec la plateforme In-
fomed pour recevoir ou émettre des documents CDA. Si le
partenaire n’est pas équipé d’un DPI, il peut passer par le
portail web Infomed pour ajouter des documents via un
formulaire permettant l’ajout d’un fichier par exemple en
format PDF.
Etape 3 – accès aux données médicales par les
médecins
L’étape 3 est une étape décisive dans le projet Infomed
car elle permet aux médecins d’accéder aux documents
médicaux même s’ils ne font pas partie des destinataires
originaux d’un document. Sous réserve des droits d’ac-
cès, le médecin peut accéder à tous les documents relatifs
à son patient. Un véritable dossier patient partagé sera
ainsi créé. Le consentement explicite du patient pour l’ac-
cès aux documents médicaux le concernant par des per-
sonnes qui n’ont pas été désignées comme destinataires
du document doit être obtenu pour cette étape. Une solu-
tion dite de «vitre brisée» permettant aux médecins d’ac-
céder aux données en cas d’urgence doit également être
implémentée.
Figure 1
Acteurs du dossier patient partagé.
Tableau 1
Etablissements et institutions sanitaires concernés par le projet
Infomed.
l’Hôpital du Valais avec ses 10 sites,
500 cabinets médicaux,
plusieurs cliniques privées et de réadaptation,
l’Hôpital du Chablais,
43 établissements médico-sociaux (EMS) et 19 centres médico-
sociaux (CMS),
113 pharmacies d’officine,
plusieurs cabinets de physiothérapie, les laboratoires d’analyses
médicales ou de pathologie et les instituts d’imagerie médicale.

33
Proceedings 2011
Swiss Medical Informatics 2011; no 72
Etape 4 – intégration des pharmaciens
Cette étape prévoit l’intégration des pharmaciens d’offi-
cine dans le projet, et de rendre accessible le dossier mé-
dicament des pharmacies. Il doit ainsi être possible de
connaitre la liste actuelle des médicaments du patient,
y compris certains médicaments hors ordonnances. Les
pharmaciens peuvent avoir accès à certaines données mé-
dicales qui restent à définir.
Etape 5 – extension aux autres professionnels de santé
Cette étape permet aux autres professionnels de santé
d’obtenir électroniquement des données du patient et de
transmettre également leurs données. Les acteurs concer-
nés par cette phase sont les infirmières des EMS, CMS
et hôpitaux, ainsi que les chiropraticiens et physiothéra-
peutes.
Etape 6 – intégration des patients
Avec cette étape, les patients peuvent accéder à leur dos-
sier patient et gérer les accès (quel professionnel de santé
peut accéder à leur dossier). De plus le patient peut éga-
lement saisir certaines données personnelles au moyen
d’un formulaire. L’authentification du patient s’effectue
au moyen d’un certificat X509. Cette étape intervient re-
lativement tardivement dans le projet car la majorité des
assureurs maladies suisses n’ont pas distribué de cartes
d’assuré disposant d’un certificat X509.
Consentement du patient: l’autorisation d’accès par
déclaration
Les documents médicaux du patient sont des données per-
sonnelles et sensibles. Il convient donc de les traiter en
toute confidentialité et sécurité, et ceci en accord avec les
souhaits de chaque personne. L’information et la trans-
parence permettent de gagner la confiance des patients.
Pour les phases 1 et 2, la transmission de documents ne
se fait qu’à des personnes explicitement définies comme
destinataires du document. Cette méthode de transmis-
sion électronique se substitue donc à la méthode actuelle
d’envoi par fax ou courrier postal. Le consentement du pa-
tient peut donc rester implicite. Par contre, à partir de la
phase 3, l’intégralité du contenu d’un DPP est potentielle-
ment accessible à un professionnel de santé (PS). Le pa-
tient doit donc donner son consentement explicite pour la
création de son DPP et pour l’accès des PS à ses données.
Le consentement écrit a été retenu pour le processus de
création du DPP. Pour l’accès aux données, chaque PS peut
s’octroyer lui-même des droits via la plateforme. Cepen-
dant il doit d’abord recueillir le consentement du patient.
Celui-ci devrait idéalement se matérialiser par l’insertion
et la lecture de la carte d’assuré de ce dernier. Mais face à
l’indisponibilité des cartes d’assurés disposant d’un cer-
tificat d’authentification X.509 à grande échelle, un mé-
canisme temporaire de substitution à été retenu. Chaque
patient se voit généré un code PIN (Personal Identification
Number) unique, connu de lui seul. C’est ce code PIN qui
doit être saisi dans l’interface permettant l’accès d’un PS;
entrainant l’inscription de ce dernier sur la liste d’autori-
sation en niveau d’accès intégral, et ceci pour une durée
déterminée (par défaut 5 ans). L’insertion du code PIN ne
se fait donc qu’une fois par PS pour cette durée. Pour les
cas d’urgence, un mode dit de vitre brisée ne nécessitant
pas l’accord du patient est possible, mais chaque accès en
vitre brisée génère un courrier d’information au patient.
Il est intéressant de faire ici un parallèle avec le dossier
patient national en France DMP ou dossier médical per-
sonnel inauguré au début 2011 et qui utilise la notion de
consentement déclaré [5]. Le médecin doit informer son
patient, recueillir son consentement et indiquer via une
case à cocher dans son logiciel ou sur le portail qu’il a
reçu l’autorisation d’accès. Tout est donc dématérialisé
que ce soit pour le consentement de création du DMP ou
de l’autorisation d’accès. Cette déclaration d’accès ne peut
se faire que par une personne authentifiée sur la plate-
forme, et l’action est enregistrée dans la liste des traces.
Episodes de soins et classification ICPC-2
De manière à pouvoir disposer d’information sur l’état de
santé et l’activité ambulatoire, en référence au 2ème objec-
tif stratégique du projet, il est proposé qu’à terme chaque
document transféré dans la plateforme soit rattaché à un
épisode de soins codifié selon la classification ICPC-2 (In-
Figure 3
Exemple d’un épisode de soins.
Figure 2
Interfaces d’autorisation d’accès par déclaration.

34
Proceedings 2011
Swiss Medical Informatics 2011; no 72
chaque patient. Par ailleurs il y a un risque de transmis-
sion orale du code PIN au médecin au lieu d’une saisie
par le patient lui-même avec un potentiel de transmission
du code PIN à d’autres PS. Néanmoins le caractère tran-
sitoire du code PIN en attente de la généralisation de la
carte d’assuré permet d’intégrer le consentement expli-
cite du patient dans le projet.
Limitation du système ICPC-2
L’association d’un code ICPC-2 à chaque document pré-
sente les avantages d’être relativement simple et rapide à
réaliser pour chaque acteur du système, et de permettre
une catégorisation du contenu. Cependant, il faut être
conscient des limitations de l’approche et des biais po-
tentiels. Ce n’est pas toute l’activité médicale du canton
qui est ainsi représentée, mais uniquement les activités
générant des documents captés par la plateforme. Il faut
en outre craindre un rejet de certains PS voir de catégo-
ries de PS de participer au concept pour des raisons de
confidentialité, par exemple, le secteur de la psychiatrie.
Malgré les limitations indiquées ci-dessus, l’approche
adoptée dans Infomed se veut pragmatique afin de ré-
pondre au mieux aux attentes des parties prenantes, tout
en respectant les impératifs de délais, de coûts et de pro-
tection des données.
Références
1 Gnaegi A, Wieser P, Dupuis G. La stratégie eHealth en Valais. Bulletin
des médecins suisses 2010 août;91(33):1247–50.
2 Gnaegi A, Fragnière F. Analyse des besoins d’échanges de données
médicales électroniques avec la médecine ambulatoire, premiers ré-
sultats du projet Infomed. Swiss Medical Informatics. 2010;(69):50–2.
3 Organe de coordination de cybersanté Confédération Cantons. eHealth
Suisse Normes et architecture Recommandations II. 2010.
4 Hanselmann M, Knoepfel C, Schaller T, Steiner P. CDA-CH: Spécifica-
tion pour l’échange électronique de documents médicaux en Suisse
[Internet]. 2009;[cité 2009 déc 9] Available from: http://www.hl7.ch/
default.asp?tab=2&item=standard
5 Vous recueillez le consentement de votre patient [Internet]. Dossier
médical personnel [sans date];[cité 2011 mai 16] Available from:
http://www.dmp.gouv.fr/web/dmp/professionnel-de-sante/vs-recueil-
lez-le-consentement-de-votre-patient
6 Bhend H. ICPC-2 – Premiers pas. PrimaryCare. 2008;8(6):108–11.
7 Körner T. Die Episode als Grundlage der Dokumentation. Deutsches
Ärzteblatt. 2005;102(46):A 3168–72.
ternational Classification in Primary Care) [6]. Cette classi-
fication composée d’environ 300 codes est beaucoup plus
simple que la classification CIM-10 (ou ICD-10) et offre en
outre l’avantage de pouvoir codifier les plaintes ou symp-
tômes qui ne correspondent pas à des diagnostics précis.
Un épisode de soins est un problème de santé depuis la
première présentation du patient à un fournisseur de
soins jusqu’à et incluant sa dernière rencontre [7]. Un
épisode de soins peut correspondre à des prises en charge
médicales et soignantes par plusieurs intervenants mais
regroupées autour d’un même problème médical. Chaque
intervenant doit reconnaitre le même épisode de soins
d’où l’importance d’un système de classification simple
pour éviter des erreurs dues à des libellés différents (par
exemple cancer du colon vs tumeur du colon). Une fois
les documents rattachés à un épisode de soins, il sera
plus aisé pour le médecin d’accéder directement aux do-
cuments qui l’intéresse au lieu de devoir passer en revue
tous les documents disponibles sur la plateforme Infomed.
L’analyse des types de documents échangés, en particu-
lier en se basant sur l’émetteur et le destinataire, asso-
ciée au code ICPC-2 de l’épisode en question, permettront
d’avoir un bon reflet des problèmes de santé de la popula-
tion, ainsi que des intervenants sollicités pour le problème
concerné. Ces données pourront ensuite être consolidées
de manière anonyme dans le Data Warehouse de l’Obser-
vatoire valaisan de la santé.
Planning
Un cahier des charges pour l’acquisition d’une plateforme
à même de gérer le DPP a été rédigé, et un appel d’offres
en marché public a été lancé en mai 2011. La mise en
production de la phase 1 est prévue pour début de l’an-
née 2012.
Discussion
Limitation du code PIN
La mise en place d’un code PIN unique par patient est une
solution facile à mettre en place et peu onéreuse, mais
comporte néanmoins quelques désavantages. En premier
lieu ce n’est pas une authentification forte et nécessite une
certaine logistique physique pour l’envoi du code PIN à
1
/
4
100%