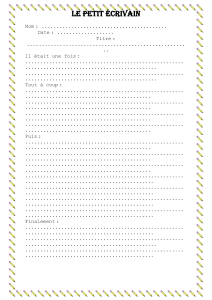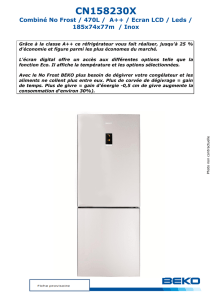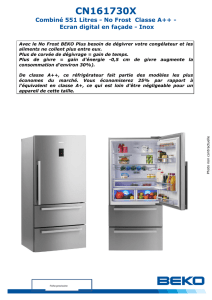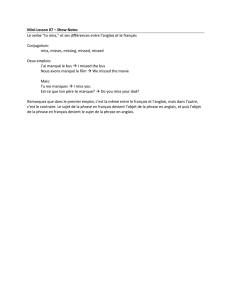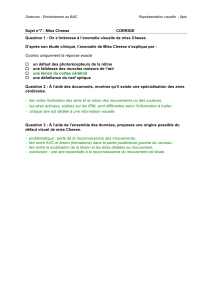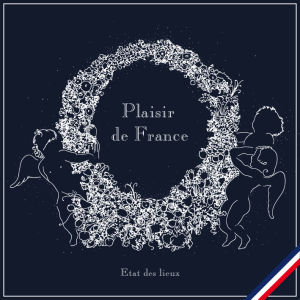"A moi seul bien des personnages", de John Irving

OSI Bouaké > Zone Franche > Librophagie > "A moi seul bien des personnages", de John Irving
"A moi seul bien des personnages", de John
Irving
Seuil - Mai 2013 -
Résumé : Adolescent, Bill est troublé par ses béguins contre nature pour son beau-père, ses camarades
de classe, et pour des femmes adultes aux petits seins juvéniles… Plus tard, il assumera son statut de
suspect sexuel, et sa vie entière sera marquée par des amours inassouvies pour les hommes, les femmes
et ceux ou celles qu’on appellera bientôt transgenres.
Dans ce roman drôle et touchant, jubilatoire et tragique, John Irving nous parle du désir, de la
dissimulation et des affres d’une identité sexuelle « différente ». Du théâtre amateur de son enfance
jusqu’au bar hot où se joue la révélation finale, en passant par la bibliothèque où la sculpturale Miss Frost
l’initie — tout d’abord — à la littérature, le narrateur s’efforce de trouver un sens à sa vie sans rien nous
cacher de ses frasques, de ses doutes et de son engagement pour la tolérance, pour la liberté de toutes les
altérités.
L’auteur : John Irving est né en 1942 et a grandi à Exeter (New Hampshire). La publication de son
quatrième roman, Le Monde selon Garp, lui a assuré une renommée et une reconnaissance internationales.
Depuis, l’auteur accumule les succès auprès du public et de la critique. À moi seul bien des personnages
est son treizième roman. Marié et père de trois garçons, John Irving partage son temps entre le Vermont
et le Canada.
John Irving , A moi seul bien des personnages, traduit de l’anglais par Josée Kamoun et Olivier Grenot,
●
Seuil, 450 pages, 21,80€
Lecture du nouveau roman de John Irving, A moi... par EditionsduSeuil
Billy le bi
Libération - 17 avril 2013 - par Catherine Mallaval -

John Irving narre les amours d’un « suspect sexuel », de l’adolescence aux LGBT
Du désir, beaucoup. Mais souvent difficile à assouvir. Du secret comme seules les familles savent en
forger. Du tourment. Celui que ressentent les sexuellement différents. Et puis de la lutte, toujours. La
vraie, celle qui fait suer les corps qui s’affrontent à pleines mains. En sous-texte, du Shakespeare, du
Dickens, et du Flaubert (précisément Madame Bovary). Dans A moi seul bien des personnages, son
treizième roman, John Irving sert au lecteur assoiffé depuis la parution en 2011 de Dernière Nuit à
Twisted River un cocktail si bien dosé qu’il se descend cul sec. Ici défilent sur près de 500 pages les
amours d’un « suspect sexuel », un bi, dans la seconde moitié du XXe siècle. Avec du tragicomique (qui
ose taquiner le loufoque), du touchant, mais aussi du poing levé contre le puritanisme, l’intolérable silence
du gouvernement Reagan durant les années sida , l’intolérance face aux sexualités différentes : homo, bi
ou transgenre. Mais place au romanesque, la vraie science de John Irving depuis le Monde selon Garp.
Carrure virile. Le rideau s’ouvre sur la ville de First Sister, Vermont, Etats-Unis. Et sur le narrateur
héros, William Marshall Abbott, dit Billy, adolescent à ce point chaviré par ses premiers béguins jugés
contre-nature qu’il en dit « pénif » au lieu de « pénis ». Premier objet de son désir, Miss Frost, excitante
bibliothécaire : « Elle était carrée d’épaules, po urtant c’était surtout ses seins, petits mais jolis, qui
attiraient mon attention. […] Contraste apparent avec sa carrure virile et sa force physique manifeste. »
C’est elle, dont Billy finira par découvrir qu’elle fut un temps Albert Frost (dit « Big Al »), ancien capitaine
d’une équipe de lutte, qui éveillera l’ado à son identité sexuelle. Elle aussi qui le guidera dans ses lectures
: « L’heure viendra de lire Madame Bovary quand tu auras vu s’anéantir tes espoirs et tes désirs
romantiques. » Elle enfin qui déclenchera chez Billy une vocation : « Nos désirs nous façonnent : il ne m’a
pas fallu plus d’une minute de tension libidinale secrète pour désirer à la fois devenir écrivain et coucher
avec Miss Frost - pas forcément dans cet ordre, d’ailleurs. »
Mais Billy ne se contente pas d’en pincer pour Miss Frost, son beau-père aussi le trouble, tandis qu’il
traîne comme un boulet sa ravageuse attirance pour le jeune Kittredge, « lutteur au corps superbe entre
tous : torse glabre, pectoraux définis à l’excès […]. Il avait un pénis tout ce qu’il y a de plus mignon, qui se
recourbait vers sa cuisse droite, inexplicablement. » C’est cul. C’est cru. Mais sensible avant tout, tant
l’adolescence prend ici un tour nettement plus torturant qu’un premier baiser ou une crise d’acné.
Pensionnat. Comment aimer toucher des petits seins, mais aussi les sexes d’homme ? Comment parvenir
à assumer ce que l’on est, en s’affranchissant de la condamnation d’une mère qui a fait de l’homosexualité
du (vrai) père de Billy un étouffant secret ? Comment échapper à des médecins convaincus que les écarts
à l’hétérosexualité doivent se guérir comme on redresse des torts ? « A l’automne 60, dans un pensionnat
de garçons, quelqu’un comme moi se sentait absolument seul, en proie à la haine de soi », résume Billy
qui s’échappe dans une lecture passionnée des Grandes Espérances de Charles Dickens, les répétitions et
représentations de la troupe de théâtre amateur de First Sister, qui enchaîne les pièces de Shakespeare,
dirigée par son beau-père, tandis que son grand-père n’aime rien tant que d’y interpréter des rôles de
femmes…
D’affres en frasques avec des femmes, des hommes, des trans, à First Sister, Vienne ou New York, Billy le
bisexuel s’installe tant bien que mal dans son altérité et sa vie d’écrivain, avant d’affronter le début de
l’épidémie de sida et la longue suite de morbides coming out qui s’ensuivirent : « Les femmes
découvraient que leurs maris fréquentaient des hommes au moment même où ils étaient mourants. Des
parents apprenaient que leurs jeunes fils étaient en train de mourir avant de savoir ou de se douter qu’ils
étaient gays. » Billy survit, mais crève de peur, perd des proches, hanté par les « plaques de candidose
plein la bouche »,« les langues crayeuses », les « visages d’agonie ».
L’écœurement et l’engagement de John Irving affleurent. Après avoir croqué des années 60 qui
associèrent au mot homosexuel « des relents cliniques dissuasifs », il traverse les ravages du sida avec
révolte contre l’injustice mais aussi le mutisme du pouvoir, avant de quitter le lecteur avec des LGBT
(lesbiennes, gays, bi et trans) en marche vers la conquête de droits et de respect.
Pour Billy aussi l’apaisement viendra. Retour à First Sister où le héros se pose en « quelqu’un de bien ». A

68 ans, l’écrivain devient prof de lettres à mi-temps dans son ancienne école ; il y dirige le club de théâtre.
Mais surtout, il épaule le jeune Gee qui rêve de devenir une Georgia et milite à l’occasion auprès des
LGBT… Le cap des années 2000 a été franchi. Mais le vers de Richard II de Shakespeare demeure : « Je
joue donc à moi seul bien des personnages dont nul n’est satisfait. »
John Irving : "L’Europe m’inquiète"
L’express - 30/04/2013 - Propos recueillis par Julien Bisson -
Auteur du Monde selon Garp, l’écrivain américain sonde les maux de son pays. Son dernier livre A moi
seul bien des personnages trouve un écho avec le débat sur le mariage pour tous en France. Entretien.
Dans son nouveau roman, le foisonnant A moi seul bien des personnages, John Irving évoque cette fois le
destin d’un homme bisexuel, des années 1950 à 2010, en proie aux doutes et à l’intolérance de son époque.
Un livre qui trouve un écho certain avec l’actualité récente, mais qui confirme surtout la maestria d’un
romancier encore passablement énervé. Discussion autour d’un cappuccino.
35 ans après l’immense succès du Monde selon Garp, votre nouveau roman aborde à nouveau la
question de la différence sexuelle. Pourquoi revenir sur ce thème aujourd’hui ?
Ce livre trottait dans ma tête depuis une douzaine d’années. Quand j’ai écrit Le monde selon Garp, je
voulais exprimer ma colère devant l’échec de la soi-disant "révolution sexuelle" des années 60, de son
incapacité à mettre fin aux violences sexuelles ou à promouvoir la tolérance, notamment envers la
minorité gay. Avec A moi bien des personnages, j’ai voulu écrire un roman très différent, moins radical,
moins satirique, mais aussi plus réaliste, plus historique. Ses personnages ne sont plus des symboles, mais
des individus qui pourraient être réels. Seul le thème n’a pas changé. Car si en 35 ans l’intolérance
sexuelle a régressé, elle n’a pas pour autant disparu, loin de là.
Vous donnez à votre Billy de nombreux éléments de votre propre biographie, à commencer par
votre date de naissance ou votre passion pour le théâtre et la lutte. Faut-il pour autant voir en
lui une forme d’autoportrait ?
Si vous voulez savoir si j’ai eu des expériences gays, ou si j’ai été initié au sexe par une bibliothécaire, la
réponse est non ! J’utilise certains éléments de ma propre vie justement parce que la question
autobiographique ne m’intéresse pas. Rien de ce qui m’est arrivé n’est sacré, je peux donc tout altérer. Le
problème, c’est que depuis les années 90, l’imagination collective du monde a diminué. La réalité est
devenue plus importante, et les mémoires ont commencé à pulluler - y compris de la part de gens dont
l’existence n’a absolument rien d’intéressant ! Ma propre vie ne mérite pas plus d’être racontée. En
revanche, j’ai connu la Vienne des années 60, j’ai traversé l’Amérique pendant la guerre du Viêt-Nam, et
j’ai perdu beaucoup d’amis durant l’épidémie de sida des années 80. C’est cela qui mérite d’être raconté.
Le théâtre, avec son cortège de masques et de déguisements, tient une grande place dans le
livre. Pourquoi êtes-vous attiré par cet univers ?
Quand j’étais jeune, je faisais souvent semblant d’être quelqu’un d’autre. Car au fond, j’avais du mal à
assumer qui j’étais vraiment. En fréquentant le milieu du théâtre grâce à ma mère, qui était souffleuse,
j’ai rencontré d’autres gens pareils à moi. Le théâtre était un refuge pour beaucoup de gens troublés par
leur propre identité, y compris certains par leur identité sexuelle. C’est là que j’ai rencontré mes premiers
amis gays, là seulement qu’ils pouvaient être eux-mêmes. Dans l’Amérique des années 50 et 60, on ne
pouvait pas faire son coming-out facilement. Hors du théâtre, il leur fallait se cacher. Mais sur les
planches, ils pouvaient enfin exhiber leur moi profond.
Un écrivain est-il également une sorte de paria social ?

Si vous ne l’êtes pas, c’est que vous avez un problème ! Un écrivain doit toujours se sentir étranger à la
société dans laquelle il vit, sous peine de n’écrire que des mauvais livres. Quand j’étais étudiant en Europe,
à Vienne, ce n’était pas seulement une période follement excitante de ma vie. C’était aussi un moment
décisif dans ma carrière d’écrivain. Car j’ai pu apprécier le fait d’être l’Auslander, ce type bizarre qui
pouvait avoir un regard détaché sur les choses et sur les gens. C’est aussi l’une des raisons pour laquelle
il y a tant de parias dans mes romans, et pas seulement des parias sexuels.
L’écriture de A moi seul bien des personnages a-t-il un lien avec l’homosexualité de votre plus
jeune fils ?
Non, pas directement, car j’ai commencé la rédaction de ce roman bien avant de savoir qu’Everett
deviendrait gay. Toute l’histoire de Billy était déjà présente dans ma tête alors que mon fils n’avait pas
encore dix ans. Mais quand je l’ai découvert, j’ai au moins pu me dire que j’avais un lecteur tout trouvé
pour ce livre ! Tout comme ses frères aînés avaient pu lire Le monde selon Garp des années plus tôt et
comprendre les angoisses paternelles qui pouvaient alors m’étreindre. Je crois donc que j’ai eu beaucoup
de chance, que le timing était le bon. Tout comme la sortie de ce livre en France d’ailleurs, en plein débat
sur la question homosexuelle !
Justement, comment avez-vous vécu les manifestations contre le "mariage pour tous", qui se
sont tenues durant votre séjour à Paris ?
Elles se sont même tenues sous mes fenêtres, devant l’hôtel Lutetia ! D’un côté, je suis convaincu que
cette violence physique et verbale est le signe du désarroi de factions religieuses traditionalistes, qui se
savent désormais en minorité. Mais je suis quand même préoccupé. Vous savez, cela fait près de
cinquante ans que je viens régulièrement en Europe, dans l’idée que ce continent est celui du progrès et
de la libération, notamment sexuelle. Et, pour la première fois, l’Europe m’inquiète, car je n’ai plus le
sentiment qu’elle soit en avance sur l’Amérique sur ces sujets.
Avez-vous davantage d’espoirs pour votre pays ?
Etonnamment, oui. La réélection de Barack Obama, l’an passé, m’a donné une confiance nouvelle dans la
capacité des Etats-Unis à aller de l’avant. Car même avec une situation économique en berne, Obama a
réussi à passer l’obstacle républicain, à montrer le vide idéologique de cette droite réactionnaire et sans
idées. Tout le monde a voté en majorité pour lui, les femmes, les jeunes, les personnes de couleurs, tout le
monde sauf une seule catégorie de la population : les vieux hommes blancs. Tant mieux ! Car l’avenir ne
leur appartient plus. Même si, pour ma part, je compte bien encore écrire un livre ou deux...
Pour aller plus loin : Entretien avec John Irving sur France culture, le 23 avril 2013.
●
A moi seul bien des personnages, de John Irving
L’express - Par Delphine Peras (Lire), publié le 10/04/2013 -
Dans A moi seul bien des personnages, John Irving met en scène Billy, un personnage bisexuel, qui
s’efforce de devenir "quelqu’un de bien" après n’être tombé que sur les mauvaises personnes.
Le livre
C’est sous les auspices de Shakespeare que commence, et se poursuivra, ce treizième roman de John
Irving dont le titre reprend un vers de Richard II. Mais s’il y est largement question de dramaturgie et de
travestissement, l’écrivain pousse son propos bien plus loin en abordant frontalement, souvent crûment, la
bisexualité. Le narrateur, William dit Bill - né en mars 1942, comme l’auteur et qui, comme lui, deviendra
écrivain en adoptant le patronyme de son beau-père, n’ayant pas connu son père biologique -, en fait
l’expérience dès l’adolescence. Certes, dans la petite ville du Vermont où il vit, toute sa famille appartient

à la troupe de théâtre locale et les occasions ne manquent pas de défier les conventions. Mais Bill
s’interroge de plus en plus sur son attirance pour les filles autant que pour les garçons : "C’est épuisant
d’avoir dix-sept ans et de ne pas savoir qui l’on est." Il va ainsi dérouler près d’un demi-siècle de sa vie de
"suspect sexuel", dans un pays qui oscillera entre une libération des moeurs inévitable et le conservatisme
le plus puritain. De l’apparition du terme "gay" aux ravages du sida , Bill rend un hommage fort à celles
et ceux qu’il a aimés, à ceux qui ont souffert de leur différence, telle Donna la transsexuelle, "une femme
avec une bite en plus". Dans ce livre baroque, bavard, bravache, John Irving a beau distiller à nouveau de
nombreux éléments autobiographiques, Bill n’est pas son double. C’est l’évocation poignante, alternant
humour et gravité, de la solitude d’un individu bisexuel qui s’efforce de devenir "quelqu’un de bien".
L’Extrait
Je commencerais bien par vous parler de Miss Frost. Certes, je raconte à tout le monde que je suis devenu
écrivain pour avoir lu un roman de Charles Dickens à quinze ans, âge de toutes les formations, mais, à la
vérité, j’étais plus jeune encore lorsque j’ai fait la connaissance de Miss Frost et me suis imaginé coucher
avec elle. Car cet éveil soudain de ma sexualité a également marqué la naissance tumultueuse de ma
vocation littéraire. Nos désirs nous façonnent : il ne m’a pas fallu plus d’une minute de tension libidinale
secrète pour désirer à la fois devenir écrivain et coucher avec Miss Frost - pas forcément dans cet ordre,
d’ailleurs.
La première fois que j’ai vu Miss Frost, c’était dans une bibliothèque. J’aime bien les bibliothèques, même
si j’éprouve quelques difficultés à prononcer le vocable. J’ai comme ça du mal à articuler certains mots :
des noms, en général - de personnes, de lieux, de choses qui me plongent dans une excitation anormale,
un conflit insoluble ou une panique absolue. Enfin, c’est ce que disent les orthophonistes, logopédistes et
autres psychanalystes qui se sont penchés sur mon cas - hélas sans succès. En primaire, on m’a fait
redoubler une année en raison de mes "troubles sévères du langage", diagnostic très excessif. J’ai
aujourd’hui largement passé la soixantaine, je vais sur mes soixante-dix ans, et comprendre la cause de
mon défaut de prononciation est le cadet de mes soucis. Pour faire court, l’étiologie, je m’en contrefous.
Etiologie : un mot que je ne me risquerais pas à prononcer, mais en revanche, si je m’applique, j’arrive à
produire quelque chose qui s’approche de bibliothèque ; le mot estropié éclot alors, fleur exotique, et ça
donne "bibilothèque" ou "billothèque" - comme dans la bouche des enfants.
Comble d’ironie, ma première bibliothèque était bien modeste. C’était la Bibliothèque municipale de la
petite ville de First Sister, dans le Vermont - un bâtiment trapu, en brique rouge, situé dans la même rue
que la maison de mes grands-parents. J’ai vécu chez eux, à River Street, jusqu’à l’âge de quinze ans,
c’est-à-dire jusqu’au second mariage de ma mère. Ma mère a rencontré mon beau-père sur les planches.
La troupe de théâtre amateur de la ville s’appelait The First Sister Players ; et d’aussi loin que je me
souvienne, j’ai vu toutes les pièces qu’elle montait. Ma mère était souffleuse - quand on oubliait ses
répliques, elle les rappelait, et les vers oubliés en route n’étaient pas rares dans une troupe amateur.
Pendant des années, j’ai cru que le souffleur était un acteur comme les autres - à ceci près que, pour des
raisons qui m’échappaient, il ne montait pas sur scène et restait en tenue de ville pour dire sa part du
texte.
Mon beau-père venait d’entrer dans la troupe quand ma mère a fait sa connaissance. Il s’était installé en
ville pour enseigner à la Favorite River Academy - boîte privée pseudo-prestigieuse, alors réservée aux
garçons. Dès ma plus tendre enfance, et en tout cas dès l’âge de dix, onze ans, je savais sans doute que,
l’heure venue, on m’y inscrirait. J’y découvrirais une bibliothèque plus moderne et mieux éclairée, mais la
Bibliothèque municipale de First Sister fut ma première bibliothèque, et la bibliothécaire qui y officiait,
ma première bibliothécaire. Soit dit en passant, je n’ai jamais eu de difficulté à prononcer le mot
bibliothécaire.
Miss Frost m’a certes marqué bien davantage que la bibliothèque elle-même. A ma grande honte, c’est
longtemps après notre première rencontre que j’ai appris son prénom. Tout le monde l’appelait Miss Frost,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%