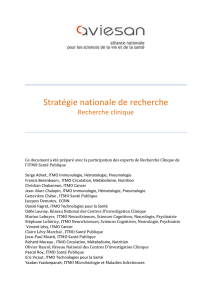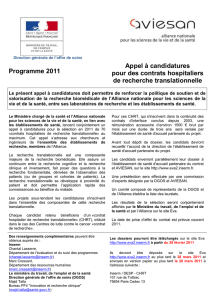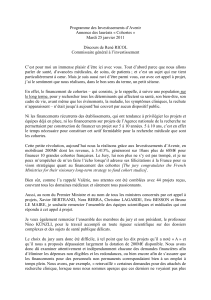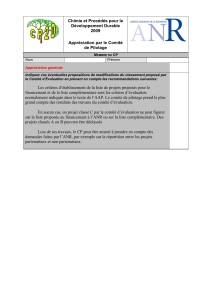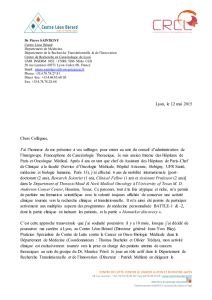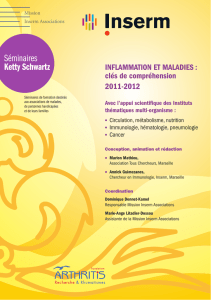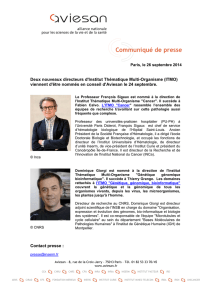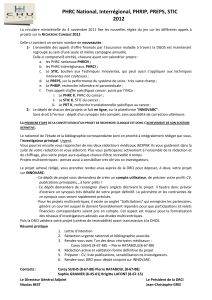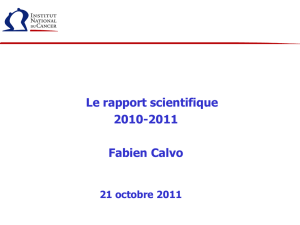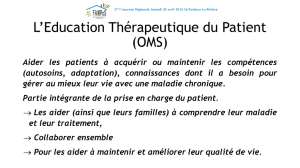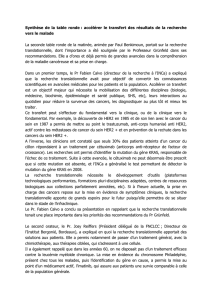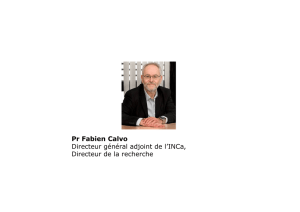Financement public de la recherche clinique en France

1
Financement public de la recherche clinique en
France
Propositions du groupe d'experts inter-Instituts Thématiques Multi-
Organismes de recherche Clinique d'Aviesan
Serge Adnot, ITMO Immunologie, Hématologie, Pneumologie
Francis Berenbaum, ITMO Circulation, Métabolisme, Nutrition
Christian Chabannon, ITMO Cancer
Jean- Marc Chalopin, ITMO Immunologie, Hématologie, Pneumologie
Geneviève Chêne, ITMO Microbiologie et Maladies Infectieuses
Jacques Demotes, ECRIN
Daniel Fagret, ITMO Technologies pour la Santé
Odile Launay, Réseau National des Centres D'investigation Clinique
Marion Leboyer, ITMO NeuroSciences, Sciences Cognitives, Neurologie, Psychiatrie
Stéphane Lehéricy, ITMO NeuroSciences, Sciences Cognitives, Neurologie, Psychiatrie
Vincent Lévy, ITMO Cancer
Claire Lévy-Marchal , ITMO Santé Publique
Jean-Paul Moatti, ITMO Santé Publique
Richard Moreau, ITMO Circulation, Métabolisme, Nutrition
Olivier Rascol, Réseau National des Centres D'investigation Clinique
Pascal Roy, ITMO Santé Publique
Eric Vicaut, ITMO Technologies pour la Santé
Yazdan Yazdanpanah, ITMO Microbiologie et Maladies Infectieuses

2
Les deux premières parties de cette note s’efforcent, dans les limites des données
disponibles, de dresser un état actuel du financement public de la recherche clinique dans
notre pays (les aspects de partenariat avec le secteur industriel privé ayant été couverts par
ailleurs en particulier par les réflexions communes entre l’Alliance pour la Recherche et
l’Innovation des Industries de Santé –ARIIS- et AVIESAN). La troisième partie synthétise
une série de 10 propositions pour faire évoluer la situation actuelle dans le sens d’une
meilleure efficacité et de la simplification institutionnelle réclamée de façon convergente
par l’ensemble des acteurs de la recherche publique.
INTRODUCTION
Le financement de la recherche clinique est une question délicate dans tous les pays. Il
s’agit d’une activité dotée d’un impact fort et assez immédiat sur la santé et sur
l’économie
1
-
2
. Cependant plusieurs facteurs font que le besoin d’un financement public et
la nature de ce financement ne sont pas toujours bien compris par les décideurs. Les
essais cliniques de médicament et de dispositif médical promus par l’industrie sont une
activité importante qui, même si elle a eu tendance à décliner dans les dernières
années
3
, peut être estimée à plus de €3Mds par an en France
4
. Cela peut parfois faire
oublier que la recherche clinique académique coexiste, avec des objectifs différents, et
avec un besoin de financement spécifique.
La recherche clinique est par ailleurs perçue comme une activité onéreuse. Elle est aussi
perçue comme une recherche appliquée, moins gratifiée dans certaines instances
scientifiques d’évaluation que les travaux fondamentaux qui font appel à des technologies
plus pointues. Le problème majeur de la recherche clinique est d’être située à l’interface
de multiples acteurs : entre l’hôpital, l’Université et les organismes publics de recherches
(EPST), entre le monde du soin et celui de la recherche, entre industrie et académie,
entre pilotage administratif et pilotage scientifique, entre financement ‘santé’ et
financement ‘recherche’.
La recherche clinique se définit comme la recherche biomédicale effectuée à
partir de données recueillies sur des participants humains, avec ou sans
intervention (thérapeutique ou diagnostique). Elle correspond donc à un spectre
extrêmement large d’activités, souvent intriquées car une étude donnée peut avoir
plusieurs objectifs – par exemple un essai thérapeutique de médicament comportant
aussi une recherche sur le mécanisme de la maladie. Il est toutefois nécessaire, pour
analyser et proposer une clarification du rôle des différents acteurs de la recherche
clinique en France, d’opérer certaines distinctions.
1
Johnston SC et al., Effect of a US National Institutes of Health programme of clinical trials on
public health and costs. Lancet 2006, 367:1319-27.
2
Medical research: What’s it worth ? Wellcome Trust Report
www.wellcome.ac.uk/About-us/Publications/Reports/Biomedical-science/WTX052113.htm
3
Les chiffres de l’EMA montrent une diminution de l’ordre de 20% en cinq ans du nombre d’essais
cliniques de médicaments en Europe, et indiquent que désormais 40% de ces essais ont un
promoteur non-commercial. Ce chiffre était autour de 25% en 2006. Si l’on considère les études
cliniques en général, la proportion est plus élevée car la quasi-totalité des études hors produits de
santé est à promotion académique.
4
La recherche clinique représente environ 2/3 des dépenses R&D de l’industrie pharmaceutique,
qui correspondent à 10-12% du chiffre d’affaires du secteur (>€50Mds par an). L’investissement
du secteur du dispositif médical est moindre, mais devrait s’accroitre dans le nouveau contexte
réglementaire.

3
Une typologie des objectifs et composantes de la recherche clinique

4
A – OBJECTIFS DE LA RECHERCHE CLINIQUE
La recherche clinique, telle que très largement définie ci-dessus, peut avoir 6 types
d’objectifs, un projet particulier pouvant poursuivre simultanément plusieurs de ces
objectifs :
1 la connaissance des déterminants de la maladie : recherche physiopathologique,
étude de l’histoire naturelle de la maladie, identification de biomarqueurs diagnostiques,
identification de potentielles cibles thérapeutiques. Les techniques sous-jacentes incluent
la biologie, la génétique, l’imagerie, mais aussi l’épidémiologie lorsque l’étude porte par
exemple sur l’identification de facteurs environnementaux en tant que déterminants de la
maladie. Il s’agit d’une recherche visant à produire des connaissances, au même titre
que l’étude de modèles cellulaires ou d’animaux transgéniques. Classiquement cette
recherche d’amont est menée par les institutions académiques, mais les industriels
s’intéressent de plus en plus précocement au mécanisme de la maladie afin d’identifier
des cibles thérapeutiques potentielles fiables. Cette recherche génère avant tout de la
connaissance, avec éventuellement un impact à distance sur la santé dès lors qu’elle
débouche sur des innovations en matière de produits ou procédures de prévention, de
diagnostic ou de traitement.
2 la recherche translationnelle, incluant la preuve du concept clinique représente,
une fois identifiée la cible thérapeutique potentielle, l’étape de découverte et
d’optimisation du produit, puis son développement préclinique et les premières étapes du
développement clinique
5
. Cette étape à forte attrition, volontiers comparée à la ‘vallée de
la mort’, a pour objectif direct l’innovation. Il s’agit classiquement d’une activité
industrielle. Cependant l’émergence d’une capacité de recherche translationnelle en
milieu académique (dont la mise en place d’Instituts Hospitalo-Universitaires -IHUs- par
grands domaines a constitué une avancée récente en France), ou en partenariat avec des
PME de biotechnologie ou de dispositif médical, fait qu’un nombre substantiel d’études de
preuve du concept clinique sont maintenant initiées par des investigateurs académiques
– en particulier dans le domaine des biopharmaceutiques ou des biothérapies. Cette
recherche génère des connaissances tout en participant directement au développement
de produits innovants.
3 le développement clinique d’un nouveau produit de santé (phases I-II-III)
jusqu’à l’accès au marché, relève dans la majorité des cas d’un promoteur industriel
(grand groupe ou PME), avec toutefois une composante académique en particulier dans
les biothérapies. Cette recherche profite donc avant tout au développement industriel, et
à l’économie en promouvant l’innovation, et bien entendu aux patients.
4 l’exploration de nouvelles indications pour un produit déjà commercialisé
(« repurposing trials »). Il s’agit typiquement d’études de phase II-III initiées par des
investigateurs académiques (plus rarement par l’industrie, surtout quand il y a une
incitation en termes d’extension du brevet, ce qui est le cas en pédiatrie), visant à établir
de nouvelles indications pour des produits existants dans les maladies rares, le cancer,
ou pour de nouvelles populations. Cette recherche profite donc aux patients, aux
professionnels de santé, au système de santé, et à l’économie en améliorant l’état de
santé de la population, et aussi potentiellement au fabricant du médicament.
5
Selon le Conseil Scientifique de l'Inserm, la recherche translationnelle concerne «l’échange, la
synthèse et l’application éthique des connaissances – dans un système complexe d’interactions
entre chercheurs et utilisateurs – pour accélérer la concrétisation des avantages de la recherche
(…), à savoir une meilleure santé, de meilleurs produits et services de santé et un système de
santé renforcé»
(http://www.rickhanseninstitute.org/fr/ce-que-nous-faisons/domaines-prioritaires/recherche-
translationnelle/definition).

5
5 l’optimisation des stratégies de prise en charge (comparaison de stratégies
thérapeutiques faisant partie du soin courant, avec des produits déjà sur le marché ou
des procédés établis par la pratique, ou comparaison de stratégies incluant diagnostic et
prise en charge). Ces études sont essentiellement initiées par des investigateurs
académiques. Leur objectif est de déterminer quelle est la meilleure stratégie de prise en
charge en termes de sécurité, d’efficacité clinique et de rapport coût/efficacité. Cette
recherche indépendante du fabricant, centrée non pas sur le produit mais sur le patient
profite donc aux patients, aux professionnels de santé, aux autorités de santé (HAS,
ANSM), au système de soin, et à l’économie en améliorant l’état de santé de la
population et en optimisant l’allocation des ressources aux soins.
6 enfin les études portant sur la santé des populations ont pour objectif principal la
surveillance de la maladie dans une perspective d’indentification des facteurs de risque et
de prévention. Cette activité s’appuie sur les outils de l’épidémiologie, dont les cohortes
de patients ou en population générale. Il convient de distinguer les grandes cohortes,
instruments construits pour répondre à plusieurs questions dont certaines ne sont pas
définies par avance, et qui soulèvent la question du volume et de la pérennité de leur
financement, des cohortes (souvent de moindre taille) destinées à répondre à une
question précise et à tester des hypothèses d’intervention. Cette activité de recherche à
la fois clinique et épidémiologique profite essentiellement au système de santé, dans
toutes ses composantes.
B – FINANCEMENT DE LA RECHERCHE CLINIQUE : ETAT DES LIEUX EN FRANCE
L’exigence de qualité des données et de crédibilité des résultats s’impose à toute
recherche biomédicale
6
-
7
, et requiert un niveau de financement suffisant pour garantir
une méthodologie appropriée, des données fiables et une analyse dépourvue de biais.
Cette exigence est d’autant plus cruciale en recherche clinique que patients et volontaires
prennent des risques personnels pour réaliser ces études, et que les résultats de la
recherche ont un impact certain sur l’économie et la santé. En conséquence, le niveau de
financement des projets et l’accès à une infrastructure professionnelle constituent deux
questions cruciales en recherche clinique.
1 Financement de l’infrastructure et financement de projets
1.1 Infrastructure
En recherche clinique, le besoin d’équipement reste limité, mais la pérennité des
structures de support est capitale pour maintenir le savoir-faire, s’appuyer sur
l’expérience passée, et pour assurer la continuité dans le recueil et le traitement des
données (un essai clinique dure plusieurs années). Un financement récurrent de
l’infrastructure est donc nécessaire
8
, mais la part entre ce qui relève de l’infrastructure et
6
Begley CG, Ellis LM. Raise standards for preclinical cancer research. Nature 2012, 483 :531-533.
7
Prinz F, Schlange F, Asadullah K. Believe it or not: how much can we rely on published data on
potential drug targets ? Nat Rev Drug Discov. 2011, 10:712.
8
En France l’infrastructure est constituée essentiellement de :
- support à l’investigation: centres d’investigation clinique ou centres de recherche clinique,
personnel CeNGEPS, peu de réseaux thématiques. Ce support concerne aussi bien la recherche
clinique académique que celle promue par l’industrie, car dans les deux cas l’investigation
s’effectue au sein du système de soins.
- support à la méthodologie, au traitement de données et à la gestion de l’essai: cette
mission, essentiellement portée dans les autres pays par les ‘clinical trial units’, qui sont des
formations de recherche avec un pilotage scientifique et une évaluation compétitive, souvent
thématisées, est principalement assurée par les promoteurs institutionnels en France, avec un
pilotage plus administratif et une logique de proximité. Parfois le promoteur a mis en place des
structures-relais (URC). Ce support à la gestion et à la méthodologie concerne quasi-exclusivement
les études académiques, car les promoteurs industriels disposent de ce savoir-faire en interne ou
par l’intermédiaire de sous-traitants (CRO).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%