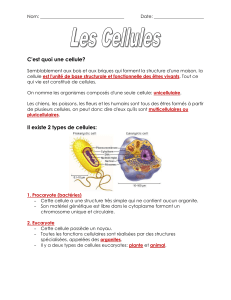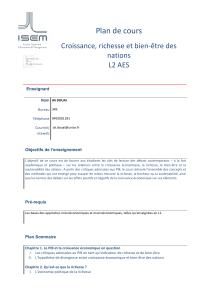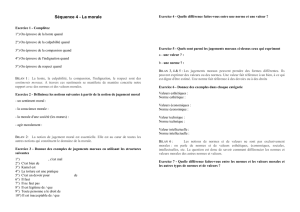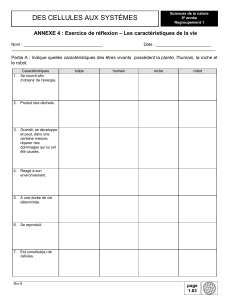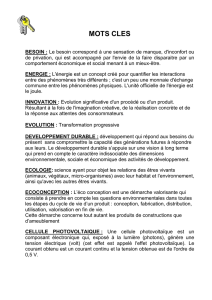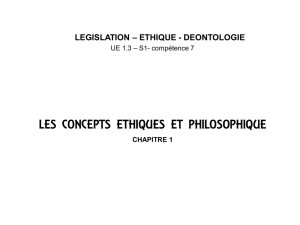pathocentrisme

!
!
!
"#$%&'()$*+,-(!
!
./012! 324! 56718759:24! ;<8=24! >02! 4/9447?12! :9! 5=7:@4@5=72! A@69:2! 8@1474;2! B!
C;9D:76!:2!867;E62!526A2;;91;!32!3C;26A7126!:24!21;7;C4!9F91;!012!G9:206!71;6714E>02H!
8/24;IBI3762!:24!DC1CJ78797624!32!1@4!@D:7?9;7@14!A@69:24!37628;24K!.2!59;=@821;674A2!
L30!?628!pathos!M!4@0JJ69182H!59447@1!NO!24;!:/9556@8=2!42:@1!:9>02::2!8/24;!:/95;7;032!
B! 624421;76! :9! 3@0:206! >07! 526A2;! 32! ;69826! :24! 8@1;@064! 32! :9! 8@AA0190;C! 324!
59;721;4!A@690PK!
Q721!>02!56C421;!21!?26A2!8=2R!>02:>024!5=7:@4@5=24!32!:/#1;7>07;CH!:2!8@1825;!
32! 59;=@821;674A2! 12! 42AD:2! 594! 9G@76! C;C! 8:9762A21;! 5214C! 2;! J@6A0:C! 9G91;! :2!
ST+++2!47E8:2K! "@06! *@044290H! 32! J9U@1! 2P2A5:9762H! 8/24;! :9! 42147D7:7;C! 324! 90;624H!
8/24;IBI3762! :206! 895987;C! B! 4@0JJ676H! >07! 1@04! M!@D:7?2!N! B! 12! :206! J9762! 90801! A9:K!
L*@044290H!5K!VWXOK!
.2!59;=@821;674A2!4/955072!406!012!8@1825;7@1!32!:9!3@0:206!718:091;!;@0;24!:24!
J@6A24! 32! 526825;7@14! 8@148721;24! 3C49?6C9D:24! ;2::24! >02! :9! 3@0:206! 5=F47>02H!
A974! 90447! :/91?@7442H! :9! =@1;2H! :/21107H! :9! J604;69;7@1! @0! :9! ;674;2442K! YE4! >0/01!
@6?9174A2!24;!21!A24062!3/9G@76!324!2P5C6721824!A21;9:24!>07!:07!4@1;!3C5:97491;24H!
7:!520;!40D76!01!;@6;!2;!32G697;!Z;62!8@1473C6CH!5@06!82;;2!6974@1!AZA2H!8@AA2!01!
59;721;!A@69:K!LQ21;=9AH!*F326OK!
(1! C;=7>02! 21G76@112A21;9:2H! :2! 59;=@821;674A2! 4/@55@42H! 3/012! 596;H! B!
:/91;=6@5@821;674A2!2;H!3/90;62!596;H!90!D7@821;674A2!2;!B!:/C8@821;674A2K!
!
Pathocentrisme-vs-anthropocentrisme-!
!
,2:@1! :/9556@8=2! 91;=6@5@821;674;2H! =C67;C2! 32! 1@;62! ;6937;7@1! 62:7?72042! 2;!
5=7:@4@5=7>02H! 1@4! 32G@764! 21G264! :9! 19;062! 2;! :24! 917A90P! 4@1;! 4;678;2A21;!
7137628;4H! 3914! :9! A24062! @[! 7:4! G7421;! 0:;7A2A21;! B! 426G76! 324! 71;C6Z;4! =0A9714K!
'26;9714!917A90PH!596!2P2A5:2H!@1;!8@AA218C!B!DC1CJ78726!3E4!:2!S+S2!47E8:2!32!:@74!
>07! C;9721;! 8214C24! :24! 56@;C?26K! -974! 82;;2! 56@;28;7@1! \06737>02! 1/7A5:7>097;! 594!
>0/@1!:206!628@1197442!012!G9:206!71;6714E>02K!.24!8@1825;7@14!91;=6@5@821;674;24!
J@1;!:/@D\2;!90\@063/=07!32!1@AD620424!867;7>024!59682!>0/2::24!C8=@021;!B!J@1326!32!
A917E62!49;74J97491;2!:2!56718752!42:@1!:2>02:!7:!24;!7AA@69:!3/71J:7?26!4914!1C82447;C!
32!:9!4@0JJ69182!90P!917A90PK!!
Y9G73! Y2]69R79! 4@0:7?12! 596! 97::2064! M!:/C;691?2;C!N! 32! :9! ;=E42! 42:@1! :9>02::2!
:/95596;219182! B! :/245E82! =0A9712! 40JJ7;! 5@06! \@076! 3/01! 4;9;0;! A@69:! 405C67206K!
*9552:91;!>02!:/CG@:0;7@1!30!G7G91;!4/24;!J97;2!32!A917E62!?69302::2!2;!>02!:24!Z;624!
=0A9714! 4@1;! :24! ;6E4! 56@8=24! 8@04714! 324! 8=7A591RC4! 30! 5@71;! 32! G02!
5=F:@?C1C;7>02H! 7:! 4@0;721;! >02! :2! J@44C! @1;@:@?7>02! >07! 42AD:2! 4C59626! :24! Homo)
sapiens! 324! 90;624! =@A7173C4! LC;271;4! @0! 1@1O! 24;! A@714! :96?2! >0/7:! 1/F! 5969^;K! +:!
9\@0;2!>0/7:!24;!96D7;69762!32!62;2176!:/M!245E82!N!5:0;_;!>02!:2!M!?2162!NH!:9!M!J9A7::2!N!
@0! :9! M!8:9442!N! 5@06! 3CJ7176! :2! ?6@052! 324! 21;7;C4! >07! 8@A5;21;! A@69:2A21;K!

Y2]69R79!1@;2!C?9:2A21;!>02!:24!7A5:789;7@14!32!:/9556@8=2!91;=6@5@821;674;2!4@1;!
8@1;62I71;07;7G24K! +A9?7126! :/2P74;2182! 3/917A90P! 47! A@37J7C4! ?C1C;7>02A21;! >0/7:4!
4269721;! 5:04! 71;2::7?21;4! >02! :24! =0A9714! @0! 218@62! 3/2P;69;26624;624! 71J717A21;!
5:04! G26;020P! >02! 1@04! 12! :2! 426@14! \9A974H! 1@04! J@682!B! 9D913@1126! :2! 5@4;0:9;!
42:@1!:2>02:!:24!Z;624!=0A9714!4@1;!:24!420:4!B!9G@76!012!G9:206!71;6714E>02K!(1J71H!
40??E62I;I7:H!:/93@5;7@1! 30! 867;E62! 32! :/95596;219182! B! :/245E82! 4914! \04;7J789;7@1!
A@69:2!4055:CA21;9762!@0G67697;!:9!5@6;2!B!:9!5@447D7:7;C!3/9G@76!628@064!B!3/90;624!
867;E624! D7@:@?7>024! 8@AA2! :9! 8@0:206! 32! :9! 5290H! :2! 42P2! @0! :/71;2::7?2182! 5@06!
374867A7126!324!Z;624!=0A9714! `!82! >07!5969^;!;@0;! B!J97;!7198825;9D:2! 90\@063/=07K!
LY2]69R79H!5K!aX!sqKOK!
(1! 62J0491;! 32! 624;6271362! :9! 8@AA0190;C! 324! 59;721;4! A@690P! 90P!Z;624!
=0A9714! A974! 21! :/C:96?74491;! 90! 8@1;69762! B! ;@04! :24! Z;624! 42147D:24H! :2!
59;=@821;674A2!526A2;!3/CG7;26!824!C8027:4K!
.9! 895987;C! B! 624421;76! :9! 3@0:206H! 8@AA2! :/95596;219182! B! :/245E82H! 24;! 012!
89698;C674;7>02! D7@:@?7>02! 3@1;! :9! 526;712182! A@69:2! 1C82447;2! A9:?6C! ;@0;! 3/Z;62!
C;9D:72K!"@06! 82! J9762H!826;9714!;2191;4! 30! 59;=@821;674A2!4/9550721;! 406! :9! 1@;7@1!
3/71;C6Z;4! 7137G7302:4! Lb271D26?OK! +:4! 8@1473E621;! >02! :24! 7137G7304! 8959D:24!
3/2P5C6721824!9?6C9D:24!@0!3C49?6C9D:24!42!4@08721;!32!82!>07!:206!9667G2H!>02!:206!
47;09;7@1!520;!Z;62!9AC:7@6C2!@0!3C;C67@6C2!32!:206!5@71;!32!G02!40D\28;7J!2;!>0/21!
4@AA2! :206! G72! A21;9:2! 24;! 9JJ28;C2! 596! :2! A@132! >07! :24! 21;@062K! .24! Z;624!
42147D:24!9069721;!3@18!71;C6Z;!B!@D;2176!82!>07!J9G@6742!:206!D721IZ;62!2;!B!12!594!
40D76! 32! 3@AA9?24K! Y914! 82;;2! 5264528;7G2H! ;@04! :24! Z;624! 42147D:24! 4@1;!
404825;7D:24!32!40D76!324!56C\037824!3@1;!7:4!4@0JJ621;!8@14872AA21;!2;!7:4!32G69721;!
21!8@14C>02182!Z;62!691?C4!3914!:9!89;C?@672!324!59;721;4!A@690PK!
'26;24H! :2!420:! J97;! >02! ;@04! :24! Z;624! 8959D:24! 32! 4@0JJ676! 4@721;! 37?124! 32!
8@1473C69;7@1! A@69:2! 1/7A5:7>02! 594! ipso) facto) >0/@1! 3@7G2! :206! 628@119^;62! 012!
C?9:2!G9:206!71;6714E>02!@0!01!4;9;0;!A@69:!7321;7>02K!.2!59;=@821;674A2!5@06697;!
3@18! 4/988@AA@326! 3/012! 5@47;7@1! 45C874;2! 8@1474;91;! B! J9G@67426! ;@0\@064! :24!
A2AD624! 32! :/245E82! =0A9712! 90! 3C;67A21;! 324! A2AD624! 324! 90;624! 245E824!
917A9:24K!'2;!91;7IC?9:7;9674A2!3@7;!;@0;2J@74!Z;62!\04;7J7C!9J71!32!12!594!3C6@?26!90!
56718752!J@139A21;9:!3/C?9:7;C!9674;@;C:78721H!42:@1!:2>02:!:9!\04;782!2P7?2!>02!:24!894!
47A7:97624!4@721;!;697;C4!32!J9U@1!47A7:9762K!"@06!A971;2176!>02!:2!D721IZ;62!324!Z;624!
=0A9714! 62GZ;! 5:04! 3/7A5@6;9182! A@69:2! >02! 82:07! 324! 90;624! 917A90PH! 7:! J90;!
5@0G@76! 7321;7J726! 012! 37JJC62182! 526;7121;2! 21;62! :24! 014! 2;! :24! 90;624K! &6H! 324!
867;E624!;2:4!>02!:9!8@14872182!32!4@7H!:9!69;7@19:7;CH!:/9?21;7G7;C!A@69:2H!:/0;7:749;7@1!
3/01!:91?9?2!4FAD@:7>02H!2;8K!12!526A2;;21;!594!32!\04;7J726!:2!45C874A2!32!A917E62!
49;74J97491;2!C;91;!3@11C!>0/908012!32!824!56@567C;C4!1/9JJ28;2!1C82449762A21;!:24!
2P5C6721824! 40D\28;7G24! 324! 7137G7304! >07! 21! 4@1;! 3@;C4K! ,7! ;@04! :24! 917A90P!
42147D:24!AC67;21;! 3/Z;62!8@1473C6C4! A@69:2A21;H!7:4!AC67;21;! 9!567@67! 32!:/Z;62!32!
A917E62!C?9:2K!!
(1! 42! J@1391;! 406! :/71;C6Z;! B! 12! 594! 4@0JJ676! >0/@1;! 21! 8@AA01! ;@04! :24! Z;624!
42147D:24H!:2!59;=@821;674A2!6C5@13!21J71!2;!406;@0;!B!:/71;07;7@1!:96?2A21;!596;9?C2!
42:@1! :9>02::2! :9! 4@0JJ69182! 3/01! 7137G730H! >02::2! >02! 4@7;! 4@1! 245E82H! 24;! 01! A9:!
A@69:K!
!
Pathocentrisme-vs-biocentrisme-et-écocentrisme-

!
.24!;2191;4!30!59;=@821;674A2!C:96?74421;!:2!8268:2!32!:9!A@69:7;C!90!5@71;!3/F!
718:062!;@04!:24!917A90P!42147D:24K!-974!12!32G697;I@1!J9762!01!594!32!5:04H!8@AA2!:2!
6C8:9A21;!:24!D7@821;674;24H!2;!628@119^;62!012!G9:206!A@69:2!71;6714E>02!B!;@04!:24!
Z;624!G7G91;4!c!'26;9714!90;2064!4@0;721121;!2JJ28;7G2A21;!>02!;@0;!82!>07!G7;!24;!21!
A24062! 32! \@076! 3/01! 826;971! D721IZ;62! 2;! 32! 5@44C326!324! 71;C6Z;4! 7137G7302:4!
944@87C4!B!4@1!C591@07442A21;!@0!B!:/2P268782!32!424!J@18;7@14!D7@:@?7>024K!L$9F:@6H!
#;;J72:3OK! +:4! 24;7A21;! >02! :2! M!D721IZ;62!N! 324! 7137G7304! 3C5@06G04! 32! G72! A21;9:2!
520;!Z;62!9JJ28;C!5@47;7G2A21;!@0!1C?9;7G2A21;H!2;!82!21!3C57;!30!J97;!>0/20PIAZA24!
12!5074421;!594!21!Z;62!8@148721;4K!.24!9?21;4!A@690P!9069721;!3@18!324!@D:7?9;7@14!
37628;24!1@1!420:2A21;!21G264!:24!917A90P!`!42147D:24!@0!1@1!`H!A974!C?9:2A21;!B!
:/2136@7;!324!GC?C;90PK!
Y/90;624! 5=7:@4@5=24! G@1;! 5:04! :@71! 218@62! 2;! A2;;21;! 21! 3@0;2! :9! 56CA7442!
42:@1!:9>02::2!:2!J97;!3/Z;62!21!G72!42697;!012!8@137;7@1!1C82449762!5@06!9G@76!32!:9!
G9:206! A@69:2K! #:3@! .C@5@:3! 2;! dK! Q9763! '9::78@;;! 56@5@421;! 5:04! 56C874CA21;!
3/9D913@1126!:/73C2!42:@1!:9>02::2!@1!12!520;!988@6326!32!G9:206!71;6714E>02!>0/90P!
21;7;C4!7137G7302::24!L8@AA2!:24!Z;624!=0A9714H!:24!917A90P!@0!:24!5:91;24O!90!56@J7;!
3/012!9556@8=2!=@:74;2!@0!C8@821;6C2K!"@06>0@7H!32A91321;I7:4H!12!5@06697;I@1!594!
625@04426!:24!J6@1;7E624!32!:9!8@AA0190;C!A@69:2!9J71!3/21?:@D26!:24!C8@4F4;EA24!c!
,2:@1!20PH!:/7A5@6;91;!24;!21!2JJ2;!32!M!56C426G26!:9!4;9D7:7;CH!:/71;C?67;C!2;!:9!D290;C!
32! :9! 8@AA0190;C! D7@;7>02!NK! L.C@5@:3H! 5!WefOK! .24! C>07:7D624! C8@:@?7>024H! :9!
D7@37G2647;C!@0!218@62!:9!491;C!324!C8@4F4;EA24!AC67;21;!3@18!1@;62!8@1473C69;7@1!
A@69:2K! '26;9714! C;9;4! 32! J97;! 4269721;! M!D@14! @0! A90G974! 5@06!N! :24! ;@0;4!
C8@:@?7>024H! >07! 32G69721;! 596! 8@14C>021;! 42! G@76! @8;6@F26! :2! 4;9;0;! 32! 59;721;4!
A@690PK!
g!:/=F5@;=E42!42:@1!:9>02::2!:2!D721IZ;62!1/24;!594!:/95919?2!324!21;7;C4!3@0C24!
32! 8@14872182H! .2@1963! hK! ,0A126! @D\28;2! >0/2::2! 625@42! 406! 012! 8@1J047@1!
8@1825;02::2K!+:!@D426G2!>02!:24!9556@8=24!D7@821;674;24!2;!C8@821;674;24!C8=@021;!B!
3CA@1;626!>02!:24!@6?9174A24!G7G91;4!1@1!8@148721;4!2;!:24!C8@4F4;EA24!5@44E321;!
:2!;F52! 32!G9:206! >07!520;! J@1326!01! 4;9;0;!A@69:H! 21!:/@880662182!012!G9:206!37;2!
560321;72::2H!8/24;IBI3762!012!G9:206!32!:/@6362!30!D721IZ;62H!012!G9:206!;@08=91;!B!82!
>07!24;!D@1!5@06!012!21;7;C!du)point)de)vue)subjectif)de)cette)dernièreK!.9!G9:206!3@1;!
7:!520;!Z;62!>024;7@1!5@06!:24!GC?C;90PH!:24!A@::04>024!@0!:24!A7:720P!=0A7324H!596!
2P2A5:2H!42697;!32!19;062!526J28;7@1174;2!i!2::2!12!62:EG2697;!594!32!82!>07!6213!:9!G72!
3/012! 21;7;C! 49;74J97491;2! @0! 1@1H! A974! 017>02A21;! 32! 49! 5:04! @0! A@714! ?69132!
56@P7A7;C!9G28!01!73C9:!J7PC!32!A917E62!2P;2612!@0!@D\28;7G2K!
.@64>0/@1! CG9:02! :2! 32?6C! 3/C591@07442A21;! 3/01! 96D62H! :24! 867;E624! 62;2104!
4@1;! :7C4! B! 82! >0/@1! 944@872! B! :/2P82::2182! 32! 82! GC?C;9:!i! 01! J207::9?2! J@0617H! 324!
6987124! 497124H! 012! 6C474;9182! 90P! A9:93724H! 2;8K! '2! >07! 1@04! 42AD:2! M!D@1! 5@06!N!
:/96D62! 24;! 21! J97;! 82! >07! J9G@6742! 4@1! 2P82::2182! 2;! 82! >07! 1@04! 42AD:2! M!A90G974!
5@06!N):07!24;!82!>07!:2!6213!01!A@714!D@1!45C87A21!32!4@1!?6@052K!./96D62!1/9!:07I
AZA2! 90801! 5@71;! 32! G02!j! 7:! M!1/24;! >02! :2! 5@6;206! 3/01! 826;971! ;F52! 32! G9:206!
?C1C67>02! 3C;26A71C2! 596! :2! ?6@052! 90>02:! 7:! 95596;721;!NK! L,0A126H! 5K! keOK! .9!
8@1J047@1! 21;62! G9:206! 560321;72::2! LD721IZ;62! 40D\28;7JO! 2;! G9:206! 526J28;7@1174;2!
L2P82::2182! @D\28;7G2O! 2P5:7>02697;! >02! 826;9714! 90;2064! 9;;67D021;! 266@1CA21;! 01!
D721IZ;62! L@0! 01! M!D@1! 5@06!NO! 90P! GC?C;90P! @0! 90P! C8@4F4;EA24K! &1! 520;!

CG732AA21;!596:26!32!:/2P82::2182!324!21;7;C4!5@44C391;!012!G9:206!526J28;7@1174;2K!
+:! 4/9?7;! D721! 32! :206!2P82::2182H! 21! 2JJ2;H! 5074>02! 82::2I87! 24;! J@13C2! 406! :24!
89698;C674;7>024!56@5624!32!824!21;7;C4K!-974!7:!12!4/9?7;!594!5@06!90;91;!32!:206!D721I
Z;62!21!;91;!>02!;2:H!5074>02!82;;2!1@;7@1!24;!J@139A21;9:2A21;!:7C2!B!:/9556C879;7@1!
>0/21!9!:2!40\2;!:07IAZA2K!
!
$@0;24! :24! 21;7;C4! 520G21;! 826;24! 42! 62;6@0G26! 3914! 012! 47;09;7@1! M!D@112! @0!
A90G9742!NH!A974!:24!Z;624!42147D:24!4@1;!:24!420:4!404825;7D:24!32!42!421;76!M!D721!@0!
A9:!NK!+:!12!J97;!5:04!90801!3@0;2!>02!:2!D721IZ;62!560321;72:!42!;6@0G2!90!8l06!324!
56C@88059;7@14!C;=7>024K!-974!24;I7:!5@447D:2!>02!3/90;624!;F524!32!G9:2064!5074421;!
?C1C626! 2::24! 90447! 324! @D:7?9;7@14! A@69:24!c! .9! >024;7@1! 624;2!@0G26;2K! +:! 42AD:2!
82521391;! >02! 8/24;! 90P! 526J28;7@1174;24! >0/7:!62G721;! 32! A@1;626! >02! :24! 21;7;C4!
3C5@06G024!32!42147D7:7;C4!520G21;!40D76!324!;@6;4!A@69:2A21;!47?17J789;7J4!2;!>02!
:24!9?21;4!A@690P!@1;H!5@06!82;;2!6974@1H!324!32G@764!37628;4!21G264!20PK!
!
!
!
#$$b+(.Y! *@D71H! The) Ethics) of) Environmental) ConcernH! )2m! n@6oH! '@:0AD79!
p17G2647;F!"6244H!VqefK!
Q()$%#-! d262AFH! Introduction) aux) principes) de) la) morale) et) de) législationH! "9674H!
T671H!WrVVK!
Q*())#)! #1362m! 2;! .&! n20oI,R2H! M!(1G76@1A21;9:! (;=784!NH! s#.$#!! (3m963! )KH!!
The) Stanford) Encyclopedia) of) PhilosophyH! 90;@A12! WrVVH!
=;;5itt5:9;@K4;91J@63K230t968=7G24tJ9::WrVVt21;6724t2;=784I21G76@1A21;9:K!
'#..+'&$$!dK!Q9763H!Éthique)de)la)terreH!-96427::2H!h7:356@\28;H!WrVrK!
Y2]*#s+#! Y9G73H! Taking) Sentience) Seriously):) Mental) Life) and) Moral) StatusH!
'9AD673?2H!'9AD673?2!p17G2647;F!"6244H!VqqXK!
b(+)Q(*]!d@2:H!M!.24!36@7;4!324!917A90P!2;!324!?C1C69;7@14!B!G2176!NH!PhilosophieH!
Wrre!LqkOH!5K!XuIkWK!
.(&"&.Y!#:3@H!Almanach)d’un)comté)des)sablesH!"9674H!#0D726H!VqqXK!
*&p,,(#p!d291Id98>024H!Discours)sur)l’origine)et)les)fondements)de)l’inégalité)parmi)
les)hommes,)Œuvres)complètesH!"9674H!]9::7A963H!VqXqH!;K!fK!
*nY(*!*78=963!YKH!Painism):)A)Modern)MoralityH!.@13@1H!'21;906!"6244H!WrrVK!
,+)](*!"2;26H!La)Libération)animaleH!"9674H!]69442;H!VqqfK!
$#n.&*!"90:!hKH!Respect)for)NatureH!"67182;@1H!"67182;@1!p17G2647;F!"6244H!VqeXK!
,p-)(*!.2@1963!hKH!Welfare,)Happiness)&)EthicsH!&PJ@63H!&PJ@63!p17G2647;F!"6244H!
VqqXK!
!
!
T9:C6F!]+*&pS!2;!*2191!.#*p(!
!
!
1
/
4
100%