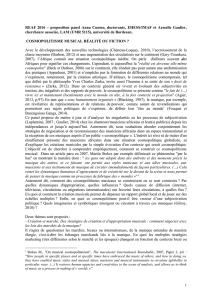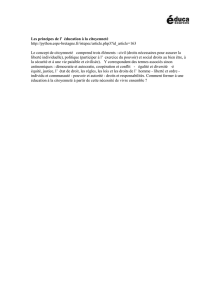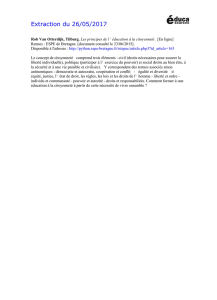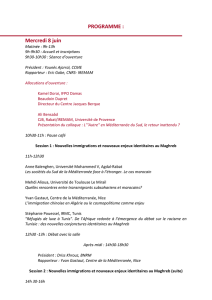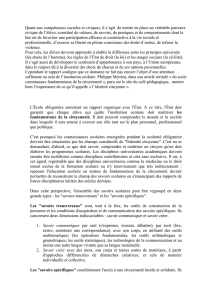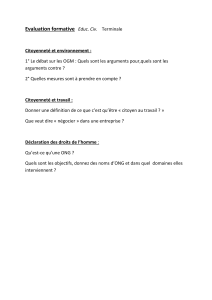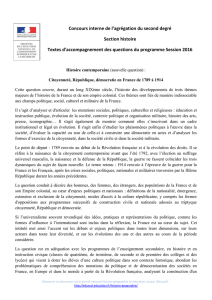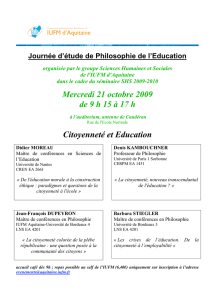Quelle réalité politique pour la notion de « citoyenneté mondiale » à

Quelle réalité politique pour la notion de « citoyenneté mondiale » à l’époque
contemporaine ?
Aspects théoriques et critiques du cosmopolitisme politique contemporain
Louis Lourme
On considère habituellement que le fait de se dire citoyen du monde est condamné à
n’être qu’une métaphore. Dans cette acception métaphorique, la citoyenneté mondiale
désigne une sorte de représentation de soi-même au sein du monde, ou au sein de
l’humanité toute entière. Le cosmopolitisme devrait alors être entendu comme un
concept relevant essentiellement de la philosophie morale. Bien sûr, même dans ce sens
métaphorique, le cosmopolitisme a toujours une dimension politique. En effet, le fait de
se dire « citoyen du monde », a des implications politiques pour celui qui revendique
cette « citoyenneté » (par exemple, celui-ci peut organiser sa délibération politique
personnelle en fonction de son cosmopolitisme). Mais la « citoyenneté » dont il est alors
question dans l’idée de citoyenneté mondiale n’est pas réellement une citoyenneté au
sens fort. Ainsi, ce que la tradition philosophique appelle « cosmopolitisme », c’est une
représentation particulière de soi, du monde, et de soi dans le monde.
Cette acception commune semble être la seule possible. On ne voit pas comment il
pourrait en être autrement. Est-ce bien le cas cependant ? De fait, au regard de la
composition du concept rien ne semble indiquer qu’il soit forcément interdit d’en
envisager une compréhension littérale et de le penser sur le plan politique. Est-il donc
nécessairement exclu que la notion de cosmopolitisme puisse renvoyer à autre chose
qu’à un sens métaphorique ? Pour le dire autrement : la citoyenneté en jeu dans l’idée
d’une citoyenneté mondiale ne peut-elle pas être comprise comme une citoyenneté
réelle ? La question fondamentale qui commande à l’ensemble de ce travail de recherche
concerne précisément le caractère métaphorique auquel le cosmopolitisme semble
condamné, et les conditions de possibilité de son dépassement. C’est ce que signifie la
question qui donne son titre à ce travail de doctorat : quelle est la réalité politique de la
notion de « citoyenneté mondiale » à l’époque contemporaine ?

Dans cette étude, je veux montrer que la modernité politique change profondément la
caractérisation classique de la citoyenneté mondiale et qu’elle permet désormais de la
penser comme citoyenneté politique à part entière. En effet, ma thèse principale est que
la période contemporaine permet une politisation inédite de la notion de
cosmopolitisme, qui la fait sortir du cadre métaphorique : elle acquiert une effectivité
politique qu’elle n’avait jamais eue auparavant.
Cette thèse s’inscrit ainsi dans la lignée des travaux actuels relevant de ce qu’on appelle
le « cosmopolitisme politique » (qui sont principalement le fait de chercheurs publiant
en langue anglaise depuis les années 1990). Ma méthode de travail a consisté à prendre
appui sur les principaux textes actuels pour dégager une structure générale du projet
cosmopolitique tel qu’il se donne à voir chez les penseurs de la « démocratie
cosmopolitique ». À partir de ces lectures, je me suis appliqué à rendre compte des
différentes dimensions possibles d’une conception de la citoyenneté mondiale effective
sur le plan politique. Comme je l’explique ci-dessous dans la présentation de la structure
de mon travail, il a par ailleurs fallu fournir des arguments à même de fonder, autant que
possible, cette entreprise de redéfinition politique du cosmopolitisme. En effet, qu’est-ce
qui justifie qu’une telle conception de la citoyenneté mondiale soit aujourd’hui possible
si elle était inenvisageable hier ?
L’ensemble de cette étude peut donc être lu, dans son ambition au moins, comme une
théorisation générale du cosmopolitisme politique contemporain.
O
RGANISATION GENERALE DU TRAVAIL
La défense de notre thèse principale suppose la défense de thèses secondaires
concernant la nature du cosmopolitisme et concernant les fondements possibles du
cosmopolitisme politique. Ce sera l’objet de nos deux premières parties.
P
ARTIE
I.
– Dans la première partie, il est nécessaire de proposer une définition de la
notion afin d’en clarifier le sens autant que possible. La variété de ses usages dans
l’histoire et à l’époque contemporaine oblige d’une part à dresser un panorama
historique des différents sens de la notion (chapitre I), et d’autre part à en analyser la
définition contemporaine selon ses usages et selon les principes fondamentaux sur
lesquels elle repose (chapitre II). Dans cette première partie, mon ambition est de

parvenir à une analyse claire du champ de la recherche contemporaine en matière
d’études cosmopolitiques, ainsi qu’à une mise en perspective des principales questions
que nous croiserons dans la suite du travail.
P
ARTIE
II. – Une fois ce travail de définition historique et normative accompli, il m’a
semblé nécessaire d’articuler la possibilité du cosmopolitisme politique avec la réalité
du processus de cosmopolitisation qui caractérise notre modernité. Cette articulation
n’était pour l’instant pas réalisée de manière systématique dans la perspective du
cosmopolitisme politique : c’est l’objet de la deuxième partie d’essayer de la mener à
bien. Le processus de cosmopolitisation doit être entendu comme le processus par
lequel le cosmopolitisme devient commun et pénètre de plus en plus la réalité de la vie
contemporaine. Il ne s’agit cependant pas de comprendre cette cosmopolitisation
uniquement en un sens sociologique, c'est-à-dire comme caractérisant la vie quotidienne
des individus. La cosmopolitisation présente deux versants que l’on peut distinguer de la
manière suivante : un versant subjectif (qui renvoie à l’émergence et au développement
de la conscience cosmopolitique) qui sera l’objet de notre chapitre III ; et un versant
objectif, au sens où il y a des éléments de cosmopolitisation qui ne dépendent pas des
représentations personnelles des individus (ou du degré de développement de leur
« conscience cosmopolitique »), mais qui contribuent à faire en sorte que nous soyons
dans une situation de cosmopolitisme de fait. Cette cosmopolitisation objective se
traduit d’abord par la remise en cause politique, économique et juridique du paradigme
classique des relations internationales (chapitre IV), puis par la situation contemporaine
de risques globaux (chapitre V). Ces deux aspects de la cosmopolitisation objective
correspondent, dans l’économie générale de notre travail, au fondement du
cosmopolitisme politique dans la mesure où ils peuvent être vus comme la manifestation
d’une sorte d’« impératif cosmopolitique » (selon les mots d’Ulrich Beck) – la
cosmopolitisation subjective pouvant, elle, être vue comme le développement de sa
« base de légitimation » (pour reprendre la formule de Jürgen Habermas que nous
commenterons).
P
ARTIE
III.
– Une fois fourni cet effort pour fonder le cosmopolitisme politique, il faut en
entreprendre une analyse systématique, c’est l’objet de notre troisième partie dans
laquelle j’entends distinguer, au sein du champ du cosmopolitisme politique, le
cosmopolitisme politique non-institutionnel et le cosmopolitisme politique

institutionnel. Le premier renvoie au développement de la société civile mondiale dont il
conviendra de mesurer la nature cosmopolitique ainsi que les faiblesses au regard
même des exigences cosmopolitiques (chapitre VI). Le second désigne quant à lui ce que
la plupart des commentateurs évoquent en parlant simplement de « cosmopolitisme
politique » (expression devenant alors synonyme de « cosmopolitisme institutionnel »),
à savoir le projet de démocratie cosmopolitique (chapitre VII). Si l’étude critique de ce
projet occupe une bonne place dans l’ensemble de ce travail, c’est qu’il en constitue le
cœur véritable. Nous devons non seulement en montrer l’architecture proprement
institutionnelle, mais aussi en analyser les présupposés conceptuels, les enjeux, et les
conséquences pratiques. Ce chapitre VII doit enfin être l’occasion d’examiner ce qu’un
tel projet institutionnel modifie dans le concept de cosmopolitisme lui-même (ce en quoi
nous aurons à nous situer sur un autre plan que celui de la théorie politique qui occupe
habituellement ces auteurs, c'est-à-dire dans une perspective propre à la philosophie
politique : l’analyse des concepts). Pour le saisir, nous aurons notamment à proposer de
nouveaux usages de certaines notions classiques (comme par exemple l’idée de
« souveraineté cosmopolitique », ou celle de « volonté cosmopolitique »). Cette thèse
principale défendue dans la troisième partie – thèse selon laquelle l’effectivité politique
de la notion de citoyenneté mondiale est modifiée de manière inédite à l’époque
contemporaine au sein du cosmopolitisme politique (institutionnel et non-
institutionnel) – exige alors une étude approfondie de la notion de « citoyenneté » elle-
même. Devons-nous penser la réalité politique de la citoyenneté mondiale de la même
manière que les autres formes de citoyenneté ? C’est la question du chapitre VIII.
P
ARTIE
IV.
– Enfin, la dernière partie (chapitre IX) est celle qui prend le temps de revenir
sur certaines critiques transversales, croisées à plusieurs endroits de l’étude mais qui
exigeaient une réponse aboutie à notre question de départ pour pouvoir être traitées.
Bien entendu, dans le corps de notre travail de thèse, nous ne négligeons pas les
différentes objections. Lorsqu’il était possible ou nécessaire d’approfondir telle ou telle
considération critique, nous menons cette critique au sein du chapitre concerné. Mais il
apparaît aussi que certains problèmes méritent un traitement différent et c’est ce qui
motive ce dernier chapitre.
1
/
4
100%