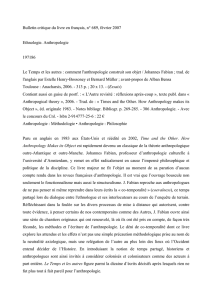télécharger la version française du texte en format pdf

329Bob W. White DONNER UN SENS À TOUT CECI
Après que Bob W. White ait pris part au Programme de formation et d’échanges en vidéo documentaire pour projet
d’art communautaire en novembre 20061, LEVIER lui a demandé de développer davantage les réflexions qu’il avait alors
présentées aux participantes au sujet de la collaboration.
Bob W. White est professeur agrégé en anthropologie à l’Université de Montréal. Il fait de la recherche de terrain à Kinshasa,
République démocratique du Congo (ancien Zaïre), et est l’auteur du livre Rumba Rules: The Politics of Dance Music in
Mobutu’s Zaire [Règles de rumba : les politiques de la musique de danse dans le Zaire de Mobutu], une monographie où
il étudie la relation entre la musique populaire et la culture politique. Il a publié des textes sur la performance et l’histoire
de la musique de danse populaire congolaise, sur la culture politique sous le régime de Mobutu, sur l’étude critique de la
musique du monde et, plus récemment, sur l’intersubjectivité dans les relations transculturelles. Il poursuit actuellement
une analyse comparative des politiques culturelles de l’Afrique francophone et une approche axée sur le public de la culture
et de la politique de l’Afrique subsaharienne contemporaine.
Le pouvoir de la collaboration
Bob W. White
Taupe : petit mammifère, répandu en Europe, en Amérique, etc., caractérisé par un corps oblong,
un pelage ras, velouté, noir ou gris argenté, un museau allongé en boutoir, des yeux très petits,
une ouïe et un odorat développés, des membres antérieurs robustes, aux mains larges, à paume
nue, aux doigts munis d’ongles tranchants, servant à fouir et qui vit sous terre, se nourrissant
d’insectes, de vers, de larves, considéré à la fois comme utile et comme nuisible aux cultures.
— Dictionnaire Larousse
Je ne vois guère plus qu’une taupe ; et d’ailleurs j’irai bientôt dans leur royaume, en regrettant fort
peu celui-ci, mais en vous regrettant beaucoup.
— Voltaire
Une taupe à l’atelier2
En m’adressant aux participantes du Programme de formation et d’échanges en vidéo documentaire pour projet d’art
communautaire organisé par Engrenage Noir / LEVIER en novembre 2006, j’ai expliqué le sentiment de saturation que j’avais
par rapport aux propos de la première journée. Comme pour confirmer cette impression, une des participantes de l’atelier,
avec un mélange d’ironie et d’affection, a comparé ma présence à celle d’une taupe. Tout au long de cette première journée
d’activités et de discussion, j’avais pensé à la possibilité et à l’importance d’intervenir, mais je ne me sentais pas prêt. Je
prenais des notes, j’écoutais, j’essayais de saisir les différents niveaux de complexité sur lesquels on m’avait demandé de
commenter, aux mains larges, à paume nue. Non seulement avais-je peur de ma voix et tout ce qu’elle représentait aux
oreilles des autres (professeur d’université, homme blanc, anthropologue), mais honnêtement, je me questionnais aussi
sur la valeur et la pertinence de mon expertise. Qu’est-ce que je venais faire dans un contexte de pratiques artistiques et
communautaires qui, comme beaucoup de contextes, n’avait probablement ni connaissance ni besoin de l’anthropologie…
considérée à la fois utile et nuisible aux cultures ? Qu’avais-je à rajouter concrètement ? La réponse à cette question, si peu
satisfaisante soit-elle, sera le sujet de ce texte.
La démarche anthropologique, une démarche qui jusqu’à un certain point a toujours requis une collaboration entre les
anthropologistes et leurs sujets, est basée sur l’observation des « autres cultures » — soit les aspects culturels des sociétés
non occidentales, étant donné qu’historiquement, la majorité des anthropologues viennent de l’Occident —, mais aussi dans
l’écoute, même si ce dernier aspect est souvent négligé dans les histoires que la discipline se raconte au sujet de son rôle
dans l’histoire. Depuis quelques années, je travaille sur l’idée de l’écoute, comme méthode3 et aussi comme métaphore4 ;
non seulement l’écoute de l’autre, mais l’écoute du soi en écoutant l’autre5. Pour des raisons qui peuvent sembler évidentes,
l’écoute fait partie intégrante de toute démarche collaborative. Cependant, la collaboration en anthropologie fait plus
souvent référence à la collaboration entre anthropologues qu’à celle entre les anthropologues et les représentants des
Bob W. White
(voir p. 107)
Page 329 – 2011.04.11 – 1ère révision, Épreuve pour impression – 06_LEVIER-Français, théorie.indd – pages 280 à 361
rv04-22,jc05-07,rv05-14.rv05-17

330
groupes qu’ils étudient. Si dans mes propres recherches j’ai tardé à travailler explicitement sur le sujet de la collaboration,
ce n’est pas seulement parce que je n’étais pas certain que ce soit un sujet acceptable aux yeux de mes collègues, mais
aussi parce que nous avons encore peu de modèles théoriques pour réfléchir sur ce sujet6. C’est pour cette raison que je
suis reconnaissant aux organisatrices du programme de formation d’Engrenage Noir / LEVIER de m’avoir donné l’occasion
de pousser ma réflexion au-delà de ma fonction d’anthropologue. Avant de répondre à la question « Pourquoi produire
ensemble ? », qui est l’objectif principal de mon texte, j’aimerais d’abord définir les différentes composantes et
dynamiques de la collaboration, et évaluer spécifiquement comment le pouvoir peut avoir un impact sur les interactions
entre les personnes.
Pouvoir et collaboration
Évidemment, quand je parle du « pouvoir de la collaboration », je joue sur l’ambiguïté du mot pouvoir, qui peut signifier
puissance, mais aussi autorité. Il est important de garder en suspens ces deux définitions du mot en considérant les enjeux
de la collaboration. S’il est vrai, comme dirait Michel Foucault, que le pouvoir n’est pas quelque chose que l’on possède, mais
plutôt un phénomène fondamentalement relationnel, « le pouvoir n’est pas quelque chose qui s’acquiert, s’arrache ou se
partage, quelque chose qu’on garde ou qu’on laisse échapper ; le pouvoir s’exerce à partir de points innombrables, et dans le
jeu de relations inégalitaires et mobiles7 ». La notion d’hégémonie utilisée par Gramsci8, qui fait une distinction cruciale entre
pouvoir et rapports de force, nous permet de nous distancer de l’opposition simpliste entre domination et résistance qui a
trop longtemps caractérisé la littérature anthropologique9. Selon l’analyse de Gramsci, l’hégémonie ne fait pas référence
à l’utilisation de la force, mais plutôt à une situation où les classes dominantes imposent une idéologie qui est présentée
comme relevant du « sens commun », acceptée et reproduite de façon globale dans une société, même par ses éléments les
Bob W. White et Serge Makobo
à Kinshasa, lors d’un appel
conférence par internet avec les
membres de l’équipe de recherche
à Dakar (Sénégal). Photo : Jean-
Claude Diyongo.
Page 330 – 2011.04.11 – 1ère révision, Épreuve pour impression – 06_LEVIER-Français, théorie.indd – pages 280 à 361
rv04-22,jc06-07,rv05-14,rv05-17

331Bob W. White DONNER UN SENS À TOUT CECI
plus marginalisés. C’est dans ce sens que l’on peut dire que les dominés participent à leur propre domination, en partie parce
que l’idéologie des classes dominantes empêche une vision critique de son fonctionnement. Autrement dit, les dominants
ont besoin des dominés. Ce modèle de pouvoir, héritier des traditions marxistes, mais aussi faisant écho aux leçons de
Platon sur la fausse conscience et l’aliénation dans son allégorie de la caverne, nous laisse entrevoir toute la complexité
relationnelle du pouvoir.
L’anthropologie s’est beaucoup penchée sur la question du pouvoir, surtout dans l’étude du « micropolitique10 », ou
l’analyse des dynamiques de pouvoir dans un contexte d’organisation social, local ou affectif. D’autre part, l’anthropologie
en tant que discipline a aussi fait l’objet de plusieurs critiques par rapport à sa façon d’asseoir sa propre autorité comme
manifestation de pouvoir. Dans une analyse toujours aussi fraîche qu’il y a 25 ans, le texte de Johannes Fabian, Time and
the Other11, suggère que l’anthropologie a en effet créé son propre objet d’étude (les peuples exotiques, les prémodernes,
les primitifs et autres) en utilisant des stratégies d’écriture qui créent des distances temporelles et géographiques entre
l’Occident et les autres cultures du monde. En effet, la dénégation du temps et de l’espace partagés — ce que Fabian nomme
co-temporalité — constitue l’effacement non seulement d’une relation d’intersubjectivité entre soi et l’Autre, mais aussi
celui de la présence de l’anthropologue observateur de formes culturelles de savoir.
L’une des critiques que l’on pourrait faire aujourd’hui de l’analyse de Fabian, c’est le fait qu’elle se limite à l’écriture (un
constat qui le met, malgré des différences importantes, dans le même courant que les postmodernistes de l’anthropologie
états-unienne) sans proposer des modèles pour comprendre ce qui est exactement effacé et comment faire pour remédier
à cette situation. Mais l’analyse de Fabian a ouvert les yeux de beaucoup d’anthropologues en les ramenant sur le terrain
ethnographique comme le lieu interculturel par excellence où le savoir produit sur les pratiques, croyances et valeurs d’un
peuple en particulier est le résultat d’une série de rencontres et de conversations. Ses travaux subséquents12 nous mettent
sur la piste d’une revalorisation des savoirs locaux et de l’impossibilité de comprendre la culture des autres en dehors de la
métaphore de la conversation. Dans ce sens-là, les travaux de Fabian ont contribué positivement à la réinscription de la
notion du savoir comme « but en lui-même », sans pour autant parler de la pratique ou de la théorie de la collaboration.
Au cours des dernières années, l’anthropologie a témoigné d’un intérêt croissant pour la question de la collaboration, non
seulement parce que tout travail ethnographique est le produit d’une collaboration soutenue entre chercheur et sujet,
mais aussi parce que la collaboration représente une porte d’entrée pour diverses discussions sur l’éthique. Selon Luke
Eric Lassiter, « l’ethnographie de collaboration est une entreprise avant tout éthique et morale, puis politique ; il ne s’agit
pas d’une entreprise à la recherche du seul savoir13 ». Il n’est plus approprié de simplement parler du « point de vue de
l’indigène », comme dans la précédente génération d’anthropologues, ni des formes « dialogiques » ou « polyphoniques »
des textes ethnographiques de la génération suivante. En anthropologie contemporaine aussi, nous constatons la présence
d’une « irruption/éruption de l’éthique14 » où l’éthique n’est pas « seulement une attitude de questionnement, disposition et
intention, mais un projet, un projet faillible et pensable, en tension avec (et par conséquent lié à) un contexte, une histoire,
une tradition, un langage15 ». S’inspirant en partie des écrits du philosophe Paul Ricoeur, Louise Lachapelle explique que tout
projet visant l’élaboration d’une éthique pour l’art communautaire doit d’abord prendre conscience du rapport historique
entre l’art comme forme autonome (« l’art pour l’art ») et l’art comme engagement social, puisque les « pratiques d’art
communautaire restent tributaires de cette culture artistique qui souhaite agir sur le monde16 ». Cette mise en garde est
aussi importante pour les théories et la pratique de collaboration.
Il est difficile de parler d’une « méthode » ou d’une « philosophie » de la collaboration17. Les approches théoriques à ce sujet
sont très variées et la plupart des modèles à notre disposition reconnaissent le fait que chaque collaboration est unique
parce que chaque collaboration est unique. Malgré ces différents facteurs de complexité, on pourrait généralement faire
une distinction entre la collaboration « participative » et « stratégique18 ». La collaboration « participative » combine des
ressources humaines et matérielles autour d’un objectif commun qui profite à tous les participants du projet, mais pas
nécessairement pour les mêmes raisons. La collaboration « stratégique » a tendance à renforcer le statut ou l’autorité de
la ou des personnes qui initient et qui encadrent la collaboration. La différence entre ces deux pôles est souvent difficile à
établir, en partie parce qu’il y a beaucoup de cas où la collaboration s’exprime au moyen d’une rhétorique participative, mais
qui au fond est structurée autour d’une approche stratégique.
Les dominés participent à leur propre domination, en partie parce que
l’idéologie des classes dominantes empêche une vision critique de son
fonctionnement. Autrement dit, les dominants ont besoin des dominés
Page 331 – 2011.04.11 – 1ère révision, Épreuve pour impression – 06_LEVIER-Français, théorie.indd – pages 280 à 361
rv04-22,jc05-07,rv05-14.rv05-17

332
Les pièges de la collaboration
Le film Culture de réparation d’Edith Regier19, projeté lors du programme de formation en vidéo documentaire organisé par
LEVIER, commence avec une phrase souvent attribuée à l’éducatrice et activiste aborigène Lila Watson : « Si tu viens ici pour
m’aider, tu perds ton temps ; mais si tu viens ici parce que ta libération est liée à la mienne, dans ce cas-là, nous pourrions
travailler ensemble. » Mais selon une contribution sur le blogue du Northland Poster Collective (un magasin en ligne de
matériel en lien avec la justice sociale), cette citation — qui a été reprise « des milliers de fois » — n’est pas le produit de la
pensée de Lila Watson. « Ricardo » (membre fondateur et artiste) explique :
Nous créons beaucoup d’art à partir de citations, et nous essayons toujours d’obtenir l’information
la plus juste possible à leur endroit. Après plusieurs années, nous avons trouvé des références
à cette citation qui mentionnaient le nom de Lila Watson. Excités d’avoir finalement trouvé
une source pour la citation, nous avons décidé de faire des recherches à son sujet. Nous avons
finalement retrouvé Lila. Elle agit toujours comme leader communautaire et activiste (à Brisbane,
je crois). En tout cas, nous lui avons expliqué que nous aimerions avoir la permission d’utiliser la
citation sur une affiche. Son mari (qui servait d’intermédiaire lors de ces conversations) savait
exactement de quelle citation il s’agissait. Elle avait déjà été largement diffusée. Lila a expliqué
qu’elle avait fait partie d’un groupe de défense des droits des aborigènes dans le Queensland
(le foyer de l’organisation du mouvement Black Power à l’époque) au début des années 1970.
Ils avaient trouvé la phrase pendant qu’ils travaillaient — probablement pour la documentation
imprimée qu’ils produisaient dans le cadre de leur mouvement d’organisation. Elle ne se rappelait pas
exactement comment cela s’était produit. Toutefois, elle a exprimé clairement qu’elle se sentait mal
à l’aise de se voir attribuer quelque chose qui avait émergé lors d’un processus collectif20.
À la suite de cette information, Northland a commencé à utiliser l’attribution « Aboriginal activists group, Queensland,
1970s », malgré les messages accusateurs qu’ils reçoivent de temps à autre à ce sujet : « Bien sûr, nous recevions encore
quelques courriels indignés du genre “vous savez que vous devriez attribuer cette citation à Lila Watson, activiste et
éducatrice aborigène21”… » L’ironie de cette histoire est évidente : malgré l’importance que la citation donne à une
démarche collaborative, le processus du travail collectif est globalement effacé en voulant attribuer l’idée au génie d’un
individu22. Dans la section suivante, je vais explorer la complexité de cette phrase en considérant la signification de ses
différentes composantes.
« Si tu viens ici pour m’aider tu perds ton temps… »
La deuxième moitié du 20e siècle pourrait être décrite comme l’ère humanitaire et plusieurs auteurs ont décrit les effets
politiques d’une culture ou d’une industrie d’intervention23. Mais cette tradition de « venir pour vous aider » n’a certainement
pas commencé avec l’émergence de la catégorie « tiers-monde24 ». Avant l’aide humanitaire, l’anthropologie voulait sauver
des cultures autochtones dont les traditions semblaient être en voie de disparition, mais l’anthropologie a aussi été un
instrument de domination dans l’élaboration du projet colonial25. En outre, et depuis plus longtemps, le christianisme s’est
répandu partout dans le monde pour sauver des âmes, souvent avec des effets dévastateurs. La volonté d’aider les autres
n’est pas mauvaise en soi, mais le désir de les sauver présente certains pièges :
La violence, la créativité et la tendance à vouloir sauver les autres sont si
étroitement liées qu’il n’est pas surprenant que l’anxiété vécue au seuil du
changement soit souvent exprimée par de la violence ou par des tentatives
d’héroïsme — tandis que la créativité et le développement personnel sont
beaucoup plus exigeants26.
Je partage avec Julie Fiala le souci de vouloir distinguer les collaborations authentiques
de « celles qui prétendent le faire », même si je sais que la notion d’authenticité est
problématique et que le modèle du continuum ne règle pas la question de l’opposition. Dans
un des rares textes qui analysent en termes concrets le rapport entre les intentions et les
retombées du travail collaboratif, Fiala présente trois exemples de collaboration dans le
contexte de l’art communautaire. Selon elle, le projet collaboratif de l’artiste Judy Chicago
(The Dinner Party27) « est moins collaboratif que directif, plus directif que coopératif28 », et
la démarche de l’artiste Suzanne Lacy29 se cache derrière une rhétorique collaborative : « La
relation entre son soi et Autrui n’a plus rien de réciproque : les autres sont devenus les pions Entrevue de groupe avec les membres de la première génération d’ama-
teurs de musique à Kinshasa en 2005. Photo : Serge Makobo.
Page 332 – 2011.04.11 – 1ère révision, Épreuve pour impression – 06_LEVIER-Français, théorie.indd – pages 280 à 361
rv04-22,jc06-07,rv05-14,rv05-17

333Bob W. White DONNER UN SENS À TOUT CECI
de son jeu de société30. » L’analyse de Fiala est détaillée et pointue, autant du point de vue artistique que dans sa réflexion
éthique. Elle oppose le travail de Chicago et de Lacy avec celui de Carol Condé et Karl Beveridge31, qu’elle considère beaucoup
plus collaboratif. On remarque toutefois que Fiala apporte moins de preuves à l’appui pour l’exemple collaboratif (Condé et
Beveridge) que pour les exemples directifs (Chicago et Lacy), soit parce qu’il est plus facile de dire ce que la collaboration
n’est pas que de dire ce qu’elle est, soit parce que Fiala serait plus favorable à la collaboration de Condé et Beveridge. Dans
l’un ou l’autre cas, ce qui n’est pas dit semble important ici.
« Mais si tu viens ici parce que ta libération est liée à la mienne… »
L’un des plus grands pièges de vouloir venir en aide à l’Autre, c’est le manque de distance de soi et le danger que le soi
projette son besoin d’efficacité (« C’est horrible ! Il faut faire quelque chose ! ») et de reconnaissance (« Nous sommes
leur seul espoir ») sur les autres. Alors de ce point de vue, l’Autre n’est pas quelqu’un qui se bat tous les jours pour atteindre
ses objectifs et qui fait face à des obstacles invisibles à l’étranger, mais quelqu’un qui a besoin d’être libéré, quelqu’un qui
souffre, quelqu’un sans ressource et sans recours. La notion de la résonance, un concept important dans la compréhension
des dynamiques intersubjectives et interculturelles, pourrait aider le soi à se détacher de lui-même. Selon l’ethnologue
norvégienne Unni Wikan :
Ainsi, la résonance exige quelque chose des deux partis dans la communication, autant du lecteur
que de l’auteur : un effort de sentiment-pensée, une volonté d’entrer en contact avec un autre
univers, une autre vie, ou une autre idée : une capacité de recourir à sa propre expérience [...]
pour tenter de saisir ou de véhiculer des significations qui ne sont logées ni dans les mots, ni dans
les « faits » ou le texte, mais qui sont suggérées dans la rencontre entre deux sujets expérientiels,
ou entre un tel sujet et un texte32.
On peut définir la résonance comme le sentiment ou réaction émotive qui remonte en nous devant la différence de l’Autre :
dédain, peur, frustration, confusion, fascination, inquiétude, colère, etc. La résonance en soi n’est pas productive. Au
contraire, si elle reste dans le domaine du non-dit, elle peut avoir des conséquences très négatives sur le rapport entre le
soi et l’Autre. Mais comme la notion du préjugé présentée par Hans-Georg Gadamer33, et puisque comme le préjugé elle est
universelle, l’utilisation éclairée de la résonance est une condition nécessaire pour une démarche intersubjective ou
collaborative. Autrement dit, la prise de conscience du bagage individuel, social et culturel du soi est essentielle à notre
compréhension de l’Autre ; en effet, selon Gadamer, il en est la condition même.
La résonance, comme prise de conscience de la souffrance du soi, permet au soi de mieux comprendre le lien entre sa propre
libération et celle de l’Autre. Il est vrai, comme Martin Luther King le proposait, que l’injustice serait l’affaire de tout le
monde (« Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier »), mais il est important
aussi de montrer comment le privilège se cache derrière une idéologie de la circonstance opportune ou de la persévérance
(dont la plus haute expression demeure le fameux « rêve américain ») et comment, dans l’histoire du monde, l’accumulation
de la richesse n’est pas tant le fruit du progrès que la conséquence de l’exploitation. C’est dans ce sens que la libération du
soi est liée à la libération de l’Autre : pendant que certains sont menacés dans leur survie, d’autres sont emprisonnés par les
toiles de l’idéologie qui justifie leur privilège :
Malgré son amertume et sa violence, l’essentiel de l’œuvre de Fanon est de forcer la métropole
européenne à penser son histoire conjointement à celle des colonies qui se relèvent de la stupeur
cruelle et de l’immobilité abusée de la domination impériale…34
Travailler avec l’Autre nécessite une reconnaissance de la part du soi de sa propre perception, mais aussi de sa vulnérabilité :
C’est précisément cette « vulnérabilité intersubjective » qui situe la collaboration par rapport à
l’éthique, non pas une éthique d’individuation qui sépare le soi de l’Autre, mais plutôt une éthique
de responsabilité qui réunit le soi et l’Autre. L’éthique collaborative, je crois, se rapproche du
second modèle de Gilligan : c’est une éthique d’attention, de réactivité, de responsabilité35.
Quand nous nous mettons au dé de produire quelque chose ensemble,
les dynamiques de pouvoir et les objectifs par rapport au travail
à eectuer ensemble deviennent explicites
Page 333 – 2011.04.11 – 1ère révision, Épreuve pour impression – 06_LEVIER-Français, théorie.indd – pages 280 à 361
rv04-22,jc05-07,rv05-14.rv05-17
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%