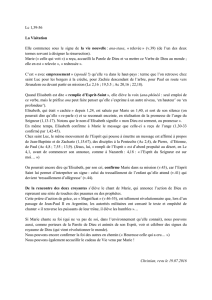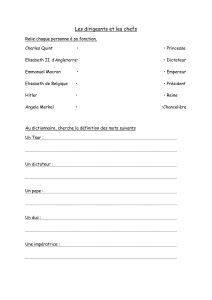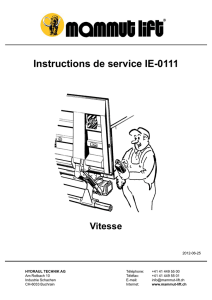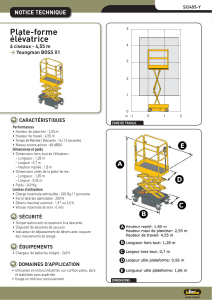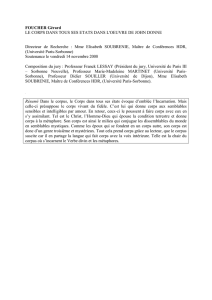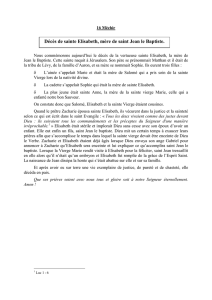LE CONCEPT DE LA DESCENTE DU « TOMBEAU DES ROIS

LE CONCEPT DE LA DESCENTE DU « TOMBEAU DES ROIS »
TEL QU'IL EST POURSUIVI DANS KAMOURASKA
THE CONCEPT OF DESCENT IN "LE TOMBEAU DES ROIS "
AS DEVELOPED IN KAMOURASKA
By
Ewan Good
Bachelor's Degree
BA University of Nottingham, 1983
A THESIS
Submitted in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree of
Masters of Arts
(in French)
The Graduate School
The University of Maine
August, 2009
Advisory Committee:
Kathryn Slott, Associate Professor of French, advisor
Raymond Pelletier, Associate Professor of French
Susan Pinette, Associate Professor of French

LE CONCEPT DE LA DESCENTE DU «TOMBEAU DES ROIS » TEL QU'IL
EST POURSUIVI DANS KAMOURASKA
Par Ewan Good
Conseillère de Mémoire : Dr. Kathryn Slott
Un Abstrait de Mémoire Présenté
pour satisfaire aux Exigences de la Maîtrise
(en Français)
Août 2009
Dans la thèse sur le concept de la descente du « Tombeau des rois » tel qu'il est
poursuivi dans le roman Kamouraska d'Anne Hébert, nous avons voulu suivre le
personnage dans sa descente en lui-même et analyser les chemins qui l'y mènent.
Nous sommes partis d'une analyse de la descente dans le poème « Le Tombeau
des rois », vingt-septième poème du recueil du même titre. Il est narré par une voix
onirique. L'atmosphère de rêve et d'une narration donc incertaine revient dans le roman.
La personne descend dans le monde des rois morts. Cette femme semble désorientée et
son anxiété croît dans la descente. Le personnage du roman se verra pris d'une semblable
anxiété croissante. La femme du poème rencontre finalement un choc, car elle sera violée
par les rois morts. Ce choc la rendra en quelque sorte à elle-même, car elle quittera la
passivité pour tuer ces rois. Selon une interprétation possible du poème, elle connaîtra par
cela la liberté et le salut. Le cauchemardesque suit souvent Elisabeth, le personnage
principal du roman, et sa descente mentale la mène toujours plus prêt de son moment
choc et de son acceptation de sa complicité dans le meurtre de son premier mari.

Nous avons voulu voir un semblable mouvement de descente dans le roman
Kamouraska. Nous avons remarqué que ce mouvement est également présent dans
d'autres romans, tels Les fous de Bassan ou Le Premier Jardin, mais nous nous sommes
attardés presque exclusivement au premier de ces romans.
Nous avons commencé l'analyse de ce concept par des interprétations de la
descente. Les personnages principaux sont moralement déchus; nous avons premièrement
donc une descente morale peinte en images et en symboles de la Bible et de la
mythologie. Nous avons voulu démontrer que ces symboles de gouffres,
d'ensevelissement et de noyade ne sont pas de simples illustrations, mais qu'elles portent
la narration et la descente toujours plus bas. Ces personnages dans le péché cherchent le
rachat, et les images, ainsi que dans le Nouveau Testament, sont souvent des images de
lavage purificateur.
Ce qui nous intéressait surtout était le chemin mental que suit Elisabeth dans sa
descente. Nous avons noté que pour cette descente que nous avons appelée
psychologique, Anne Hébert se retire, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas à sa propre
« voix » d'auteur de trop percer, laissant ainsi libre cours à la voix du monologue
intérieur. Nous avons voulu comprendre ce qui poussait les personnages à la violence et
avons donc examiné les injustices sociales de l'époque et surtout les manques
psychologiques des personnages. Nous nous sommes surtout ici attardés sur une nostalgie
de l'enfance volée du personnage et son isolement. Il cherche un retour à l'innocence.
La douleur du personnage qui n'arrive pas à exprimer sa souffrance finit dans le
cri.
Ce cri en est un de douleur, mais aussi rattache le personnage à une essence d'avant
les temps, d'avant l'emprise des règles parfois étouffantes de la société. Nous avons

conclu que le cri accompagne la descente en ce qu'il marque un mouvement vers une
liberté espérée. Nous avons cherché les représentations symboliques de la descente
psychologique et avons insisté surtout sur le rôle des symboles de l'arbre, de l'eau et du
miroir qui portent le personnage plus bas et vers sa vérité.
Cette descente psychologique et symbolique mène souvent le personnage dans le
cauchemar hallucinatoire. Lorsqu'il arrive à cet état, il semble perdre tout poids et
volume. Le temps semble se perdre dans la narration. La descente en soi se manifeste par
un mouvement de plongée du personnage dans le passé et le délire, suivi d'une remontée,
dans laquelle le personnage tente de s'accrocher au monde réel, puis de nouvelle plongée
plus en profondeur. Dans la descente nous nous sommes intéressés à la notion du temps.
Nous avons noté que malgré le désordre apparent de la narration, il existe deux courants
en sens inverse : un courant de narration qui va de l'enfance au crime, et un autre dans le
sens inverse qui va à rebours depuis le temps du présent vers le passé. Les deux courants
se rencontrent au moment clé du crime.
Nous avons examiné différentes interprétations de la fin du roman. Lorsqu'elle
sort de sa dernière vision cauchemardesque, soit Elisabeth est « libérée » et peut rejoindre
le monde des vivants, soit elle demeure dans son cauchemar, étant « morte » en dedans,
et ayant abouti à la fin au point de départ. Hébert semble nous laisser interpréter. Nous
penchons toutefois vers la vision tragique d'un personnage encore enfermé en lui et en
son époque, donc d'une Elisabeth piégée au fond de sa descente.

THE CONCEPT OF DESCENT IN "LE TOMBEAU DES ROIS"
AS DEVELOPED IN KAMOURASKA
By Ewan Good
Thesis Advisor: Dr. Kathryn Slott
An Abstract of the Thesis presented
in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Degree of Master of Arts
(in French)
August 2009
In the thesis on the concept of descent in "Le Tombeau des rois" as developed in
Anne Hebert's novel Kamouraska, we wanted to follow the character in her inward
descent and to analyze the paths which lead her there.
We started with a study of descent in the poem "Le Tombeau des rois," which is
the twenty seventh poem in an anthology bearing the same title. The poem is told by a
voice from a dream. The dream atmosphere and thereby questionable narrator feature
again in the novel. The person in the dream descends into the world of dead kings. The
woman seems to have lost her bearings and is increasingly anxious as she goes down.
The main character in the novel will similarly become anxious. The woman from the
poem finally comes to a moment of shock and horror, for she is raped by the dead kings.
This shock in some way brings her back to her wits, for she ceases to be passive and kills
the kings. According to a possible interpretation of the poem, this will bring her freedom
and salvation. The novel's main character is often pursued by nightmarish visions. Her
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
1
/
114
100%