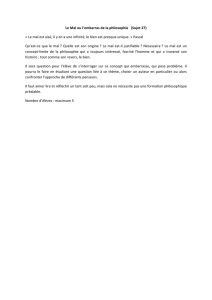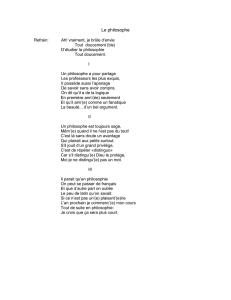L`AVENTURE DE LA PENSÉE Pour quelles raisons un être humain

L'AVENTURE DE LA PENSÉE
Pour quelles raisons un être humain se lance-t-il dans une réflexion pure,
ou encore dans une œuvre de pensée ? Quelle peut bien être l'utilité d'un
pareil travail ? Car travail il y en a une. Telles sont les plus courantes et les
plus pertinentes questions pour quiconque aborde la philosophie en
débutant, comme pour celui qui s'est déjà engagé dans ce travail et qui,
occasionnellement, ne peut se retenir de s'interroger sur le sens de son
entreprise. Or, une réponse précise et satisfaisante à ces questions est
impossible à donner.
Le bienfait ou l'utilité de posséder personnellement une philosophie,
originale ou non, ne peut pas être connu avant et indépendamment de
son acquisition, et ce bienfait dépendra du contenu de cette philosophie.
De fait, il n'est pas exclu que, étant donné son contenu, le bienfait soit
peu appréciable ; qu'il soit même plutôt négatif. Or, si la philosophie
existe malgré tout comme institution dans nos sociétés, cela signifie
qu'elle répond à un besoin général. L'esprit des hommes, un jour ou
l'autre, se voit investi par des questions auxquelles aucune espèce
d'opinions disponibles n'apporte de réponse satisfaisante. Alors certains
se mettent à travailler ces opinions, à essayer de les perfectionner et ils
découvrent que d'autres questions naissent et d'autres réponses. Un jeu
et un travail commencent, dont ils ne savent ni où ni quand il s'arrêtera
et si le résultat final sera un bienfait ou au contraire un fardeau à porter.
Il y a donc un besoin de philosophie, qui renvoie à l'indétermination
foncière de l'être humain, c'est-à-dire à sa liberté. Cette liberté sécrète de
l'angoisse, et l'angoisse fait toujours apparaitre la question du sens de
l'existence. Pour qui ou quoi sommes-nous au monde ? Que faisons-nous
là ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Et ces questions renvoient à
d'autres : Qui suis-je ? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme ? Nul
n'arrive à se guérir de l'angoisse finalement s'il ne parvient pas un jour à
donner une réponse un peu précise à ces quelques questions, qui font
démarrer le travail philosophique.
Nous ne saurons jamais si nos réponses sont vraiment vraies ni si le temps
que nous consacrons à cette entreprise n'est pas totalement perdu.
L'œuvre de pensée aura donc toujours le caractère d'une aventure. Cela
signifie à peu près que le penseur part sans savoir où il va et sans savoir
ce qui l'attend sur sa route. En cela il ressemble au vagabond, qui part

parce qu'il n'aime pas la situation qui est la sienne, parce qu'il ne se sent
pas bien là où il se trouve. Il a conçu des doutes sur la valeur des réponses
habituelles, toutes faites, à certains problèmes, et il entreprend de
repenser les choses pour lui-même et par lui-même.
Certes, le malaise de l'âme ou de l'esprit qui incite à se lancer dans
l'aventure philosophique pourrait toujours être sinon guéri, du moins
calmé, par la religion. Celle-ci se propose explicitement de répondre aux
questions métaphysiques de l'origine et de la destination de la vie
humaine et elle offre des moyens pratiques pour atteindre à la quiétude
intérieure. Qu'il y ait de nombreuses religions n'est pas à priori un
argument contre elles. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire qu'un philosophe
rejette absolument la religion du groupe auquel il appartient. Cette
chose-là d'ailleurs est plus facile à faire en paroles qu'en actes, car un
grand nombre d'idées, de conceptions, de valeurs, de préjugés qu'il a en
commun avec ceux de son groupe ont leur racine dans sa tradition
religieuse, et vouloir s'en débarrasser entièrement reviendrait à
commettre une sorte de suicide intellectuel. Cependant, ce qui
caractérise le penseur dans son rapport à la religion, c'est de ne pas
trouver en elle la réponse exacte et précise à son questionnement ; c'est
de vouloir une saisie plus intime, plus personnelle, du sens de l'existence
humaine tant individuelle que collective.
L'activité de pensée mobilise le cœur de l'homme et c'est là tout d'abord
qu'elle répand le doute et le malaise, s'il ne s'y trouve déjà. Ce faisant elle
occupe l'individu, le dérange dans ce qu'il y a en lui de plus important.
Monopolisant son esprit, elle le démobilise de l'existence ordinaire,
laquelle tourne généralement sur elle-même en supposant que tous les
grands problèmes ont reçu une solution satisfaisante. De fait, toute
société possède une culture fonctionnant selon une certaine philosophie
qui inspire ses lois, ses coutumes, ses traditions, et dans laquelle se
trouvent des solutions tenues pour satisfaisantes à tous les grands
problèmes. Mais cette philosophie commune ne serait-elle pas une
simple idéologie ? Celui qui décide de faire œuvre de philosophie la tient
de fait pour telle, c'est-à-dire, compromise par des intérêts de toute
nature.
Cela étant, les rapports du philosophe avec sa société seront toujours
problématiques, et ils le seront d'autant qu’il sera plus radical, c'est-à-dire
s'éloignera davantage de cette idéologie. En effet, ce qui de prime abord

distingue un philosophe des autres penseurs plus imprégnés d'idéologie
que lui, c'est la radicalité de sa pensée et le fait que les problèmes qu'il
s'efforce de penser vont jusqu'au fondement des choses et de l'homme
lui-même. Plus son questionnement sera original, plus il aura besoin de
liberté et plus il devra s'éloigner de la place publique, des affaires, des
institutions même. De toute façon, il n’apparaitrait là que comme un
« mauvais esprit », ou comme un névrosé, un malade.
Toutes les institutions se prennent au sérieux et elles ne peuvent
fonctionner convenablement que si les individus qui y sont intégrés
croient en leur valeur et, tout en assumant ses buts, entrent dans les rôles
qu'elles distribuent, dans le « théâtre » qu'elles organisent. Certes, à la
différence des institutions traditionnelles, les institutions des sociétés
modernes tendent à se fonctionnaliser, c'est-à-dire à se comporter
comme si elles étaient des machines sociales plutôt que des théâtres. Il
leur est néanmoins impossible d'éliminer entièrement toute théâtralité
de leur fonctionnement. Même s'il est de plus en plus rare qu'on se
costume pour exercer son rôle, comme les policiers, les juges, les
militaires, les prêtres le font encore, il reste que tels des acteurs, les
personnes jouent toujours aussi un rôle institutionnel en plus d'exercer
une fonction ou d'accomplir un travail. Or, ce rôle exige un minimum de
foi ou de croyance aux valeurs que l'institution représente, une adhésion
à la culture et aux idéaux qu'elle s'efforce de réaliser.
Le monde social, avec sa théâtralité particulière, constitue ainsi une gêne
pour le penseur, gêne d'autant plus grande que son travail de pensée
s'éloigne davantage des idéologies à la mode et que les institutions sont
plus fortes, plus totales, comme la chose se voit dans les pays dont le
régime politique est totalitaire. Là, en effet, la théâtralité sociale n'est pas
perçue comme une théâtralité particulière, mais comme la seule et
unique bonne façon de vivre et de penser, ce qui revient à dire que la
théâtralité n'y est pas perçue comme théâtralité et que la foi exigée n'est
pas une « foi théâtrale », mais une foi plus ou moins religieuse.
Le penseur est généralement contraint de vivre en retrait, en marge de la
société et dans une relative solitude. Rompre entièrement avec la société
et aller vivre seul dans la forêt, la montagne, le désert, en ermite, cela ne
lui est pas possible non plus, sinon exceptionnellement et temporaire-
ment. De fait, cet homme ou cette femme a aussi besoin, pour mener son
œuvre à bien, du contact avec d'autres penseurs, qu'il rencontrera en

personne ou dont il pourra se procurer les textes. Penser est en effet une
activité tellement difficile qu'elle ne peut être faite valablement sans le
concours des autres, sans l'échange et le dialogue constant avec d'autres
ayant un semblable désir de vérité.
Il faut se rappeler ici que dans le domaine de la pensée, comme dans celui
des activités purement biologiques, il n'y a pas de génération spontanée.
Les humains doivent se rencontrer, se parler, se féconder mutuellement
pour qu'un fruit – une œuvre – vienne au jour. La situation sociale du
penseur demeurera toujours ambigüe. Il sera toujours une sorte d'exilé à
l'intérieur de sa propre société. Souvent, tel Descartes, il ira vivre dans un
autre pays pour jouir ainsi d'une plus grande liberté d'esprit.
Mais ce n'est pas seulement à l'égard du monde social que le penseur doit
prendre ses distances, c'est à l'égard du monde tout court, si cet individu
aspire à penser radicalement ce qui est. Le problème de son insertion
sociale devient maintenant presque dramatique. Et tout d'abord : est-il
possible pour lui de se distancier du monde ? L'être humain n'est-il pas un
« être du monde », un être situé dans le monde et, comme tel, incapable
de s'en éloigner ou d'en sortir jamais, sauf peut-être par la mort ? Or nous
pouvons répondre au moins provisoirement qu'un certain détachement à
l'égard du monde est possible, grâce à la capacité de réflexion, d'une part,
et grâce à la possibilité que possède tout être humain de rejeter en bloc
le monde et sa propre vie dans le suicide, d'autre part.
Tout d'abord, la réflexion, est une capacité que possède l'humain de
s'arracher au monde, et non seulement à ce qu'il entend généralement
par ce mot, à savoir l'ensemble de tout ce qui existe à l'extérieur de soi,
mais même aussi de s'arracher à tout ce qui existe à l'intérieur de soi. Le
mouvement de la réflexion en est un par lequel la pensée se déprend de
ces objets qui l'accaparaient et revient sur elle-même pour les penser
comme objets, c'est-à-dire comme êtres devant elle, distincts d'elle. La
réflexion est ce mouvement de la pensée qui rend possible la conscience
de soi. Certes le soi (ou le Moi) pourra apparaitre ultérieurement comme
situé dans le monde, mais il ne pourra jamais apparaitre comme une
simple partie du monde, comme un morceau du monde, ou encore
comme un être totalement mondain. Pourquoi ? Parce que le concept de
monde, entendu comme totalité de l'être, ne peut se trouver dans une de
ses parties, le Moi, sans lui conférer un statut spécial. Ou disons mieux :

une certaine transcendance, car un Moi qui pense le monde ressemble au
moins vaguement à un dieu qui crée le monde.
Par ailleurs, cet homme qui est capable de réflexion sur le monde est aussi
capable de mettre fin à ses jours, de dire Non au monde d'une façon
définitive. Or cela n'est possible que si le monde, d'une certaine façon,
peut être considéré par lui globalement et de l'extérieur. Pouvoir rejeter
la vie, le monde, son être, cela suppose de ne pas être pris dans la vie, le
monde ou l'être. Cela suppose, comme Sartre le disait, d' « avoir du jeu »
dans son être, de ne pas être rivé au monde, de ne pas faire corps avec
lui. Ce monde, à l'instar de sa vie, l'être humain peut se l'approprier, s'en
emparer, comme il peut aussi s'en défaire.
Or, s'approprier le monde et y définir sa place comme être humain
individuel et collectif ne peut se faire que par le moyen d'une conception
d'ensemble, autrement dit d'une philosophie. L'aventure de la pensée ne
pourra donc pas consister seulement à explorer pour découvrir ce qui est.
Cette activité, qu'on pourrait dire d'analyse, devra se combiner à une
autre, qui forme son complément, qu'on pourrait dire de synthèse. Là
d'immenses possibilités s'ouvrent, dans un champ qui est proprement
celui de la philosophie. Parler d'aventure revient à dire que des décisions
devront être prises, des options choisies et des itinéraires tracés. La vérité
sera le seul guide et il est sûr que la raison ne sera pas toujours seule
autorisée à prendre la parole. Elle devra composer avec d'autres sources
de sens, notamment la poésie et la religion.
Il faut réaliser aussi que cette aventure ne peut devenir signifiante que si
la pensée qui s'y développe est autre chose qu'un phénomène particulier,
individuel et personnel. Cette pensée n'aura de valeur que si elle parvient
à rejoindre une pensée extérieure, qui se déploie dans le monde qu'elle
organise et dirige vers une fin. Le monde qui nous enveloppe n'est pas
qu'un monde de choses brutes, faites de matière et d'énergies ; ces
choses et ces forces ont une structure et obéissent à des lois qui incarnent
une pensée véritablement cosmique, à laquelle notre pensée individuelle
doit se raccorder, qu'elle doit chercher à épouser. Et à défaut d'y parvenir
au moins d'une manière grossière, qui pourra ensuite être perfectionnée
– par d'autres penseurs éventuellement –, elle est vouée à disparaitre
sans laisser de traces, ou alors à produire des catastrophes chez ceux qui
se laisseront influencer par elle.
 6
6
1
/
6
100%