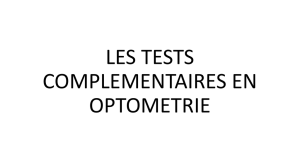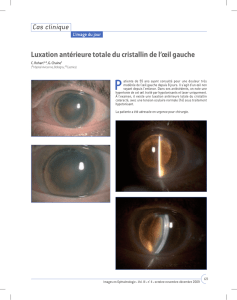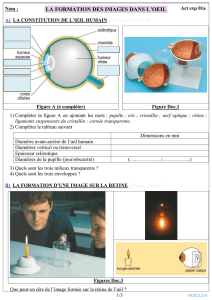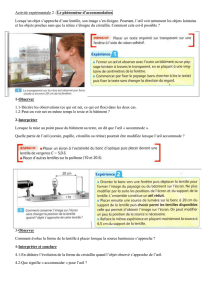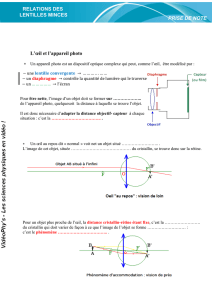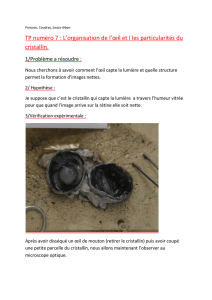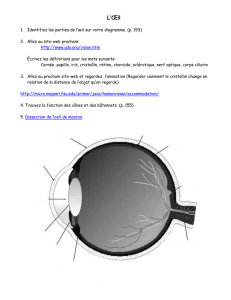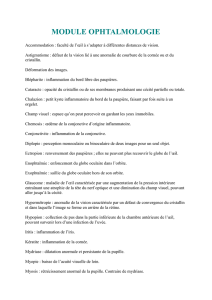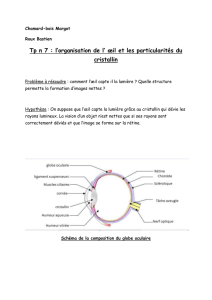Diamètre de. la cornée transparente (ouverture optique de l`œil) = i5

COMMUNICATIONS
l6l
Diamètre de. la cornée transparente (ouverture optique de l'œil)
=
i5 mm.
Profondeur de la chambre antérieure = 5 mm.
Diamètre antéro-postérieur du cristallin (épaisseur) = 7 mm.
Diamètre transversal du cristallin =
12
min.
Distance focale (du centre du cristallin pris comme point nodal à
l'épithélium rétinien) =
19
mm.
Comme
celui de tous les rapaces diurnes, l'œil de l'aigle possède deux
fovese:
l'une centrale, située au pôle postérieur (représentée sur la figure
ci-contre). C'est la
fovea
principale, située comme celle des autres oiseaux
(corvidés,
etc., etc.) et dont la ligne visuelle dirigée en dehors sert à la
vision
centrale monoculaire. Les oiseaux ont donc, pour chaque œil, un
point de vision monoculaire nette, indépendant de celui de l'autre œil.
La
seconde
fovea
(f. latérale ou temporale) est située en dehors,
c'est-à-dire du côté temporal de la première, à une distance qui est, chez
l'aigle,
d'environ 7 mm. Sa ligne visuelle, dirigée en dedans, converge
avec
celle de la
fovea
latérale de l'autre œil, et assure avec elle la vision
binoculaire.
Comme
les autres rapaces diurnes, l'aigle a donc devant lui un point
de vision
nette
binoculaire. A droite et à gauche, il a, en outre, les deux
points de vision
nette
monoculaire, fonction des fovese centrales. C'est
le
« trident visuel ».
La
plus grande acuité est celle des fovese centrales, fovese de recherche
visuelle.
Les
foveœ latérales, associées dans une vision commune, sont les
jovese
de direction, nous voulons dire de direction dans le vol plongeant,
quand le rapace fond sur sa proie et doit en estimer la position dans l'es-
pace ou sur le sol avec une précision parfaite.
On retrouve ces fovese latérales de direction chez
d'autres
prédateurs :
d'une
part, les hirondelles;
d'autre
part, les Sternes. On les signale aussi
chez le martin-pêcheur.
Les
yeux de l'oiseau de proie
étant
immobiles dans l'orbite et ayant
des axes qui divergent, ne peuvent être associés dans une vision binocu-
laire
que par des points très excentriques de leurs rétines. Chez l'homme,
grâce
à la mobilité des globes, la même
fovea
centrale assure la vision
binoculaire à toutes les distances, par le jeu de la convergence.
1
/
1
100%