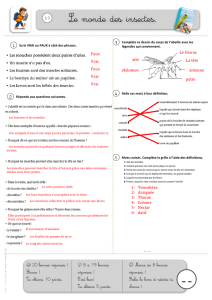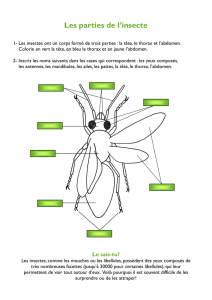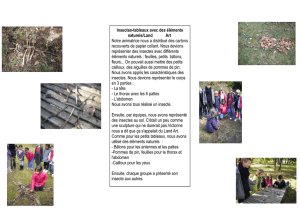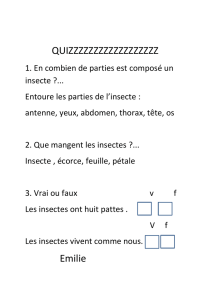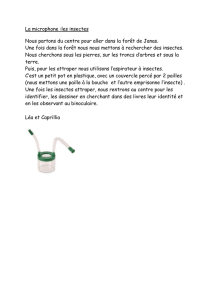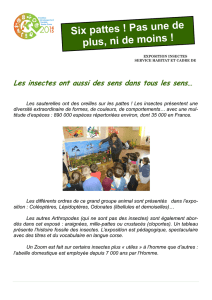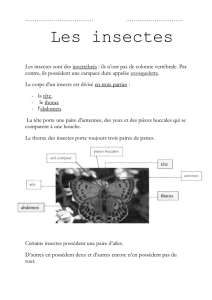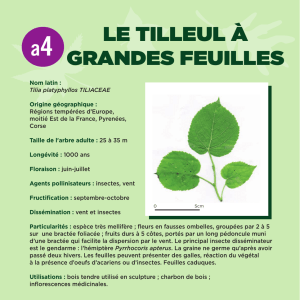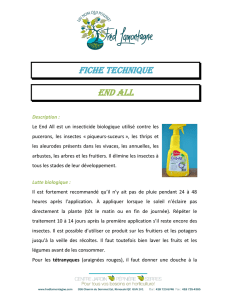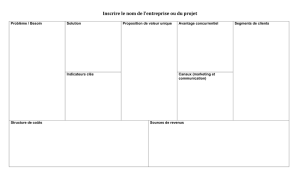Jules BARLET, morphologiste

Notes fauniques de Gembloux, n° 51 (2003) : 3-10
Jules BARLET, morphologiste
par Jacques BITSCH*
L’œuvre scientifique de J. Barlet, résultant d'une activité soutenue pendant plus
de 50 ans, est d'une rare homogénéité. Suivant la voie tracée par son maître, Fritz
Carpentier, professeur à l'Université de Liège et conservateur à l'Institut E. van
Beneden, J. Barlet s'est entièrement consacré à l'étude de la structure fine du thorax
des insectes. Partant d'observations anatomiques d'une extrême minutie, réalisées
sur un petit nombre de types morphologiques convenablement choisis, il a cherché à
établir les plans d'organisation de chacune des parties qui constituent les segments
thoraciques (régions dorsales ou tergales, latérales ou pleurales, ventrales ou
sternales) et à mettre en évidence des homologies entre des structures appartenant
à différents groupes d'insectes, et même à d'autres groupes d'Arthropodes
(Crustacés et Myriapodes). Ces études de morphologie comparée vont donc bien
au-delà de simples descriptions d'anatomistes; elles se proposent de comprendre
comment les structures élémentaires du thorax se sont formées, puis
progressivement modifiées au cours de l'évolution des Arthropodes, et cette
connaissance est essentielle pour la recherche de relations phylogénétiques entre
des groupes taxonomiques différents.
Les observations de J. Barlet ont porté sur un petit nombre d'espèces d'insectes
appartenant pour la plupart à l'ancien groupe des Aptérygotes. Il s'agit d'insectes
(ou Hexapodes) primitivement aptères, presque toujours de petite taille et vivant
dans le sol ou à sa surface. On admet actuellement que les Aptérygotes ne forment
pas un groupe naturel, mais qu'ils se composent de plusieurs lignées indépendantes,
probablement d'origine (crustacéenne?) très ancienne - les Protoures, les
Collemboles et les Diploures - ainsi que de deux ordres, les Archaeognathes ou
Machilides et les Zygentomes ou Lépismatides, qui se rapprochent davantage des
insectes "supérieurs", les Ptérygotes. Ceux-ci, grâce à l'acquisition de deux paires
d'ailes thoraciques, ont réussi la conquête du milieu aérien, point de départ d'une
intense diversification des espèces. L'étude de formes supposées archaïques
conduit à la question de l'origine des Hexapodes, puis de leur transformation vers
des formes plus évoluées. Les publications de J. Barlet concernent plus
spécialement les Diploures Campodéidés et Japygidés, les Machilides et les
représentants de trois familles de Zygentomes : les Lepismatidae, les Nicoletiidae et
les Lepidothrichidae. Cette dernière famille n'est représentée dans la nature actuelle
que par une seule espèce vivant dans des forêts de Californie, Tricholepidion
gertschi, véritable "fossile vivant" décrit pour la première fois par Wygodzinsky en
1961. Il découle des observations détaillées de J. Barlet, publiées en 1981, que les
caractéristiques du thorax de Tricholepidion relèvent d'un plan d'organisation très
proche de celui des Lepismatidae et surtout des Nicoletiidae. La conclusion
phylogénétique que laisse entrevoir J. Barlet sans toutefois l'exprimer de manière
aussi tranchée, est que, à en juger par la structure de leur thorax, les
* Professeur émérite de l’Université Paul-Sabatier de Toulouse
30, rue du lac d’Oô, F-31500 Toulouse (France).

J. Bitsch
4
Lepidothrichidae font partie intégrante de l'ordre des Zygentomes. Cette conception
s'oppose aux vues de plusieurs auteurs actuels qui mettent en doute la monophylie
des Zygentomes.
La constitution du thorax des insectes, avec ses trois segments porteurs chacun
d'une paire d'appendices locomoteurs, peut paraître simple pour un profane, mais
pour un observateur aussi minutieux que J. Barlet, les segments thoraciques
révèlent des structures d'une grande complexité (fig. 1) et d'une grande variété selon
les groupes. Les études que leur a consacrées J. Barlet prennent en compte les
différents éléments constitutifs des segments : le squelette externe ou exosquelette
(fait d'une cuticule comportant des aires sclérifiées séparées par des membranes
articulaires), le squelette interne ou endosquelette, la musculature très complexe,
enfin l'innervation des divers muscles à partir des ganglions de la chaîne nerveuse
ventrale. L'intégration de toutes ces données anatomiques précises, selon la voie
jadis tracée par Snodgrass, l'un des maîtres incontestés de la morphologie des
Insectes, est nécessaire pour reconstituer le plan d'organisation de chaque segment
pour une espèce donnée.
J. Barlet a tout particulièrement porté son attention sur les régions latérales, ou
pleurales, des segments thoraciques, qui relient les régions tergales aux régions
sternales. Les régions pleurales de chaque segment sont elles-mêmes complexes,
elles comportent plusieurs sclérifications dont l'interprétation morphologique est très
discutée. Pour certains anatomistes et embryologistes, les sclérifications pleurales
résultent de l'incorporation, au cours du développement embryonnaire, d'un article
basal (nommé subcoxa) de l'appendice, ou même de deux articles basaux. Pour
d'autres au contraire, les pièces pleurales sont des sclérifications secondaires de la
membrane pleurale, sans origine appendiculaire.
J. Barlet s'est attaché à décrire dans leurs moindres détails les différents sclérites
de la région pleurale dans les divers types morphologiques qu'il a étudiés.
S'appuyant sur des points de repère précis (attaches de baguettes
endosquelettiques et insertions musculaires notamment), il a réussi à établir des
homologies entre les différentes structures qui varient en forme et en nombre selon
les taxa considérés. Il est ainsi parvenu à montrer que la région pleurale d'un
segment thoracique d'insecte comporte typiquement deux zones semi-annulaires
superposées, nommées arc catapleural pour l'arc le plus interne (ou proximal) sur
lequel s'articule l'article basal de la patte, le coxa (Barlet a toujours écrit la coxa), et
arc anapleural pour l'arc le plus externe (plus distal). On peut également trouver
chez les insectes une pièce pleurale encore plus proximale, le trochantin, parfois
attribué à un arc trochantinal, sur lequel s'articule directement le coxa. Grâce à la
morphologie comparée, J. Barlet montre que le trochantin n'est en fait qu'une partie
proximale du coxa, secondairement détachée, alors que les arcs catapleural et
anapleural auraient une origine différente, plus ancienne. Tout en se refusant à
trancher le débat concernant l'origine de ces arcs pleuraux, J. Barlet est conduit à
penser que l'arc catapleural représente le reste d'un subcoxa incorporé au tronc,
mais que l'arc anapleural est probablement une sclérification pleurale secondaire,
sans valeur appendiculaire. A partir d'un plan de base encore clairement apparent
chez les Protoures et les Collemboles, J. Barlet fait ressortir les différentes
modifications qui ont conduit à la constitution des régions pleurales du thorax des
autres groupes d'Aptérygotes et des Ptérygotes.

Notes fauniques de Gembloux, n° 51 (2003) 5
Dans ses études de morphologie comparée, J. Barlet a attribué une grande
importance aux formations endosquelettiques qui, à l'intérieur des segments, servent
d'attache à de nombreux muscles, troncaux et appendiculaires. Ces formations,
souvent qualifiées d'endosternites car elles sont surtout développées dans les
régions sternale et pleurale des segments, ont une structure complexe, faite de
différentes tigelles reliées entre elles et insérées sur le tégument à l'une de leurs
extrémités (fig. 2). Leur étude est très délicate car, outre leur taille minuscule
(généralement inférieure au millimètre), les endosternites des Aptérygotes sont
essentiellement des formations conjonctives apparentées à des tendons
musculaires, difficiles à voir, dissoutes par les solutions de potasse souvent utilisées
pour l'étude de l'exosquelette. J. Barlet a fait presque toutes ses observations à
partir de dissections fines, réalisées sous la loupe binoculaire, les pièces disséquées
étant ensuite montées en préparations microscopiques et dessinées à l'aide d'une
chambre claire. Assez curieusement, J. Barlet s'est refusé à utiliser les
reconstitutions d'après des coupes histologiques sériées, telles que les pratiquaient
les chercheurs de "l'école dijonnaise" (J.R. Denis et ses élèves). Quoiqu'il en soit,
l'un des grands mérites de "l'école liégeoise" de morphologie, représentée par F.
Carpentier et J. Barlet, est d'avoir fourni un ensemble de données nouvelles, d'une
extrême précision, sur la constitution des endosternites thoraciques de divers
insectes. Ces chercheurs ont ainsi mis en évidence un plan fondamental des
endosternites, applicable à tous les groupes d'insectes "primitifs" et probablement à
tous les Arthropodes, ce qui constitue un argument de poids en faveur de la
monophylie de ces derniers. En outre, J. Barlet a montré qu'au cours de l'évolution
des insectes les formations endosquelettiques de nature conjonctive ont été
progressivement remplacées par des invaginations localisées de l'exosquelette
pouvant constituer, surtout chez les Ptérygotes, un puissant endosquelette
cuticulaire.
J. Barlet s'est également attaché à décrire la musculature thoracique des
Diploures, Machilides et Lépismatides. La musculature de ces insectes est d'une
grande complexité, puisque J. Barlet a pu décrire 117 muscles différents dans le
thorax d'un Heterojapyx (fig. 3), et jusqu'à 203 muscles dans le thorax de Lepisma
saccharina ou "poisson d'argent". Les surfaces d'attache de ces muscles, sur le
squelette externe ou interne des segments et sur les articles basaux des pattes,
fournissent au morphologiste autant de points de repère utiles pour l'établissement
d'homologies de structures d'un groupe à l'autre. Enfin, J. Barlet complète ses
observations myologiques par celles des principaux nerfs qui desservent les
différents muscles.
Un article important de Carpentier et Barlet (1959) compare la base des
appendices thoraciques de certains Crustacés Malacostracés avec la région pleurale
des Aptérygotes. Ce travail montre un plan d'organisation commun aux deux
groupes en ce qui concerne la structure de la région de jonction de la patte avec le
segment thoracique. Il ressort de cette étude comparative que l'article le plus basal
de l'appendice crustacéen (nommé précoxopodite et homologué au subcoxa
d'insecte) est incorporé à la région pleurale du segment, mais n'en constitue qu'une
partie (l'équivalent de la catapleure des insectes). Ces données plaident en faveur
d'un rapprochement des Hexapodes et des Crustacés, comme le suggèrent de
nombreux chercheurs actuels.

J. Bitsch
6
L'une des questions posées aux morphologistes qui étudient la région pleurale
des segments d'insectes concerne le nombre et la disposition des stigmates, orifices
respiratoires qui donnent accès aux trachées. Les stigmates thoraciques manquent
chez de nombreux Protoures et chez les Collemboles, mais dans la plupart des
autres groupes d'Aptérygotes et de Ptérygotes, deux paires de stigmates
thoraciques sont présentes. Un cas plus complexe, très bien étudié par J. Barlet, est
celui de certains Diploures Japygidae chez lesquels il existe jusqu'à quatre paires de
stigmates thoraciques. En fait, Barlet montre qu'il y a lieu de distinguer au moins
deux séries de stigmates, ceux en position intersegmentaire (ou "présegmentaire") et
ceux placés au-dessus des arcs pleuraux (en position "postsegmentaire"). Ceci
explique que deux paires de stigmates peuvent coexister dans un même segment,
mais alors ces stigmates appartiennent à des catégories différentes. Cette
distinction est importante à considérer quand on utilise l'emplacement des stigmates
comme points de repère pour établir des homologies entre sclérites pleuraux.
Une comparaison avec les Ptérygotes "inférieurs" (Blattes, Orthoptères) et même
avec certaines larves de Ptérygotes holométaboles (en particulier celles du
Mégaloptère Corydalus), a permis à J. Barlet de retrouver dans ces groupes le plan
d'organisation de la région sterno-pleurale du thorax déjà mis en évidence chez les
Aptérygotes. Enfin, dans un de ses derniers travaux, publié en 1994, J. Barlet s'est
intéressé à la position des disques imaginaux alaires présents dans le thorax des
larves d'insectes holométaboles de la famille des Tenthrèdes (Hyménoptères),
abordant ainsi la question fondamentale, encore très discutée, de l'origine de l'aile
des Ptérygotes. On sait que les ailes des insectes holométaboles (à métamorphose
complète) se forment à partir de bourgeons internes, les "disques imaginaux", qui
s'accroissent mais restent indifférenciés durant toute la vie larvaire pour ne se
développer qu'au moment de la métamorphose, lors de la dernière mue, dite "mue
imaginale" (celle qui conduit à la forme adulte, ou imago). Utilisant cette fois des
coupes histologiques du thorax, J. Barlet observe que les bourgeons alaires des
larves âgées sont placés à la limite entre aire pleurale (anapleure) et aire tergale (ou
notale), plus précisément à la face inférieure du lobe paranotal qui prolonge de
chaque côté le tergite (ou notum) des segments méso- et métathoraciques. Cette
localisation plaide en faveur de l'origine paranotale de l'aile, conception opposée à
celle d'une origine appendiculaire qui admet que l'aile des Ptérygotes dérive d'une
branche latérale (exite) portée par un article proximal de la patte, article
secondairement incorporé à la paroi latérale du segment. Mais, ici encore, J. Barlet
fait preuve d'une extrême réserve dans l'énoncé de ses conclusions, estimant
nécessaire de multiplier les recherches sur la localisation précise des disques
imaginaux chez les holométaboles avant de pouvoir véritablement trancher le débat.
Au total, les études de J. Barlet sur la structure du thorax des insectes, ont abouti
à la publication d'une soixantaine de notes dont plusieurs présentées lors de
Congrès internationaux d'Entomologie. Ces notes apportent de nombreuses
données originales à la connaissance morphologique du thorax; elles se
caractérisent par leur exceptionnelle précision et sont accompagnées d'admirables
dessins, comme en témoignent les quelques figures reproduites ici. Il faut toutefois
reconnaître que la grande honnêteté scientifique de J. Barlet, son souci de ne rien
affirmer qui n'ait été rigoureusement contrôlé, de tenir compte de tous les détails
sans en négliger aucun, l'ont dissuadé de présenter ses résultats sous forme de

Notes fauniques de Gembloux, n° 51 (2003) 7
conclusions claires et synthétiques, qui en auraient facilité la compréhension, mais
qui auraient sans doute conduit à des simplifications contraires à l'esprit rigoureux de
leur auteur. La difficulté réelle qu'on éprouve à la lecture des articles de J. Barlet a
sûrement nuit à la diffusion de ses travaux. Pourtant leur importance fondamentale
n'a pas échappé aux entomologistes intéressés par la morphologie. C'est ainsi que
R. Martsuda, auteur d'un ouvrage classique sur la morphologie des Insectes, et
notamment d'un volume entièrement consacré au thorax (publié en 1970), a utilisé
les études de Barlet sur la musculature de Lepisma comme modèle de base pour
comprendre l'évolution du thorax des Insectes. L'intérêt exceptionnel de l'ensemble
des travaux de J. Barlet a également été reconnu par la Société entomologique de
France qui, dans sa séance du 26 mars 1993, a tenu à lui décerner sa plus haute
distinction, le Prix Réaumur.
Dans l'état actuel des Sciences biologiques, et malgré les avancées de la Biologie
moléculaire, la morphologie comparée demeure l'une des principales voies d'accès à
la compréhension des relations phylogénétiques entre les innombrables taxa qui
composent les Arthropodes. Mais à la condition que les données morphologiques
utilisées atteignent un haut degré de précision, rendant possible des homologies
entre structures appartenant à des groupes différents. C'est la voie qu'a suivie J.
Barlet, avec une remarquable persévérance, avec une passion tout intérieure et
avec la plus grande modestie. Son apport à la connaissance de la structure du
thorax des insectes et à son évolution à partir de groupes basaux pour aboutir aux
Ptérygotes est de toute première importance. Incontestablement, J. Barlet peut être
compté, dans sa spécialité, parmi les grands morphologistes d'Arthropodes du
XXème siècle.
Bibliographie
Ci-dessous les deux seules références citées dans cette note, en dehors des publications de
J. Barlet dont la liste intégrale est fournie dans la notice de Leclercq & Lays (2003).
LECLERCQ, J. & LAYS, P., 2003.- Jules Barlet (1910-2002), entomologiste liégeois. Notes
fauniques de Gembloux, 51 : 11-23.
MATSUDA, R., 1970.- Morphology and evolution of the insect thorax. Memoir of the
Canadian Entomologist, 76 : 1-431.
WYGODZINSKY, P., 1961.- On a surviving representative of the Lepidotrichidae
(Thysanura). Annals of the Entomological Society of America, 54 : 621-627.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%