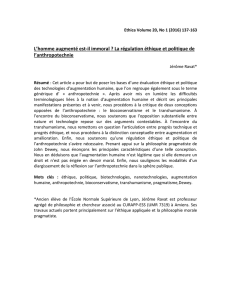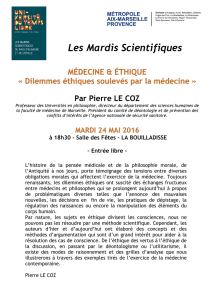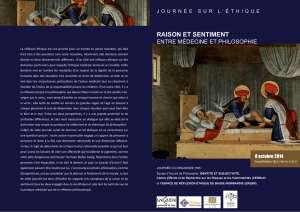Santé, médecine, décision - Faculté de médecine Pierre et Marie

Santé, médecine, décision
Maison de la recherche de la Sorbonne
28 rue serpente, Paris 6°, métro Odéon
salle D 323
de 17h à 19h30, un mercredi par mois
Séminaire organisé par
Daniel Andler, Professeur de philosophie des sciences à l’université Paris-Sorbonne
François Athané, Agrégé et docteur en philosophie
et Gérard Lambert, médecin, historien de la médecine, journaliste scientifique
Sciences, normes, décision
SND - FRE3593
Maison de la recherche de la Sorbonne
28 rue serpente, 75006 Paris
01.53.10.58.86
1

PROGRAMME 2014-2015
Mercredi 24 septembre 2014.
Gilles Barroux, Enjeux historiques et épistémologiques de la constitution d’une éthique médicale
Mercredi 8 octobre.
Florence Mathieu, Justice, médecine, réparation. Office du juge et rôle de l’expert médical dans
l’indemnisation du préjudice.
Mercredi 12 novembre.
Guillaume Lachenal et Céline Lefève, La médecine du tri, une routine d'exception
Mercredi 10 décembre. Nicolas Dodier, Montée de l’evidence-based medicine et transformations des
normes du monde médical. Réflexions à partir de l’exemple de l’épidémie de sida
Mercredi 14 janvier 2015.
Dr Liova Yon, Les soins sans consentement en psychiatrie : altération du discernement et
dangerosité
Mercredi 11 février.
Pr Philippe Cornet, L’obésité : construction sociale d’un problème de santé publique et relation
médecin-patient.
Mercredi 11 mars.
Dr Alain Piolot, L’avis des « proches » du patient en fin de vie : utilité et difficulté pour les soignants.
Mercredi 8 avril.
Pr Dominique Stoppa-Lyonnet, Droit de la propriété intellectuelle et médecine. L’exemple des
brevets sur les gènes de prédisposition aux cancers du sein
Mercredi 13 mai.
Pr Gérard Reach, Comment la médecine peut elle répondre aux nouvelles attentes des patients ?
Observance, inertie clinique et santé publique
Mercredi 10 juin.
Jérôme Goffette, Médecine et anthropotechnie : humanité soignée, augmentée, modifiée ?
Mercredi 1er juillet : séance conclusive
2

RÉSUMÉS
Mercredi 24 septembre 2014
Gilles Barroux, agrégé et docteur en philosophie, professeur en Classes Préparatoires.
Enjeux historiques et épistémologiques de la constitution d’une éthique médicale
Si l’on dispose de quantité d’histoires de la médecine, restituant de manière
conséquente les théories, les expériences et les pratiques liées à ce domaine, qu’en est-il
d’une histoire de l’éthique en médecine ? Quels en sont les fondements, les motifs ? Est-ce
en médecine, dans la philosophie ou encore dans le droit qu’il faut aller les rechercher ? L’on
ne saurait se contenter d’une approche qui évoquerait en amont le Serment d’Hippocrate et,
en aval, les comités d’éthique qui se sont développés au siècle dernier, comme une vulgate a
pu l’évoquer à diverses occasions à travers tel manuel, tel article généraliste, etc.
Le but de cet exposé n’est pas de dérouler une histoire linéaire des modalités à partir
desquelles se serait constituée une éthique en médecine, mais de regarder comment, à travers
différentes expériences, surgit la question éthique. Le cas de Pasteur constitue, de ce point de
vue, un exemple toujours intéressant à reprendre ; mais avant les questionnements de Pasteur
face à un certain Joseph Meister menacé par la rage et son impitoyable pronostic, d’autres cas
se sont posés, dans d’autres contextes, à l’instar de la question récurrente du « droit »
d’expérimenter sur des condamnés à mort ou sur des prisonniers.
Mais il s’agit aussi d’analyser cette question de l’éthique médicale en lien avec
différentes conceptions philosophiques de l’éthique. Si, en apparence, c'est plus la
déontologie et ses prémisses que le droit en tant que tel qui se trouvent évoquées dans cette
approche, les questions de juridiction ne sont jamais très loin : ce que le médecin et le
chercheur peuvent entreprendre ou non au sein de la cité peut entrer, à un moment ou à un
autre, dans le périmètre de la loi.
***
Mercredi 8 octobre
Florence Mathieu, vice-présidente du tribunal de grande instance de Reims. Enseigne à
l’École Nationale de la Magistrature.
Justice, médecine, réparation.
Office du juge et rôle de l’expert médical dans l’indemnisation du préjudice.
Le contentieux de l’indemnisation du préjudice corporel est le corollaire de celui de la
responsabilité, et intéresse nombre d’évènements et d’acteurs de notre quotidien.
L’indemnisation est consécutive à un accident de la circulation, un accident du travail, un
accident de la vie, à des violences volontaires ou à une erreur médicale. Un tel contentieux
est généraliste en ce qu’il a trait à un domaine d’intervention très vaste, tant dans le registre
du droit civil que du droit pénal. Mais il est également très technique et spécifique, parce
3

qu’il implique de nombreux acteurs : la victime et l’auteur du dommage, les tiers payeurs, les
assureurs, l’employeur et la collectivité publique à travers les fonds d’indemnisation.
Quel est l’office du juge en la matière ? Trancher la question de la responsabilité,
déterminer l’existence d’une faute et d’un dommage, évaluer et chiffrer le préjudice, entre
autres. Le juge oscille alors entre l’application d’une législation technique et spécifique et
l’appréhension de la dimension humaine, tant de l’auteur du dommage que de la victime du
préjudice. On se trouve au carrefour de la médecine et du droit, en matière de responsabilité
médicale et d’indemnisation. C’est pourquoi nous nous focaliserons particulièrement sur le
rôle et les compétences reconnues aux experts médicaux dans de telles procédures. Toutefois,
l’avis de l’expert ne lie pas le juge, qui a donc, a priori, toute latitude pour statuer sur la
situation qui lui est soumise, son objectif ultime étant de trancher le litige. Mais ceci ne peut
se faire sans que le magistrat soit confronté à des incertitudes et à des doutes, pour aboutir à
une vérité judiciaire qui est forcément humaine et toute relative.
***
Mercredi 12 novembre
Guillaume Lachenal, maître de conférences en histoire des sciences à l’université Paris
Diderot, membre de l’Institut universitaire de France,
et Céline Lefève, maître de conférences en philosophie de la médecine à l’université Paris
Diderot, directrice du Centre Georges Canguilhem.
La médecine du tri, une routine d'exception
L’intervention présentera sous l’angle de trois disciplines, l’histoire, l’anthropologie et la
philosophie, la routine d’exception que constitue le tri en médecine. Elle reviendra sur les
problèmes soulevés par l’ouvrage qui vient de paraître aux Presses Universitaires de France
sous la direction de G. Lachenal, C. Lefève et V.-K. Nguyen : La médecine du tri. Histoire,
éthique, anthropologie. Cet ouvrage fait l’hypothèse que le tri est un des paradigmes majeurs
de la médecine de notre temps.
Opération fondamentale mise au point au 19ème siècle sur les champs de bataille, le
« triage » est devenu, dans l’humanitaire et les services d’urgence, une technique de routine
permettant de hiérarchiser les patients selon leurs besoins et les possibilités de traitement.
Promesse d’une décision rationnelle et juste dans des situations dramatiques, il reste pourtant
une manière d’évaluer les existences, qui risque de reconduire sans les interroger les normes
sociales et culturelles : un acte médical à la fois indispensable et insupportable, qui sauve et
qui sacrifie des vies. Qui soigner d’abord quand les ressources manquent ? Qui faire
attendre ? Quels principes éthiques et quels critères médicaux utiliser pour classer les patients
par ordre de priorité ?
Nous reviendrons sur l’histoire du triage ; ses théâtres, ses pratiques très diverses, de
l’humanitaire et de la gestion des pandémies à la médecine générale, en passant par la
réanimation ; les logiques sociales qui l’irriguent, et les concepts éthiques qu’il mobilise.
***
4

Mercredi 10 décembre
Nicolas Dodier, directeur de recherches à l’INSERM, directeur d’études à l’EHESS.
Auteur de Leçons politiques de l’épidémie de sida, Paris, éditions de l’EHESS, 2005.
Montée de l’evidence-based medicine et transformations des normes du monde médical.
Réflexions à partir de l’exemple de l’épidémie de sida
Les controverses des années 1980 et 1990 autour de l’épidémie de sida, et
particulièrement autour des conditions d’expérimentation et de mise à disposition des
médicaments, ont mis en évidence des transformations profondes, à la fois d’ordre
scientifique et d’ordre normatif, du monde médical – dont la période critique du sida s’avère,
avec toutes ses particularités, un exemple significatif. Ces transformations révèlent les
bouleversements associés à la montée de l’evidence-based medicine. Elles concernent
globalement les formes de légitimité reconnues aux différents acteurs impliqués dans la mise
au point et la distribution des traitements (cliniciens, chercheurs, firmes pharmaceutiques,
associations de malades) et la manière d’agencer, les uns aux autres, les pouvoirs, les droits
et les devoirs attribués à chacun de ces acteurs. Nous reviendrons sur cette période et les
leçons que nous pouvons en tirer pour la médecine d’aujourd’hui.
***
Mercredi 14 janvier 2015
Dr Liova Yon, psychiatre, chef du Service Intersectoriel de Psychiatrie, C. H. U. Henri-
Mondor, Créteil.
Le problème des soins sans consentement en psychiatrie.
Privation de liberté, altération du discernement, dangerosité
***
Mercredi 11 février
Philippe Cornet, Professeur des Universités, directeur du département d’enseignement
et de recherche en médecine générale, université Pierre et Marie Curie (Paris VI).
L’obésité : construction sociale d’un problème de santé publique et relation médecin-
patient.
L’obésité ne peut se réduire au seul classement que lui assigne la nosologie médicale.
Elle implique des représentations sociales, qu’il faut analyser, parce qu’elles ont contribué à
la construire comme maladie ou comme problème de santé publique. La cacophonie des
discours sur la norme pondérale détermine aussi bien les attentes des patients que les
pratiques cliniques, les institutions médicales et les politiques de santé publique en la matière.
C’est pourquoi nous nous proposons d’appréhender l’obésité comme un dispositif, au sens
que M. Foucault et G. Agamben ont donné à ce terme : « tout ce qui a, d’une manière ou
d’une autre, la capacité de capturer, d’orienter, de déterminer, d’intercepter, de modeler, de
contrôler et d’assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants »
(G. Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif ?, 2006).
5
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%