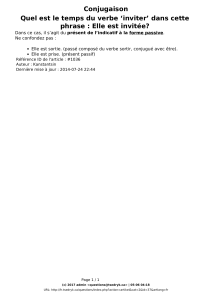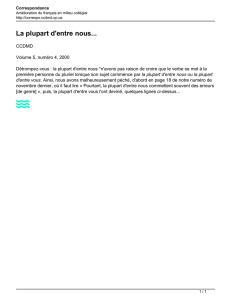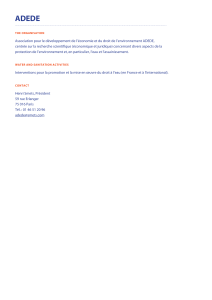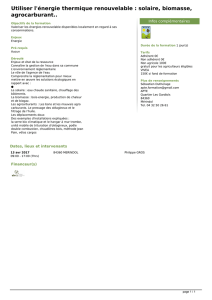Mezghani Ali, L`État inachevé

II. IslamologIe, droIt, phIlosophIe, scIences
BCAI 28 37
L’État inachevé :
la question du droit dans les pays arabes
leconstat
certains
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
BCAI 28 (2013) Mezghani Ali: L’État inachevé : la question du droit dans les pays arabes., recensé par Mohammed Hocine Benkheira
© IFAO 2017 BCAI en ligne http://www.ifao.egnet.net

II. IslamologIe, droIt, phIlosophIe, scIences
BCAI 28 38
L’idéologie
arabe contemporaine
le
en
toute ignorance
nasḫ
uṣūl al-fiqh
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
BCAI 28 (2013) Mezghani Ali: L’État inachevé : la question du droit dans les pays arabes., recensé par Mohammed Hocine Benkheira
© IFAO 2017 BCAI en ligne http://www.ifao.egnet.net

II. IslamologIe, droIt, phIlosophIe, scIences
BCAI 28 39
fiqh
fiqh
fiqh
ijtihad
International Journal of Middle East Studies
ijtihād
taqlīd
iǧtihādIslamic
Law. eory and practice
fiqh
taʿṣīb
taʿṣīb
uçulistesic
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
BCAI 28 (2013) Mezghani Ali: L’État inachevé : la question du droit dans les pays arabes., recensé par Mohammed Hocine Benkheira
© IFAO 2017 BCAI en ligne http://www.ifao.egnet.net

II. IslamologIe, droIt, phIlosophIe, scIences
BCAI 28 40
uṣūl
ibidem
masā’il
šarīʿa
ibādāt
une personne morale
unefiction
šarīʿa
res publica
res
publica
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
BCAI 28 (2013) Mezghani Ali: L’État inachevé : la question du droit dans les pays arabes., recensé par Mohammed Hocine Benkheira
© IFAO 2017 BCAI en ligne http://www.ifao.egnet.net

II. IslamologIe, droIt, phIlosophIe, scIences
BCAI 28 41
Les deux États
commonlaw
une essence
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
BCAI 28 (2013) Mezghani Ali: L’État inachevé : la question du droit dans les pays arabes., recensé par Mohammed Hocine Benkheira
© IFAO 2017 BCAI en ligne http://www.ifao.egnet.net
 6
6
1
/
6
100%