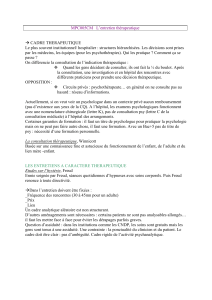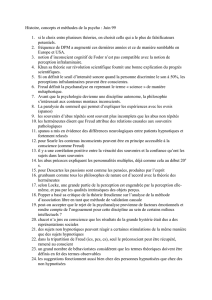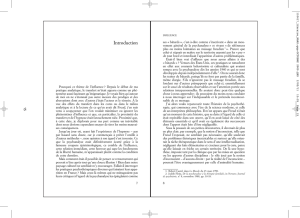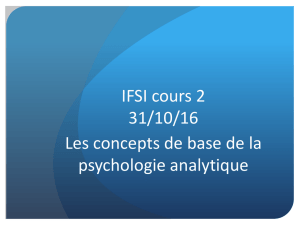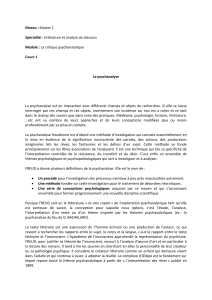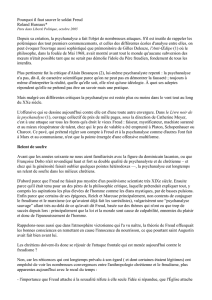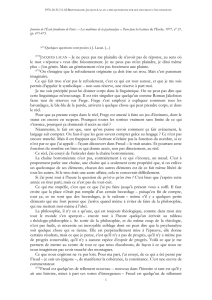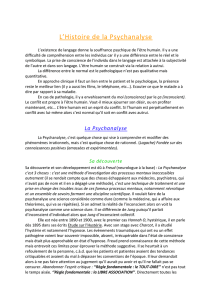Freud et la psychiatrie, essai de théorisation épistémologique

Psychiatries dans l’histoire, J. Arveiller (dir.), Caen, PUC, 2008, p. 159-170
FREUD ET LA PSYCHIATRIE,
ESSAI DE THÉORISATION ÉPISTÉMOLOGIQUE
La relation de Freud à la psychiatrie est longue, complexe et souvent couverte de mythes.
Je vais proposer quelques jalons du cheminement de la psychanalyse, en tant que théo-
risation et pratique vers une position de paradigme scientifique dominant en psychia-
trie, en essayant de m’interroger sur ce phénomène.
À la fin du xixe siècle, nous ne pouvons pas parler de la psychiatrie ou du psychia-
tre sans mettre ces termes en perspective. La psychiatrie en tant que profession naît peu
avant la psychanalyse. L’apparition de la nouvelle profession est complexe. Le champ
de la pratique n’est pas homogène. D’un côté notons l’aliéniste, le médecin des hôpi-
taux qui se définit comme un médecin qui se consacre à l’étude de la pathologie des
comportements et aux soins requis par celle-ci. De l’autre côté observons le neurolo-
gue, le spécialiste de ville qui s’occupe, des maladies des nerfs, des psychonévroses.
La psychiatrie émerge donc lentement à partir du moment où se définit un projet
de connaissance ordonnée du monde de la pathologie mentale, la folie, par l’observa-
tion clinique. Le mot psychiatrie est une création de l’aliéniste allemand Reil, appar-
tenant au courant dit de la psychiatrie romantique1.
Le premier objectif des aliénistes était de constituer un savoir. Le projet thérapeu-
tique était implicite : isoler, rassembler, définir, soigner. Le métier créait le savoir qui
à son tour inventait les soins. Pinel en est le fondateur non seulement dans le geste
mythique de désenchaîner les aliénés mais surtout avec l’introduction de l’observa-
tion clinique et de l’approche thérapeutique. L’importance théorique de l’innovation
pinélienne est celle de la reconnaissance d’un échange psychique possible, et éventuel-
lement mutatif, avec l’aliéné.
Le projet des aliénistes est de découvrir des espèces naturelles, des entités morbi-
des, des maladies, à l’instar de la médecine scientifique, basée sur l’anatomopathologie.
La découverte par Bayle en 1822 d’une corrélation entre une inflammation des ménin-
ges et des dérangements des facultés intellectuelles de la paralysie générale dépassera
son auteur et constituera le paradigme dominant de la recherche psychiatrique pen-
dant un demi-siècle donnant lieu à une pensée essentiellement organiciste. Magnan,
Falret et même Kraepelin s’inscrivent dans le projet des médecins des asiles.
1. Postel et Quétel 1983 ; Shorter 1997.

160 Nicolas Gougoulis
Pendant ce temps-là en Allemagne et en France se développe une médecine uni-
versitaire. Le titulaire de la chaire, à l’opposé du psychiatre de l’asile, qui gère le quoti-
dien des aliénés, développe une recherche et un enseignement. Le psychiatre universitaire
favorise aussi une pratique ambulatoire et tente de mettre un ordre théorique dans le
chaos clinique d’une pathologie mal définie : les maladies des nerfs, les maladies ner-
veuses, qui correspondaient aux vapeurs du xviiie siècle. Ce monde de la « demi-folie »,
opposé à celui de la folie des insensés, devient un terrain d’observation clinique et de
querelles d’appartenance2.
Charcot, en France, est une de figures de proue de cette bataille classificatrice. Les
enjeux dépassent la querelle scientifique et bien souvent sont politiques, avec l’ouver-
ture des premières consultations ambulatoires universitaires, des présentations clini-
ques publiques et une pratique de clientèle privée. La Société médico-psychologique
revendique ce terrain dès 1860 évoquant les erreurs diagnostiques des non-spécialistes.
En Allemagne, la figure dominante du psychiatre universitaire est Wilhelm Grie-
singer dont la phrase, « les maladies mentales sont des maladies du cerveau » devien-
dra plus qu’une affirmation, une orientation de recherche et d’enseignement, de sorte
que des nuances de son propos qui conduisent à ne pas négliger l’élément psycholo-
gique seront écartées par ses successeurs tels Meynert à Vienne. Celui-ci deviendra le
maître de Freud. Il essaie de définir une étiologie organique des maladies mentales
basée sur ses recherches anatomopathologiques et se désintéresse de l’aspect curatif,
du traitement moral ou d’autres traitements qu’il voit, non sans raison, comme des
palliatifs inefficaces.
La formation et la première pratique clinique de Freud
C’est dans ce contexte que se déroulent les années d’études de Freud que je me per-
mettrai de commenter en détail car on trouve souvent l’affirmation que Freud n’était
pas psychiatre mais neurologue. Ceci est à mon avis une affirmation anachronique.
En effet, Freud n’a jamais été un aliéniste, un psychiatre des hôpitaux. Cependant il
manifeste un intérêt pour la psychiatrie et devient l’assistant de Meynert, le maître de
la psychiatrie viennoise. Freud connaît de près la théorie et la pratique de la psychia-
trie telles qu’elles sont enseignées en son époque.
À Vienne après sa qualification comme médecin, la voie de la recherche lui est
fermée, la voie d’une évolution universitaire devient alors impossible pour le jeune et
ambitieux Dr Freud. Seule la voie de la spécialisation peut lui permettre de sortir de
l’anonymat et d’appartenir à l’élite médicale. Il passe donc quatre ans à l’hôpital géné-
ral, dont un semestre chez Meynert. Lorsqu’on dit que Freud n’a passé qu’un semes-
tre en psychiatrie au cours de sa spécialisation, il s’agit d’un anachronisme. C’est ce
qui s’offrait à l’époque comme formation universitaire pour un interniste spécialisé
en maladie des nerfs dans un domaine qui n’avait pas encore acquis la spécification
2. Goldstein 1987.

Freud et la psychiatrie, essai de théorisation épistémologique 161
d’aujourd’hui. Freud était un interniste spécialisé en maladies des nerfs et un des meil-
leurs, d’où la bourse qu’il a obtenue pour se perfectionner à Paris. Rappelons, si besoin
est, qu’à l’époque, il suffisait de se déclarer spécialiste pour l’être. Pour les praticiens
de ville, cependant, la spécialisation auprès d’un maître en tant qu’assistant, le titre
d’enseignant ou encore le titre honorifique de professeur extraordinaire donnaient
prestige et clientèle. Nous disposons grâce à des recherches biographiques des obser-
vations cliniques de l’assistant Freud. J’en présenterai une pour donner une idée de
ce qu’est un médecin en voie de spécialisation à la fin du xixe siècle.
il s’agit du cas d’un marchand de bois de 45 ans, habitant Vienne, admis à l’hôpi-
tal général en mai 18833. Freud note une excitation maniaque avec une tendance impé-
rieuse de bouger, de danser, de sautiller. Le patient devenait violent et menaçait de
battre quiconque s’approcher de lui. La nuit précédant l’admission, il déambulait nu
avec une bougie et avait été reconduit de force à son appartement. Premier diagnostic :
potator, idiot (remarquons la « pudeur latine » pour ne pas écrire ivrogne !). Les obser-
vations suivantes notent une fluctuation d’états d’excitation et d’apathie avec présence
d’idées de persécution, une confusion et une désorientation. L’état du patient s’aggrave
progressivement et il meurt en juin 1884 de pneumonie.
Cette observation banale, somme toute, montre que Freud avait appris l’art de
l’observation clinique d’une variété de pathologies incluant toute la gamme nosogra-
phique avec les outils diagnostiques de son époque. Il était parfaitement au courant de
la clinique psychiatrique et des limites de l’arsenal thérapeutique. Lorsqu’il évoquera,
plus tard, le « nihilisme thérapeutique » nous pouvons tranquillement affirmer qu’il
en avait une connaissance réelle4. Les maladies mentales étaient essentiellement un
terrain de recherche pour Meynert.
C’est avec ce bagage intellectuel que Freud, boursier, ira à Paris où il rencontre
Charcot, la clinique de l’hystérie, l’hypnose, dans la version de l’école de la Salpêtrière,
et une pratique ambulatoire.
Au retour de son séjour d’études à Paris, ayant quitté les cercles universitaires et
les laboratoires, le Dr Freud s’installe comme médecin de ville avec une spécialisation
dans le traitement des maladies nerveuses. Très vite il prend ses distances avec les hypo-
thèses anatomo-cliniques et surtout les théories dégénératives. Il commence à appli-
quer les méthodes qu’il a apprises : électrothérapie, hydrothérapie, divers sédatifs, cures
de repos en clinique et bien sûr l’hypnose5. Ce sont les thérapeutiques des spécialistes
de cette nouvelle pathologie des grandes villes. Sa pratique et la première théorisation
qui en est issue permettent l’ébauche d’une approche psychologique des patients nerveux
ambulatoires (hystériques, neurasthènes, anxieux et psychotiques non déficitaires).
Freud est un élève brillant de la psychiatrie universitaire, armé du bagage théori-
que et thérapeutique de pointe, de son époque. S’il a été forcé de quitter la recherche
3. Hirschmüller 1991, p. 308.
4. Freud 1916-1917.
5. Amacher 1965 ; Bernfeld 1951 ; Hirschmüller 1991.

162 Nicolas Gougoulis
universitaire et d’opter pour une carrière de spécialiste de ville, il garde son ambition
et son envie de comprendre l’objet de son étude que plus tard il appellera « fonction-
nement psychique »6. Il a la curiosité et la tendance propres à son siècle d’aller au-delà
des apparences et de découvrir les lois cachées des phénomènes psychiques de même
que Darwin recherchait les lois cachées de l’évolution ou que Charcot cherchait les
lois du fonctionnement de la grande maladie : l’hystérie.
Le jeune spécialiste des maladies nerveuses, brillant chercheur des laboratoires
universitaires, élève du psychiatre Meynert, du neurologue Charcot, de l’interniste
Breuer et de l’hypnotiste Bernheim, en bref héritier de tous ces courants de la pensée
médicale du xixe siècle, se bat maintenant avec les pathologies nerveuses, le monde
de la « demi-folie ». Ce combat ouvre la voie d’une synthèse théorique : l’invention de
la psychanalyse mais aussi de la psychiatrie moderne et de la pratique psychiatrique
de ville, telle que nous la connaissons aujourd’hui.
Le débat théorique à la fin du xixe siècle
Les premières théorisations de Freud entre 1893 et 1900 sont le résultat d’une synthèse
originale des courants de pensée que son génie a permis de redéfinir en fonction de
leurs impasses. À la fin du xixe siècle, la théorie de Meynert était regardée comme une
« mythologie du cerveau » car le paradigme anatomo-pathologique avait atteint ses
limites et devait attendre une nouvelle impulsion7.
Nous pouvons comprendre les débats des modèles théoriques à partir de plusieurs
oppositions. En premier celle des métiers : internistes / aliénistes (qui recoupe l’oppo-
sition universitaires / médecins des asiles) ; ensuite celle des pathologies rencontrées :
psychonévroses / psychoses ; enfin celle des méthodes thérapeutiques. Ces oppositions
majeures vers la fin du xixe siècle, font obstacle à une conceptualisation de l’action
psychologique thérapeutique. Examinons cela de près.
D’un côté, il existe la tradition du traitement moral pinélien, revue et réactuali-
sée à travers la tradition des aliénistes8. L’action thérapeutique se place au niveau de
la conscience, et c’est là que réside tout l’intérêt de la démarche : elle démontre qu’il
est possible d’entrer en communication même avec l’esprit le plus dérangé. Les fous
gardent une part de lucidité, qu’un médecin habile, patient, bienveillant, peut mobi-
liser dans le sens de la guérison. La persuasion, l’argumentation procédant par étapes,
la confiance aux parties de la conscience restées inaltérées par la maladie, peuvent pro-
gressivement arriver à bout des symptômes, en approfondissant leurs causes et en obte-
nant une participation volontaire du patient dans un but commun clairement défini
d’avance, c’est-à-dire, une reprise en main de soi-même par le sujet. Paul Dubois (dit
Dubois de Berne), Déjerine et, en partie, Janet, font partie de cette tendance9.
6. Freud 1911.
7. Lantéri-Laura 1988.
8. Gauchet et Swain 1986.
9. Dubois 1904 ; Déjerine et Gauckler 1911.

Freud et la psychiatrie, essai de théorisation épistémologique 163
De l’autre côté, la suggestion, hypnotique ou pas, fait preuve d’une efficacité plus
spectaculaire, plus rapide, mais souvent inconstante. Ici, le problème de la conscience
est mis entre parenthèses. Même lorsqu’il ne s’agit pas d’une mise sous hypnose, il est
clair que le procédé thérapeutique utilise la subordination de larges parties de la volonté
du patient à celle du psychothérapeute. Ainsi, à côté de l’engouement que va connaître
la suggestion hypnotique représentée brillamment par Bernheim10 et l’École de Nancy,
des critiques de plus en plus vives vont apparaître contre la dépendance induite par
ce traitement et même sa dangerosité comme le soulignait Déjerine.
Ces deux positions sont moins tranchées qu’elles n’apparaissent. Déjerine, lui-
même, n’ignore pas que ce qu’il présente comme une psychothérapie faisant appel à
la raison repose pour une grande partie sur une relation de confiance qui, elle, s’appuie
fortement sur les émotions et les sentiments que le thérapeute a su mobiliser chez son
patient. Les tenants de l’hypnose savent d’expérience que la subordination du patient
hypnotisé est loin d’être illimitée, comme on a pu le croire au début, et que rien n’est
moins vrai que l’affirmation que l’on peut « tout suggérer » à une personne sous hyp-
nose. Néanmoins, il apparaît ici une opposition fondamentale, théorique et même
éthique, entre persuasion et suggestion. L’une et l’autre poussant jusqu’au bout leurs
pratiques et théorisation, quitte à reconnaître la part de pertinence contenue dans
l’autre tendance, n’arrivent pas à réussir la synthèse entre les deux.
Premières théorisations et pratique freudiennes : une synthèse originale
et le chemin d’une ascension irrésistible
Nous comprenons mieux, dans ce contexte, l’hégémonie que vont acquérir les idées
de Freud dans les décennies qui vont suivre, et qui vont reléguer dans un oubli quasi
total une œuvre aussi considérable que celle, par exemple, d’un Janet. C’est que la psy-
chothérapie selon Freud va apparaître comme une composition tout à fait originale
entre persuasion et suggestion.
Côté persuasion, Freud garde la nécessité pour le patient de participer par un
effort conscient – celui de l’association libre – à l’élucidation progressive de ses symp-
tômes. L’idée d’un « moi » qui doit advenir à la place du « ça » se situe dans la droite
ligne de l’exigence d’une plus grande liberté, à l’issue de la psychothérapie, eu égard
aux forces intérieures qui gouvernent l’esprit humain à son insu.
Côté suggestion, Freud garde l’idée d’une relation, semblable à celle des enfants
à l’égard des parents, ou des amoureux entre eux qui constituera l’instrument indis-
pensable de toute l’entreprise thérapeutique : le transfert11.
L’élégance du modèle, sa capacité de synthèse d’une problématique longtemps
mûrie sont des facteurs qui assureront la prédominance exceptionnelle de la version
psychanalytique de la psychothérapie.
10. Bernheim 1891.
11. Freud 1890.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%