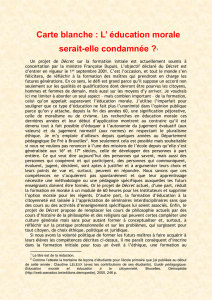Le monde change,les valeurs aussi

12 janvier 2010
1
COMMENT FAIRE POUR BIEN FAIRE ?
I- LE MONDE CHANGE ; LES VALEURS AUSSI ?
Préambule : L’exposé de 40 minutes qui précède vos échanges ne se veut en aucun cas
un cours, une leçon, une conférence qui feraient déjà le « tour de la question ». Il
s’agit d’une ouverture, d’un tremplin, d’une base de propositions à partir desquels
votre partage continuera d’élaborer, de construire une réflexion, nourrie de vos idées, de
vos expériences, de vos exemples. Prenons cela comme un travail de la pensée, qui se
veut modeste, mais essentiel. L’exposé sera disponible sur le site de N.-D d’Espérance
et sur papier, à l’accueil.
Comment faire pour bien faire ? Qu’est-ce que bien agir ? Nous nous
questionnons, nous nous interrogeons, et mettons en œuvre notre
humaine capacité à déterminer ce qui vaut le mieux. On peut parler ici de
position morale ou éthique – deux termes qui, à l’origine, signifient à peu
près la même chose, dans la langue latine ou la langue grecque : on se
réfère alors au domaine des mœurs, aux manières d’agir habituellement
validées par les groupes sociaux. On peut retenir au départ ce sens large ;
des distinctions apparaîtront plus tard.
Il se trouve que l’homme est doté de cette capacité de se poser ces
questions, par différence avec l’animal qui agit par instinct, s’adapte
spontanément à une réalité dont il a certes conscience, mais sans avoir à
réfléchir sur soi, ses actions, son rapport au monde ou aux autres.
Différent aussi bien d’une machine, l’homme ne fonctionne ni ne vit
selon de purs automatismes.
Nous ne pouvons échapper à cette obligation de penser, et, du coup,
dans le domaine de l’action, comme dans celui de la connaissance, pour
ce que nous faisons, ce que nous avons à faire, rien n’est tout à fait
évident, ni simple. Un choix nous est toujours possible entre les réponses
diverses, voire opposées.
Ce que nous remarquons alors, ce n’est pas seulement la diversité des
réponses possibles, mais aussi leur caractère changeant, avec le temps.
Quand nous décidons d’agir d’une certaine façon, nous savons très bien
qu’il nous était possible, pour des raisons très valables, de prendre une

12 janvier 2010
2
décision différente. Ne nous arrive-t-il pas de nous dire, faisant retour
sur nos actions passées, que si c’était à refaire, nous le referions
autrement ? Nous découvrons que nous choix sont relatifs, que les
circonstances appellent des remises en question.
En même temps, il nous faut choisir, il nous faut une réponse, afin de
nous engager fermement. Nous pensons, au fond, que parmi tous les
choix possibles, il en est au moins un qui est le vrai, et vraiment le
meilleur. Nous pensons, ultimement, qu’il doit bien y avoir quelque
vérité absolue, et définitive, sur ce qui est bien, sur ce qui est mal.
Et c’est là une tension, une contradiction dont nous ne pouvons pas
raisonnablement nous sortir. Nous désirons nous reposer dans des
vérités morales permanentes, invariables, universelles, éternelles peut-
être. Nous devinons en même temps que ces références absolues
devraient et pourraient faire s’accorder l’ensemble de l’humanité sur ce
qui vaut et ne vaut pas.
Mais en même temps nous n’échappons pas à l’expérience de la remise
en question – à laquelle on peut consentir, comme on peut la refuser –
de nos certitudes acquises, de nos habitudes de penser concernant les
mœurs et la morale.
Nous savons bien ce qui vient déstabiliser les idées, les manières d’être
sur lesquelles nous nous étions fixés :
- des événements forts qui viennent bouleverser notre vie et nos
convictions les plus assurées ;
- la société qui évolue, les mœurs qui changent, au point que parfois,
par exemple, nous ne nous reconnaissons plus dans les
comportements nouveaux des générations qui nous succèdent ;
- la confrontation avec l’étranger, que nous voyagions vers lui, ou
qu’il vienne habiter « chez nous », et la pensée que ces cultures
autres sont parfois étranges.
Et, concernant l’évolution des mœurs, comme le regard sur les cultures
différentes, nous connaissons cette tendance spontanée, relativement
fréquente, à juger négativement les changements en termes de déclin, de
décadence, voire de disparition, et les coutumes autres en termes de

12 janvier 2010
3
« barbarie » : « Il n’y a plus de morale » ; « Autrefois, on se serait fait
« tuer » pour ça, alors que maintenant toute le monde s’en f… » ; « Ce
sont des habitudes de sauvages »…
Proposons qu’un des sens de nos soirées soit de nous arrêter en ce point,
et de réfléchir ensemble sur nos éventuelles, nos probables perplexités,
hésitations, inquiétudes face à ces changements, à ces différences. Le
monde change, assurément, mais les valeurs changent-elles,
disparaissent-elles ?
Une distinction peut ici nous éclairer, entre les valeurs et les normes. Nous
appelons « valeur » un idéal collectif, considéré, dans une société donnée,
comme bon pour tous et méritant d’être adopté par tous : le respect de
l’autre, par exemple, ou la justice et l’égalité, la beauté etc. Quant à la
« norme » elle désigne la règle collective qui fait obligation à chacun de
s’exprimer, de se comporter d’une certaine façon pour signifier son
attachement à une valeur : si on admet que la politesse exprime une
valeur fondamentale, le respect d’autrui, alors une norme de ladite
politesse peut être de saluer celui qu’on croise, de ne pas couper la parole
etc. Les normes peuvent changer, différer d’une culture à l’autre.
Ajoutons que la non observance des normes dominantes, au-delà d’une
certaine tolérance, entraînent la réprobation sociale, voire pénale.
Ainsi nos jugements négatifs et inquiets sur la disparition des valeurs
peuvent-ils être reconsidérés. Est-ce que ce sont les valeurs qui changent,
voire disparaissent, ou bien la relation aux valeurs, la manière de les
concrétiser, de les incarner, de les vivre ? Ce qui change, ne seraient-ce
pas plutôt les normes, les comportements, et non les valeurs ?
Qui aujourd’hui pourrait soutenir jusqu’au bout qu’il vaut mieux, par
principe, être impoli et manquer de respect en société ? Mais,
aujourd’hui, par exemple, si on ne se lève plus quand un professeur entre
dans la classe, ou encore si on tutoie plus facilement, ces attitudes
traduisent un comportement « décontracté » non nécessairement grossier
ou irrespectueux, et incarnant la valeur d’authenticité dans des relations
de confiance.

12 janvier 2010
4
Considérons sous un autre angle ce que l’on nomme « crise des valeurs »,
qui implique le problème de leur transmission. Nous incriminons
l’individualisme ambiant, nous le rendons responsable de disloquer les
normes et de brouiller les valeurs. Nous assimilons l’individualisme à un
égoïsme intéressé qui impose sa loi propre, sa norme singulière, au
détriment de règles collectives qui se retrouvent fragilisées, voire
marginalisées.
Ainsi croyons-nous pouvoir penser, à partir de ce que nous constatons,
que la famille perd de sa valeur, que la fréquence des divorces, des
éclatements familiaux, de leur recomposition aléatoire et parfois précaire,
entraîne une fragilisation des repères pour les enfants en particulier, sans
parler de la constitution de familles monoparentales, ou encore fondées
par des couples homosexuels. Cela renforce l’impression d’une dérive
chaotique qui menace la stabilité durable d’une institution.
De même, la valeur de l’engagement militant – politique, syndical,
religieux – au service d’une cause qui dépasse l’intérêt personnel, semble
mise en question par cet individualisme.
Cette crise du militantisme, le scepticisme à l’égard des grands projets de
société, liés au déclin des utopies socialistes et de « leurs lendemains qui
chantent », entretiendrait une sorte de « désenchantement » à l’égard de
l’avenir.
Or il est remarquable que, depuis des années, les enquêtes démentent la
croyance en un déclin, en une disparition de ces valeurs. La mutation
des formes familiales ne signifie pas que la famille en tant que valeur ait
disparu, même si ces mutations peuvent surprendre. La vigueur des
mouvements associatifs, la constitution de mouvements spontanés pour
combattre des situations d’injustice et d’exclusion, sont manifestes. Les
valeurs de solidarité et d’égalité sont vivaces, dans toutes les générations.
Nous sommes ainsi conduits à réviser ce jugement qui assimile un peu
vite individualisme et égoïsme. L’individualisme signifie une véritable
valorisation de l’individu, de ses capacités, de son autonomie de pensée
et d’action, impliquant le respect et la défense de ses droits – toutes
choses qui définissent l’humanisme moderne.

12 janvier 2010
5
Il y a donc une tension entre deux pôles :
- -le pôle collectif des valeurs et des normes,
- -le pôle individuel de la liberté et du choix en conscience.
L’action morale ne consiste pas en une simple application conformiste
des normes, comme s’il s’agissait de faire ce qu’il est convenu de faire
sans engagement personnel. Mais elle ne se réduit pas non plus à agir, à
l’extrême, dans le mépris des traditions, des valeurs instituées, ou encore
des volontés d’autrui.
Certes il arrive que certains actes, certains comportements aient pu
apparaître à certains moments comme des transgressions condamnables
alors qu’ils étaient prophétiques à leur insu. Mais leur validation
impliquait la reconnaissance qu’ils exprimaient, de façon nouvelle,
inédite, des valeurs adéquates aux attentes, aux aspirations, aux souhaits
de la société – même si cette reconnaissance est très rarement unanime.
C’est ainsi, par exemple, que, tout en continuant d’invoquer le respect de
la vie, on a cessé d’assimiler la contraception à l’avortement auparavant
condamnées au même titre, ou que la liberté de travailler à l’extérieur de
son foyer a fini par être considéré comme un droit pour les femmes.
Assurément les choses changent, mais aussi les mots et les idées qui les
signifient. On ne peut manquer d’être frappé par un changement de
langage qui persiste depuis une trentaine d’années, et qui traduit en
même temps un changement d’esprit : là où l’on parlait de « morale », on
s’est mis à parler d’ « éthique ». Que peut exprimer ce changement, ce
glissement ?
Autrefois la morale se pensait et se vivait d’abord comme obligation,
devoir, et, quasiment, sacrifice. Que la morale soit religieuse ou, plus
tard, sécularisée et laïque, l’austérité du devoir, l’obligation
inconditionnelle dominaient.
Aujourd’hui, le terme éthique désigne une conception morale qui ne
commence pas par insister sur l’obligation, la soumission au devoir, le
respect des interdits. L’éthique rompt avec l’aspect « rigoriste » de la
morale, mais elle met d’abord en évidence le désir d’un
l’accomplissement de l’homme, d’une la réalisation de soi, au meilleur de
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%