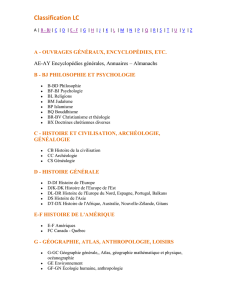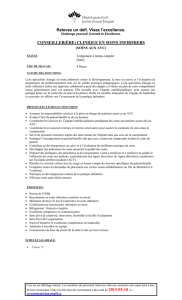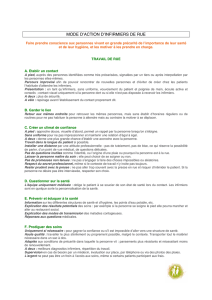RSI 90_BAT - Banque de données en santé publique

Cécilia ROHRBACH VIADAS,
Anthropologue infirmière
« toute réflexion importante,
loin de clore le débat,
au contraire commence
par l’ouvrir »
Yvonne Preiswerk
SOINS ET ANTHROPOLOGIE
UNE DÉMARCHE RÉFLEXIVE
MÉTHODOLOGIE
19
RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 90 - SEPTEMBRE 2007
Soigner l’être humain en respectant l’égalité des
cultures et en reconnaissant leurs différences
culturelles, appelle à relier unité et diversité. Les
publications récentes dans le domaine des soins
culturels privilégient pourtant la différence cul-
turelle, fondée sur le relativisme culturel délais-
sant le postulat de l’unité de l’humanité, comme
c’est le cas pour les soins infirmiers transcultu-
rels. C’est ainsi que quelques éléments histo-
riques relatifs aux théories fondatrices de l’an-
thropologie sont inclus dans ce texte, pour
comprendre les implications philosophiques et
éthiques de la théorie de soins infirmiers trans-
culturels. L’objectif de cet article est d’analyser
six publications récentes dans le domaine des
soins et de l’anthropologie, à travers une
méthode réflexive pour identifier deux tradi-
tions de soigner différentes en démontrant leur
portée philosophique et éthique dans la pra-
tique de soins infirmiers.
Mots clés: soigner, être humain, unité de l’humanité,
égalité des cultures, reconnaissance de leurs diffé-
rences culturelles, soins infirmiers transculturels,
portée philosophique et éthique, méthode réflexive.
RÉSUMÉ
Caring for human beings, calls for relating unity
and diversity in order to respect the equality of
cultures and to recognize their cultural diffe-
rences. Cultural difference is, however, privile-
ged by recent publications within the culture
caring domain, based on cultural relativism and
disregarding the unity of humanity, transcultural
nursing theory is the case. For this reason, some
historical elements related to the two original
anthropological theories are included in this
text to understand the philosophical and ethi-
cal implications of transcultural nursing theory.
The objective of this article is to analyse six
recent publications within the caring and
anthropology field, through a reflexive method
identifying two different caring traditions and
demonstrating their philosophical and ethical
reach for caring practice.
Key words: caring, unity of humanity, equality of cul-
tures, recognition of their cultural differences, caring-
anthropology, philosophical and ethical reach, reflexive
method.
ABSTRACT

INTRODUCTION
La recherche en soins infirmiers a été introduite en
France et en Suisse par Rosette Poletti autour de 1978-
1985. Poletti brosse le tableau de la situation de la
recherche dans la profession durant cette période.
Comme elle aime le faire, elle illustre cette situation par
des citations ou des exemples identifiant autant les
aspects positifs des investigations déjà réalisées, que les
difficultés posées quand il s’agit de modifier des attitudes
ancrées s’opposant à la recherche infirmière. Rosette
Poletti a introduit également des théories et des modèles
de soins infirmiers, écrits pour la plupart par des infir-
mières américaines.
Ces théories ont commencé à être utilisées dans divers
programmes de formation infirmière de base et de cadres,
en ouvrant la voie à de nouvelles connaissances et à la
conscience d’un savoir professionnel propre. Pendant cette
période, peu d’attention a été consacrée aux postulats
philosophiques de ces modèles et à leurs conséquences
éthiques, ce qui a affaibli la réflexion infirmière. Plusieurs
auteurs formulent ce manque de préparation de futurs
professionnels de la santé à cet exercice indispensable
consistant en une analyse étendue de connaissances de la
profession, afin de se convertir en une science autonome
Nadot, M. (1992) et Reverby, S. M. (1993). Ce manque de
critique a ralentit, non pas le milieu infirmier plutôt sécu-
risé par des connaissances stables, mais les collègues uni-
versitaires des autres sciences humaines.
Une exigence propre à toute discipline universitaire veut
que la critique fasse partie de toute science et qu’elle soit
continuellement présente pour infirmer ou confirmer les
postulats théoriques, pour analyser les méthodologies,
pour guider la recherche et pour préserver l’autonomie
indispensable à chaque discipline.
Pour analyser le domaine soins-anthropologie dans cet
article, je propose une méthode réflexive décrivant les
principales orientations théoriques et philosophiques
américaines enseignées en Europe et leurs conséquences
dans les textes étudiés dans cet article.
UN SURVOL DES SOINS INFIR-
MIERS TRANSCULTURELS
Un bref écho concernant la théorie de soins infirmiers
transculturels de Madeleine Leininger introduisant une
orientation anthropologique dans les soins, pour la
première fois dans les soins infirmiers, ne fait pas de
doute. Son doctorat en anthropologie à l’Université
de Washington, Seattle, la prépare à développer
son domaine.
La théorie de soins infirmiers transculturels a été publiée
en 1978 (voir Leininger, 1995, pp. 3-54 pour le dévelop-
pement détaillé de sa conception théorique) en prenant
rapidement une ampleur internationale, donnée par son
auteure.
La théorie de Leininger a été analysée par plusieurs infir-
mières (Marriner-Tomey, Julia B. George, S. Kérouac,
entre autres) et c’est l’étude de Julia B. George (1995), qui
apparaît comme la plus complète parce qu’elle identifie un
aspect décisif : «Leininger définit la santé, mais elle ne défi-
nit pas spécifiquement les concepts majeurs d’être humain,
société/environnement…» (George, 1995, p. 379, traduc-
tion). Cette lacune est de conséquence, parce que sans
le concept d’être humain, l’unité de l’humanité, ce concept
cher aux philosophes universalistes du XVIIIème siècle et
aux premiers anthropologues européens, est mise en dan-
ger, car il risque de ne pas être repris dans les publica-
tions francophones de soins infirmiers.
Leininger s’abstient également de situer l’anthropologie
du point de vue historique et son concept de culture est
fondé sur le relativisme culturel. La théorie anthropolo-
gique du relativisme est très répandue en Amérique, ins-
pirant la majorité des travaux de ce continent.
Ma formation européenne en anthropologie, m’a permis
de reconnaître les différences entre les théories euro-
péennes et les théories américaines, parce que j’ai eu
accès aux deux écoles anthropologiques, ayant fait des
études pendant un certain temps à l’Université de
Washington, Seattle.
L’évolutionnisme et le relativisme requièrent d’être situés
dans cet article, comme cela serait le cas pour toute autre
théorie infirmière à étudier. Il s’agit de présenter l’his-
toire de la science humaine et sociale qu’accompagne la
discipline des soins. Pourquoi avoir des théories de soins
si on méconnaît les théories qui les accompagnent et qui
influencent leurs philosophies et leur éthiques ?
Les soins infirmiers appellent nécessairement d’autres dis-
ciplines, l’autonomie totale des disciplines est un leurre.
Chaque théorie est composée d’une histoire qui la fonde
et qui détermine la trajectoire de ses multiples principes,
postulats, orientations, méthodes, philosophies, recherches,
contexte culturel, personnalité de l’auteur, etc. Il importe
de les connaître, si nous voulons réfléchir en profondeur
et apprendre à utiliser les connaissances des sciences
humaines et sociales avec une éthique professionnelle.
Comme le dit Dumont : «L’image mentale que nous avons
d’une culture ne dépend pas uniquement des faits accessibles
obtenus, mais de notre façon d’interpréter les faits accessibles
et de notre manière de penser en général» (1989, p. 13). C’est-
à-dire, la représentation intellectuelle indispensable pour
construire une théorie, contient des caractéristiques sem-
blables à l’image mentale que nous avons d’une culture.
MÉTHODOLOGIE
SOINS ET ANTHROPOLOGIE
UNE DÉMARCHE RÉFLEXIVE
RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 90 - SEPTEMBRE 2007
20

SOINS ET ANTHROPOLOGIE
UNE DÉMARCHE RÉFLEXIVE
RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 90 - SEPTEMBRE 2007 21
PRÉCISIONS HISTORIQUES
CONCERNANT L’ANTHROPO-
LOGIE
Les premières recherches systématiques en anthropolo-
gie datent du XIXème et du début du XXesiècle en Europe,
quoique, les philosophes universalistes du XVIIIème (Kant,
Rousseau, voir Hodgen, 1971) vont stimuler la pensée de
ces premiers anthropologues avec leur postulat relatif à
l’unité de l’humanité. Subséquemment, l’évolutionnisme, la
première théorie anthropologique, essaie de comprendre
l’humanité. Cette théorie contemple la société moderne
comme étant le stade supérieur, le modèle à suivre pour
les sociétés dites moins «civilisées». Cette position «eth-
nocentriste*» est certainement critiquable, mais retenons
que la majorité des évolutionnistes a conservé ce que les
philosophes universalistes leur ont légué d’inappréciable,
le postulat philosophique de l’unité de l’humanité,
Berthoud, G. (1992, pp. 77-89, 119-127, 241-268).
L’évolutionnisme fut toutefois fortement contesté par
les anthropologues américains et ceci avec raison. Les
chercheurs américains vont souligner surtout le
concept de culture en accentuant la diversité cultu-
relle, ce que l’on connaît comme théorie relativiste.
La théorie évolutionniste, en soulignant l’unité de l’hu-
manité, néglige la diversité culturelle alors que la théo-
rie du relativisme culturel, au contraire, souligne la
diversité culturelle et décline l’unité de l’humanité. C’est
cependant la théorie relativiste, qui domine dans la
représentation de l’anthropologie américaine jusqu’à
nos jours. La théorie relativiste considère que les us et
coutumes des peuples sont significatifs uniquement dans
la culture d’appartenance. Ainsi, chaque culture est
conçue comme une totalité sans communication pos-
sible entre elles, puisque ce qui est valable pour une
société ne l’est pas pour une autre. Leininger emprunte
son concept de culture à Haviland, W. A. (1990) et s’ins-
pire particulièrement de Melville Jean Herskovits (1955,
1973), deux auteurs relativistes, dont Leininger adopte
les postulats philosophiques sans les questionner et nous
verrons que cela a des conséquences éthiques de taille.
Les connaissances n’aidant pas à réfléchir, elles semblent
conjurer plutôt la soumission.
Herskovits, M. (1895-1963) a été un de principaux
concepteurs du relativisme culturel, il a soutenu que toute
culture est objectivement accessible à partir de ses
propres critères. Ce postulat philosophique remet en
cause la possibilité même de comparer les cultures, et
par conséquent, d’apprendre de chacune d’entre elles. Le
relativisme culturel renforce donc la diversité culturelle,
où tout est admissible, «tout se vaut», puisque chaque cul-
ture est étudiée dans ses propres termes et valeurs et
ses traditions se considèrent acceptables dans le contexte
même, sans jugement de critique, Herskovits, M. (1973).
Leininger confirme cette position relativiste consistant
à accepter toute pratique de soins comme approu-
vable. Sans entrer, ici, dans cette discussion, je laisse le
lecteur réfléchir aux pratiques culturelles telles que :
la circoncision féminine, se défaire d’un bébé parce
qu’il est jumeau et que cela est considéré malsain par
le groupe, etc. Ces pratiques relèvent de l’éthique pro-
fessionnelle et il est indispensable de prêter attention
à l’enjeu qu’elles représentent.
Il s’agit d’une question délicate dans laquelle se mêlent
le respect de l’autre, le respect envers soi-même, le
code éthique, les implications morales, sociales et
politiques. Leininger préfère éviter ces questions en
gardant sa position relativiste concernant l’accepta-
tion de l’ensemble des pratiques «sans jugement» et,
plus encore, elle propose de prendre comme base
de réflexion éthique, la culture : «La culture, pourvoit
la connaissance holistique la plus complète pour construire
une base de connaissance éthique des soins, fidèle et
digne de confiance, pour guider les décisions sur les soins
humains, la santé la mort, les facteurs de vie quoti-
dienne», Leininger (1990, p. 64, traduction). La cul-
ture est, ici, une définition sans contenu significatif
qui sera donnée par les membres du groupe étudié
lors du travail de terrain.
Après avoir examiné cette position, le relativisme cultu-
rel qui guide la réflexion éthique des conceptions liées à
la culture dans les soins infirmiers transculturels, je désap-
prouve cette posture parce qu’elle déloge un fondement
déontologique. Ma position est de considérer comme
essentiel de se référer à une démarche comparative
réflexive (qui ne peut pas être explicitée dans l’espace
de cet article). Cette démarche doit servir de base et
de guide, car «S’il y a un fondement, il y a des éléments qui
permettent de relativiser ; mais s’il n’y a pas de fondement,
il n’y a pas de structure contre laquelle d’autres postures pour-
raient être ‘objectivement’jugées», Holmes (1988, p. 185,
commas inversées dans le texte, traduction).
DÉMARCHE RÉFLEXIVE ET PUBLI-
CATIONS DES SOINS ASSOCIÉES
À L’ANTHROPOLOGIE
Accueillir un être humain pour le soigner est une
démarche professionnelle basée sur une relation, sur
des principes philosophiques, sur des connaissances
théoriques et soutenue par la personnalité du soignant
pour guider cette expérience, même si ces principes
sont implicites et confus. Cet accueil est aussi influencé
par les valeurs que la société du chercheur privilégie.
* Terme qui suggère de considérer ses propres valeurs culturelles comme étant supérieures aux autres

RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 90 - SEPTEMBRE 2007
22
Je distingue dans la littérature des soins infirmiers fran-
cophone, une démarche professionnelle fondée sur un
héritage universaliste regardant chaque individu,
comme un membre à part entière de l’humanité.
La réticence envers l’enseignement de l’anthropologie
s’adresse plutôt aux principes transculturels évoqués,
qu’à l’anthropologie elle-même, discipline peu connue,
d’ailleurs, dans certains pays francophones. Quoique
cela doive encore se vérifier à cause de l’influence amé-
ricaine dans ce domaine actuellement, comme nous le
verrons plus loin.
Tandis qu’aux USA, la démarche professionnelle propo-
sée par diverses publications dans le domaine des soins
culturels, attribue initialement un statut d’appartenance
au «client» comme nos collègues les dénomment, c’est-
à-dire des : tamouls, musulmans, japonais, etc.
Ces deux démarches révèlent schématiquement deux
traditions de soins différentes. La tradition profes-
sionnelle américaine liée aux soins infirmiers transcul-
turels, montre un intérêt pour une approche dirigée
vers le groupe culturel et fondée sur les principes du
relativisme culturel adoptés par sa principale leader, la
Professeure Madeleine Leininger.
Ce qui précède démontre qu’en considérant l’histoire,
on prend un engagement pour comprendre le témoi-
gnage du passé et pouvoir justement nous distancer
de celui-ci en devenant académiquement plus libres.
C’est l’analyse de six publications choisies pour identi-
fier le savoir, non pas d’anthropologie si peu connu, mais
le savoir qui se publie dans le domaine soins-anthropo-
logie, qui va suivre en montrant l’influence américaine.
PUBLICATIONS CHOISIES DANS
LE DOMAINE SOINS-ANTHRO-
POLOGIE
Les six textes seront étudiés et considérés selon la
méthode réflexive mentionnée dans le résumé et mise
en pratique tout au long de cet article.
1) Veysset, B. (1988). Anthropologie et recherche en
soins infirmiers, Revue Recherche en Soins Infirmiers,
No. 14, pp. 9-14 (conférence).
Cette conférence est une des premières publications
dans le domaine de l’anthropologie, donnée par une
Docteure en Anthropologie, qui décrit avec des citations,
en quoi consiste la discipline, abordant la recherche en
soins infirmiers de manière abrégée. Cette conférence de
Bernadette Veysset introduit la dimension historique et
philosophique de l’anthropologie de manière remar-
quable, car elle est la seule auteure, dans la littérature
étudiée, à avoir exposé les fondements de l’anthropolo-
gie. Veysset fait une communication d’envergure en pré-
cisant le principe philosophique de l’unité de l’humanité.
Son apport précieux (p. 12) est tombé pratiquement dans
l’oubli par la suite, sans avoir eu l’écho requis.
Il s’agit pourtant d’un principe essentiel pour soigner
parce que toute personne soignée fait préalablement
partie de l’humanité. Évident ? Nous verrons que cela
n’est pas toujours le cas.
2) Collière, M.-F.(1996). Soigner… Le premier art de la vie.
Paris, InterÉditions. «De l’utilisation de l’anthropologie
pour aborder les situations des soins», pp. 137-187.
Collière s’inspire entièrement du travail de terrain de
l’anthropologue et l’accommode au soignant. Elle pré-
pare ainsi une méthodologie pour les soins commu-
nautaires applicable dans d’autres contextes infirmiers.
L’approche de Collière est considérée universaliste
parce qu’elle reconnaît les êtres humains, sans les cata-
loguer, c’est une attitude positive et confirmée de sa
démarche.
Collière met en évidence le fait que toute situation de
soins est une situation anthropologique et à partir de ce
postulat, elle introduit un processus adapté aux deux dis-
ciplines : les soins et l’anthropologie, ce qui va, par la
suite, soutenir le développement de son enseignement.
3) Rohrbach, C.(1999). Soigner, c’est l’expérience de
se comprendre soi-même par le détour de l’autre.
Revue Recherche en Soins Infirmiers, No. 56, pp. 81-87.
Une expérience pédagogique pour sensibiliser les étu-
diants de la 1re année d’études en soins infirmiers, à
l’École de Thonon-les-Bains, est décrite en apportant
quelques exemples.
Les étudiants sont introduits à l’anthropologie et au tra-
vail de terrain pendant trois journées. Ensuite, ils parta-
gent trois journées avec un groupe ou une personne de
leur choix, différent d’eux. Ils élaborent un rapport écrit
de ces trois journées, et ensuite, en fonction de leur
expérience et de leurs connaissances acquises auprès
des groupes étudiés, ils décrivent comment ils soigne-
raient cette personne, si il/elle arrivait à l’hôpital. Ces
données sont présentées oralement par chaque étudiant
au groupe (42 étudiants) et par écrit au professeur.
Cette approche, qui consiste à partager, pendant trois
journées, la vie quotidienne avec des personnes
inconnues de l’étudiant, a stimulé leur créativité
concernant la manière dont ils soigneraient ces per-
sonnes à l’hôpital. De plus, le mode de vie de
pêcheurs, de sourds-muets, de personnes vivant au
couvent, d’une famille chilienne réfugiée, d’une fille
anorexique, d’un étudiant zaïrois, de deux agricul-
teurs retraités, d’une personne transsexuelle et bien
d’autres personnes et groupes, a fait comprendre que
chaque groupe possède une connaissance sur les
soins que les étudiants ont dû apprendre, pour ter-
miner avec l’entendement que soigner est une expé-
rience de réciprocité.

SOINS ET ANTHROPOLOGIE
UNE DÉMARCHE RÉFLEXIVE
RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 90 - SEPTEMBRE 2007 23
4) Coutu – Wakulczyk, G. (2003). Pour des soins cul-
turellement compétents : Le modèle transculturel de
Purnell. Revue Recherche en Soins Infirmiers, No. 72,
pp. 34-47.
L’auteur de cet article décrit les éléments organisa-
tionnels et techniques du modèle Purnell. C’est une
description avec la traduction complète dudit modèle.
Coutu – Wakulczyk, traduit le schéma conceptuel de
l’auteur de manière très complète, introduisant
quelques modifications organisationnelles avec l’auto-
risation de Larry Purnell. Il est dommage qu’aucun
objectif n’ait été précisé pour connaître le choix de ce
modèle culturel par rapport à d’autres. La description
est uniquement théorique sans faire référence à des
situations de la pratique. Le modèle Purnell relève de
l’approche relativiste, décrite précédemment.
5) Lepain, C.(2003). L’approche culturelle en soins
infirmiers pour les patients musulmans maghrébins
relevant des soins palliatifs. Revue Recherche en Soins
Infirmiers, No. 72, pp. 4-33.
Dans ce travail d’un investissement personnel sérieux,
il est toutefois difficile de comprendre le cadre concep-
tuel de l’auteure, car elle se réfère à Watson et à
Leininger, dont elle sélectionne des éléments sans les
justifier et en les appliquant de manière superficielle
dans son projet pratique.
Lepain a ainsi cité de nombreuses conceptions théo-
riques, les unes à côté des autres, par rapport à son
projet, telles : Leininger et Watson, Giger – Davidhizar,
Gordon avec ses diagnostiques et Kérouac, S. (1994).
Ces auteurs, leurs théories et leurs connaissances sont
de qualité variée sans être justifiées par Lepain, ce qui
diminue la cohérence théorique et pratique de son
article. Pourquoi ?
Julia B. George (1995, pp. 373-389), en analysant la
théorie de Leininger, a conclu que l’auteure de la théo-
rie de soins infirmiers transculturels n’a pas définit les
quatre concepts de base de soins infirmiers : personne,
santé, environnement, soins infirmiers. Pourtant, ces
quatre concepts sont définis par Lepain, comme s’ils
appartenaient à Leininger ? Mais, c’est à Kérouac que
Lepain emprunte ces définitions qui ne correspondent
pas à Leininger comme déjà indiqué. Elles se trouvent
chez Kérouac, qui a abordé la théorie de Leininger de
manière plutôt simplificatrice en réduisant ses expli-
cations à quelques termes (voir, «La pensée infir-
mière», 1994, pp. 43-45).
L’article de Lepain termine par un «projet clinique»
pour apprendre à soigner les patients maghrébins. La
question qui émerge avec cette approche se réfère à
la manière déductive de procéder, il y a peu de spon-
tanéité et d’initiative pour les soignants introduits dans
autant de connaissances hétérogènes.
Cet accès aux soins, catégorise les patients en les sépa-
rant des autres patients non musulmans maghrébins
et peut estomper la curiosité des soignants par le
nombre de connaissances théoriques qui leur sont
transmises (voir projet clinique, p. 12 et suivantes). Peu
de place semble être laissée aux apprenants et au
patient, car «tout» ou presque, est déjà prévu. C’est
une approche issue du relativisme culturel américain,
même si l’auteur peut l’ignorer, cependant, cette
approche «catalogue» les patients et il paraît conve-
nir plutôt à la mentalité américaine.
Pour conclure, le risque existe avec ce type d’approche
de retomber dans les soins en série : les noirs sont
soignés ainsi, les turcs autrement, les japonais comme
le dit tel livre. Cela ne serait pas trop différent de : l’ap-
pendicite, on procède ainsi, le cancer du colon selon
telle approche, un travail mécanique, automatisé. Cette
démarche néglige autant le patient que l’infirmière
comme êtres humains. Les soignants de «patients dif-
férents» peuvent se spécialiser dans une culture et
apprendre à regarder leur patient avec un regard
«musulman maghrébins», mais comment regarde-t-
on un maghrébin comme être humain ?
L’article de Catherine Lepain est le résultat d’une forte
influence de l’anthropologie américaine dans sa pra-
tique de soins.
6) Racine, L. (2003). Les potentialités de l’approche
théorique post-coloniale en recherche infirmière cul-
turelle sur l’adaptation du soin infirmier aux popula-
tions non occidentales. Revue Recherche en Soins
Infirmiers, No. 75, pp. 7-14.
Dans cet article, il y a un effort de décentration, c’est-
à-dire, cette capacité complexe de pouvoir quitter un
point de vue en le questionnant de loin et de près.
Racine propose une réflexion qui justifie son parcours
et la raison de ses choix théoriques, elle décrit claire-
ment la voie novatrice qu’elle entreprend. Racine fait
une critique du multiculturalisme occidental en démon-
trant ses lacunes et elle avance des références qui sou-
tiennent ses critiques. L’auteur introduit ensuite sa
propre perspective, où elle propose «une négociation
des différences culturelles entre la clientèle non-occi-
dentale et le personnel infirmier», un «troisième
espace» (p. 11) qui mène à une compréhension des
différences culturelles. L’auteure est consciente du che-
minement requis des soignants pour arriver à ce type
de compréhension et elle propose à ce sujet, un pro-
cessus de conscientisation. La démarche de l’auteure
est novatrice, comme elle l’indique au départ de son
article, car elle introduit un concept, la «sécurité cul-
turelle», souhaitant que la recherche infirmière cultu-
relle devienne un progrès d’action sociale, qui consiste
à développer des programmes d’éducation basés sur
la notion de sécurité culturelle. L’auteure s’est inspirée
d’Antonio Gramsci, théoricien et écrivain italien, dont
les idées ont eu du succès par son authenticité et par
son intérêt pour les classes défavorisées. L’orientation
choisie est donc politique, avec des connaissances
concernant les classes défavorisées et la théorie sou-
tenue par cette perspective.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%