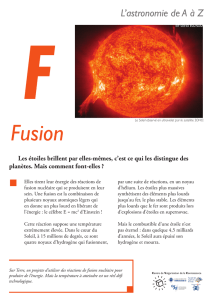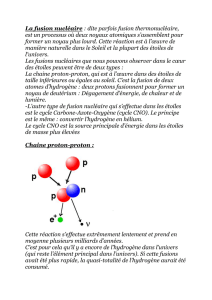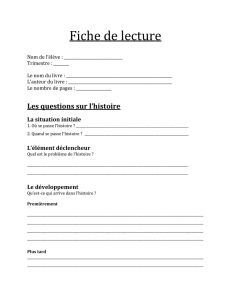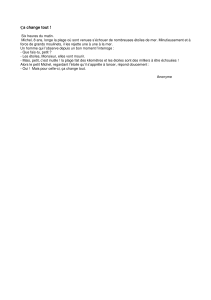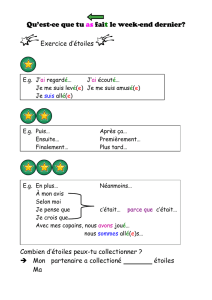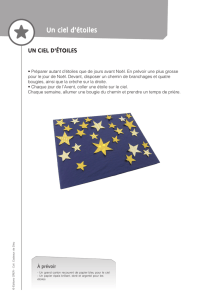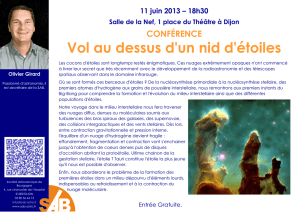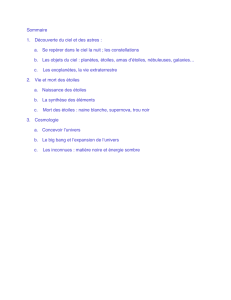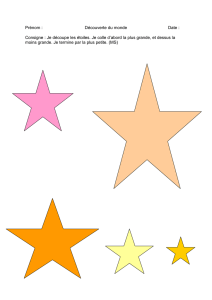L`hydrogène atomique dans les enveloppes circumstellaires autour

L'hydrogène atomique dans les enveloppes circumstellaires autour des étoiles AGB
Extrait du Observatoire de Paris centre de recherche et enseignement en astronomie et
astrophysique relevant du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
https://www.obspm.fr/l-hydrogene-atomique-dans-les-enveloppes.html
L'hydrogène atomique dans
les enveloppes
circumstellaires autour des
étoiles AGB
Date de mise en ligne : lundi 1er mars 2004
Observatoire de Paris centre de recherche et enseignement en astronomie et
astrophysique relevant du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche.
Copyright © Observatoire de Paris centre de recherche et enseignement en astronomie et astrophysique relevant du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.Page 1/5

L'hydrogène atomique dans les enveloppes circumstellaires autour des étoiles AGB
Lorsque les étoiles telles que notre Soleil terminent leurs vies, elles traversent rapidement la
phase "AGB", où¹ elles éjectent leur matière dans des vents intenses. Le gaz ainsi ejecté peut
être atomique ou moléculaire, mais pendant longtemps l'hydrogène atomique (HI) n'avait pu
être détecté parce que son émission est faible et qu'elle se confond avec l'émission HI du
milieu interstellaire de notre Galaxie qui est omniprésent. Cependant, l'hydrogène atomique
dans les enveloppes circumstellaires autour des étoiles AGB peut maintenant être détecté
grâce au radiotelescope Nançay qui vient d'être rénové.
Les étoiles de la Branche Asymptotique des Géantes (Asymptotic Giant Branch, AGB) se trouvent dans un état
décisif de l'évolution stellaire : elles sont extrêmement lumineuses (plusieurs milliers de fois la luminosité du Soleil)
et perdent de la masse à un taux très élevé (de plusieurs milliers à plusieurs milliards de fois l'intensité du Vent
Solaire). Ces étoiles ne peuvent vivre longtemps dans un tel état, peut-être un million d'années, ce qui est court en
comparaison de leur durée de vie (de 1 à 10 milliards d'années). Après cette phase spectaculaire elles arrêtent de
perdre de la masse et de produire de l'énergie, et se refroidissent lentement sous la forme de naines blanches ;
cependant pendant un temps très court elles se trouvent encore assez lumineuses pour illuminer la matière
circumstellaire éjectée récemment, produisant ainsi les merveilles connues sous le nom de Nébuleuses Planétaires
:
Figure 1 NGC 7293 : la nébuleuse de l'Hélice vue avec le Télescope Spatial Hubble ; elle doit son nom à
son apparence hélicoïdale. Copyright : NASA/NOAO Cliquer sur la figure pour l'agrandir
C'est par le biais de ce phénomène de vent stellaire que les étoiles de petite masse ou de masse intermédiaire
(c'est-à-dire celles qui à leur naissance avaient une masse de une à quelques fois celle du Soleil) évitent de
terminer leur vie en Supernovae. Par contre les rares étoiles qui à leur naissance avaient une masse de plus de 6
ou 8 fois celle du Soleil suivent une évolution différente qui les conduit à ce type d'explosion catastrophique. C'est
aussi par le phénomène de perte de masse que ces étoiles remplissent le milieu interstellaire avec de la matière
enrichie en éléments produits dans les intérieurs stellaires. Elles participent ainsi à l'évolution chimique de l'Univers.
Comprendre la dynamique des vents circumstellaires et l'histoire de la perte de masse des étoiles AGB est ainsi
un des challenges de la Physique Stellaire. Dans son expansion, la matière circumstellaire se refroidit lentement.
De la poussière se forme par condensation de petites particules carbonées ou silicatées, ainsi que des molécules
telles que CO ou OH. La perte de masse des étoiles évoluées a ainsi été étudiée principalement à travers l'émission
des poussières (dans le domaine infrarouge) ou les émissions moléculaires (dans le domaine radio). Cette
approche reste cependant insatisfaisante car la poussière ou les molécules qui sont observées ne constituent
qu'une fraction mineure (< 1 %) de la matière éjectée par les géantes rouges. D'autant plus que cette proportion est
elle-même mal connue. On comprend que dans ces conditions il est difficile d'établir un bilan de la masse perdue
Copyright © Observatoire de Paris centre de recherche et enseignement en astronomie et astrophysique relevant du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.Page 2/5

L'hydrogène atomique dans les enveloppes circumstellaires autour des étoiles AGB
par les étoiles en fonction du temps, une donnée indispensable pour bien décrire l'évolution des étoiles de masse
intermédiaire (M < 6-8 masses solaires). L'hydrogène est l'élément le plus abondant dans l'Univers et aussi dans
les vents des géantes rouges. Par conséquent, l'émission de l'hydrogène atomique dans son état fondamental
devrait être l'un des meilleurs traçeurs de l'histoire de la perte de masse. De plus l'hydrogène étant l'élément le plus
abondant, le mesurer est quasiment équivalent à mesurer directement la masse totale. L'hydrogène atomique est
caractérisé par une transition bien connue que l'on observe à 21 cm. Cette transition a été utilisée extensivement
pour cartographier le milieu interstellaire de notre Galaxie et découvrir ainsi sa structure spirale. Elle se trouve dans
le domaine radio à la fréquence de 1420 MHz, proche de celles utilisées pour les transmissions terrestres,
aéronautiques et spatiales. Heureusement le domaine qui va de 1400 à 1427 MHz est protégé pour la recherche !
Cependant les tentatives pour détecter cette raie dans les enveloppes circumstellaires avaient jusqu'à maintenant
échoué, principalement parce que : 1. l'émission de HI à 21 cm est très faible, 2. le milieu interstellaire sur la
ligne de visée produit une émission HI qui ajoute un fond intense contre lequel il est difficile de distinguer la faible
émission circumstellaire, 3. l'hydrogène dans ces enveloppes pourraient être moléculaire plutôt qu'atomique. Les
recherches menées dans les années 80 avaient ainsi été abandonnées. Eric Gérard et Thibaut Le Bertre de
l'Observatoire de Paris ont récemment entrepris une nouvelle recherche de la raie HI à 21 cm avec le
radiotélescope rénové de Nançay (NRT). En effet ce radiotélescope construit dans les années 60 a été récemment
rénové par l'Institut National des Sciences de l'Univers (INSU) et l'Observatoire de Paris en collaboration avec les
ingénieurs australiens du CSIRO et avec le soutien financier du Conseil Régional de la Région Centre.
Figure 2 Vue intérieure de la nouvelle cabine focale du radiotélescope de Nançay montrant le cornet
basse-fréquence (1.0-1.8 GHz) en position et son récepteur cryogénique. Cliquer sur la figure pour l'agrandir
Grâce à la plus grande sensibilité de l'instrument et à une stratégie d'observation soignée ils ont pu découvrir
l'émission HI en provenance de plusieurs sources stellaires. Une de leurs premières détections est associée à
l'étoile RS Cnc. Du profil spectral très particulier de cette émission ils ont pu déduire que l'hydrogène atomique est
présent dans l'atmosphère stellaire. Ce résultat montra que l'hydrogène peut se trouver sous forme atomique très
près de l'étoile centrale et que donc il pourrait se trouver sous cette forme beaucoup plus communément que
considéré jusqu'à présent. Ils ont maintenant découvert HI dans plusieurs autres sources. Dans l'une d'elles,
l'étoile variable EP Aqr, l'émission HI est spectaculaire. Le profil spectral peut se décomposer en 3 composantes qui
tracent des structures dynamiques différenciées dans l'enveloppe circumstellaire. Les 2 composantes principales (1
et 2 dans la figure 3) sont trés étendues dans le ciel et peuvent être résolues angulairement avec le NRT. La
distance de cette étoile a été mesurée par le satellite européen Hipparcos et vaut 135 parsecs, ou 440 années
Copyright © Observatoire de Paris centre de recherche et enseignement en astronomie et astrophysique relevant du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.Page 3/5

L'hydrogène atomique dans les enveloppes circumstellaires autour des étoiles AGB
lumières. A cette distance la taille de l'enveloppe circumstellaire détectée en HI est de l'ordre de 1.6 parsecs ou 5
années lumières !
Figure 3 L'émission HI de EP Aqr détectée avec le radiotélescope de Nançay. Cliquer sur la figure pour
l'agrandir
La taille de l'enveloppe circumstellaire de EP Aqr est si grande qu'elle se compare à la séparation moyenne des
étoiles dans le voisinage solaire. L'extension apparente correspond à à peu près 1 degré sur le ciel (soit 2 fois plus
que le Soleil ou la Lune, bien que bien sûr la source se trouve beaucoup plus loin !). Les enveloppes circumstellaires
détectées en HI par Gérard & Le Bertre sont centrées sur les étoiles, mais quelques fois elles présentent une
distribution de la matière qui est complexe, avec des structures rappelant celles observées dans les nébuleuses
planétaires. En fait, la raie de HI permet de sonder l'environnement circumstellaire si loin de l'étoile centrale que
dans un autre cas (l'étoile carbonée Y CVn), Gérard et Le Bertre ont pu mettre en évidence l'interaction entre le
vent stellaire et le milieu interstellaire.
Figure 4 Image de Y CVn obtenue à 90 microns par l'Observatoire Spatial Infrarouge ISO (Izumiura et al.
1996, A&A 315, L221). L'émission vient de la poussière dans l'enveloppe circumstellaire de Y CVn, et
probablement aussi du milieu interstellaire repoussé par le vent stellaire. Cliquer sur la figure pour l'agrandir
L'avénement d'interféromètres radio avec un grand champ de vue, tels que l'EVLA ou le SKA, permettra de
cartographier en HI avec une résolution angulaire et une sensibilité excellentes les enveloppes entourant les étoiles
AGB telles que Y CVn.
Copyright © Observatoire de Paris centre de recherche et enseignement en astronomie et astrophysique relevant du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.Page 4/5

L'hydrogène atomique dans les enveloppes circumstellaires autour des étoiles AGB
On sera capable ainsi d'étudier en détail la structure dynamique des vents circumstellaires et l'histoire de la perte de
masse des étoiles AGB, ce qui ne peut être obtenu autrement. On pourra aussi obtenir des informations cruciales
sur la façon dont la matière stellaire, enrichie par les éléments produits dans les intérieurs des étoiles, est ré-injectée
dans le milieu interstellaire (une étape essentielle du cycle cosmique de la matière). Cette perspective ouvre un
complément heureux au programme ALMA qui bientôt permettra d'étudier en détail l'émission radio des espèces
moléculaires telles que CO, et ainsi donnera accès à la structure interne des enveloppes circumstellaires à
proximité des étoiles centrales.
Les résultats obtenus par Gérard et Le Bertre démontrent que les profils des raies HI contiennent une information
très riche, inattendue, sur l'histoire de la perte de masse des géantes rouges, sur les structures spatiales et
cinématiques des enveloppes circumstellaires, et sur l'interaction entre les vents stellaires et le milieu interstellaire.
Les grands interféromètres radio qui sont en phase de conception ou en cours de construction fourniront une
contribution essentielle à notre connaissance de ces objets importants. Le Bertre T., Gérard E., 2004, "The
circumstellar environments of EP Aqr and Y CVn probed by the HI emission at 21 cm", Astronomy & Astrophysics,
in press Gérard E., Le Bertre T., 2003, "The HI emission profile of RS Cnc", Astronomy & Astrophysics 397, L17
Copyright © Observatoire de Paris centre de recherche et enseignement en astronomie et astrophysique relevant du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.Page 5/5
1
/
5
100%