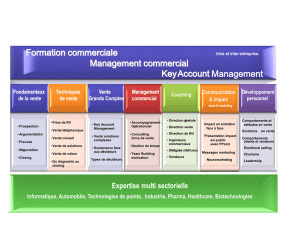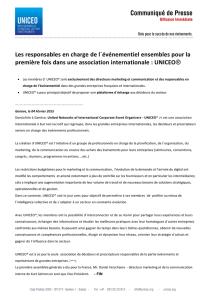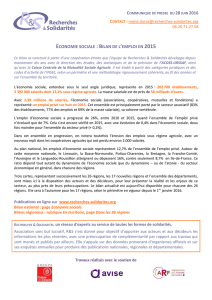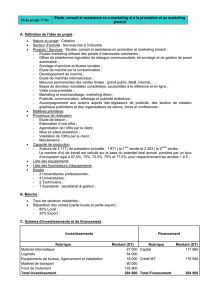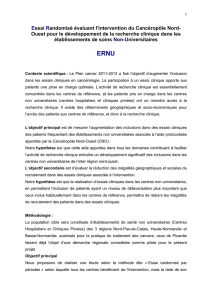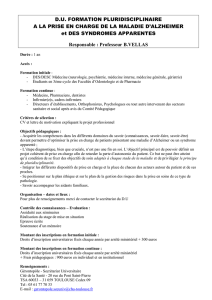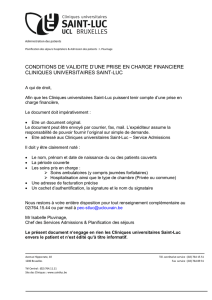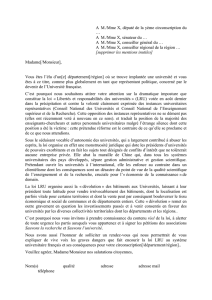Les relations internationales, science royale ?

Frédéric Charillon
1
Les relations internationales, science royale ?
Le passage de l’expertise académique à l’expertise politique demeure un dilemme récurrent
des sciences sociales. La reconnaissance de l’utilité sociale d’une discipline passe par son
utilisation possible par les acteurs du politique, c'est-à-dire du pouvoir. Son autonomie et le
maintien de sa scientificité nécessitent en revanche l’éloignement vis-à-vis de celui-ci. Sans
qu’il soit utile de remonter jusqu’au savant et au politique de Weber ni à sa neutralité
axiologique, la spécificité de la science politique et de ses différentes branches apparaît
clairement au regard de cette question. Tout ce qui a trait à l’état de la société (nationale ou
mondiale), de l’opinion, à l’exercice du pouvoir, de la puissance et à leur efficacité, est de
nature à intéresser le Prince et ceux qui travaillent pour lui.
Sachant cela, le Savant tente d’éviter l’enfermement dans une alternative difficile, entre
récupération et dénonciation : récupération si le Politique, non sans s’assurer de flatter
régulièrement le Savant, utilise ses travaux à des fins décisionnelles ; dénonciation si le
Savant, cherchant à éviter cette posture, confine ses analyses à une déconstruction de l’action
publique, dont on est pratiquement sûr qu’elle ne servira pas en haut lieu, tant elle paraîtra
déplaisante et loin des priorités du moment. Il en émanera probablement deux catégories très
distinctes de Savants, voire un schisme, entre les uns qui se vanteront d’être récupérés, et les
autres d’être irrécupérables. Chacun des deux accusant naturellement l’autre de ne pas faire le
même métier, tout en jalousant secrètement quelques pans de sa légitimité ô combien
différente.
La question qui se pose aux relations internationales, comme sous-branche de la science
politique en France et comme discipline à part entière ailleurs, est de savoir si elles peuvent
réconcilier l’utilité sociale et l’autonomie scientifique, l’aide critique à la décision et sa
déconstruction éclairée. De quoi parlons-nous ici, lorsqu’on évoque les relations
internationales ? Sur l’objet et sur le fond, de la même chose que les directeurs de cet
ouvrage : ne revenons pas sur ce débat. Sur la forme, il convient de savoir si nous incluons
tous ceux qui font des relations internationales quel que soit leur métier, ou si nous arrêtons
notre réflexion aux universitaires, c'est-à-dire aux enseignants-chercheurs en poste (ou aux
doctorants et post-doctorants aspirant à les rejoindre) qui rédigent des travaux à partir de
sources ouvertes, et destinés à être rendus publics.
C’est cette dernière position qui sera retenue ici, car elle pose la question – qui nous intéresse
dans le cadre de cet ouvrage – de la relation entre une discipline (ou sous-discipline)
universitaire, et le monde de la décision. Ce qui n’est bien sûr pas le cas des rédacteurs
diplomatiques, militaires ou autres qui ont la charge, à un certain moment de leur carrière, de
produire des analyses internationales dans le cadre de leur appartenance à la machine
décisionnelle. Le cas des chercheurs de think tanks serait plus « plaidable » : eux aussi, ont
vocation à publier ; eux aussi rencontrent le dilemme récupération-déconstruction ; ils sont
même, pour certains d’entre eux, issus du monde universitaire ou sous-traitent à ce dernier
1
Frédéric Charillon est professeur des Universités en science politique et directeur de l’Institut de
Recherches Stratégiques de l’Ecole militaire (IRSEM).

certaines de leurs consultances. Mais leur posture est différente, tout en étant bien entendu
légitime : ils ne sont pas tenus par le devoir de scientificité académique,
2
ni par une
inscription méthodologique ou théorique ; leur finalité peut être la connaissance et
l’explication, mais parfois aussi le militantisme : tel est le cas des fondations ou centres anglo-
saxons qui alimentent en idées des partis politiques pour faire triompher une ligne ou des
valeurs précises. Ajoutons que nous focaliserons notre propos sur la recherche, à partir du
stade doctoral, laissant de côté la question de l’enseignement, qui renverrait à trop de sous-
thèmes éloignés du cœur de cet ouvrage.
3
Quel est alors l'état de cette relation entre l’analyse et la pratique des relations internationales,
entre la discipline et son objet, entre chercheur et décideur ? Une première série de
questionnements préalables aura trait à la vocation même des relations internationales comme
discipline : doit-elle se rapprocher de la décision, un peu, beaucoup, passionnément ? En
restant sur l’Aventin hyperthéorique ou en descendant dans l’arène des current Affairs ? Une
seconde famille de questions porte sur les canaux qui lient l’analyse universitaire à ses
consommateurs ou soutiens politiques potentiels. Ce lien est-il d’abord fonction de la
sociologie des acteurs eux-mêmes ? De la nature des supports dans lesquels les premiers
produisent, et qui les rend plus ou moins accessibles aux seconds ? Enfin, on reviendra sur le
cas plus spécifique de la France, où cette question, davantage que dans le monde anglo-saxon,
est théorisée, intellectualisée… à partir d’une situation pourtant critique.
La question de la vocation : les relations internationales en quête de
posture
A quoi, à qui, doivent servir les relations internationales ? A personne sinon au bien commun
de la connaissance et à sa communauté épistémique, car la science (même sociale), pour être
pure, doit être libre des contraintes de pouvoir ? Aux autorités publiques qui financent les
recherches, car le payeur est le commandeur,
4
et l’aide à la recherche participe d’une politique
publique contribuant à la performance, au développement et à la protection d’une société ? Il
s’agit là, on le sait, d’une vieille question. Celle-ci prend néanmoins des traits spécifiques
lorsqu’il s’agit des relations internationales, pour au moins trois raisons : a) les relations
internationales constituent le cadre dans lequel évolue un Etat, dans lequel il défend ses
intérêts, en coopération ou en conflit avec différents acteurs, et où se joue son rayonnement,
sa prospérité, son intégrité voire sa survie. Leur connaissance prend donc, aux yeux des
décideurs, une dimension plus directement stratégique que d’autres secteurs, et qui se discute
souvent au plus haut niveau de l’exécutif, comme en témoignent les notions de « domaine
réservé » ou de « politique régalienne ». b) Les relations internationales traitent de l’actualité
politique immédiate, qui appelle de la part du décideur des réponses rapides. A ce titre,
2
Auquel les académiques eux-mêmes ne se conforment pas toujours, mais c’est là un autre débat.
3
Il faudrait en effet y aborder, entre autres, les questions des masters consacrés aux relations
internationales, la présence de cet objet ou de cette discipline au niveau licence, et sans doute plus en amont
encore, nous interroger sur la sensibilisation aux questions internationales, stratégiques et de défense dès le
collège et le lycée.
4
Auquel cas cette règle vaudrait également pour un financement privé.

l’analyse des relations internationales se voit souvent rattrapée par la temporalité politique. c)
Précisément parce qu’il s’agit de questions que les professionnels de la décision traitent au
quotidien, et qui font par ailleurs l’objet d’un débat public aux termes relativement accessibles
(dans la presse par exemple), le discours académique sur les relations internationales n’est pas
en situation de monopole : il n’est qu’une prise de parole parmi d’autres qui revendiquent à
leur tour d’autres compétences au moins équivalentes. C’est moins le cas des sciences dures,
ou même de la sociologie, géographie, histoire, économie ou droit, domaines dans lesquels on
reconnaît plus volontiers la compétence spécifique des universitaires.
5
Trois questions au moins permettent d’interroger la posture des relations internationales
comme science sociale au regard de leur relation au pouvoir politique. La première est celle
du choix entre trois risques : celui de la marginalisation, celui de l’engrenage, celui de la
dénonciation. La deuxième rejoint le débat entre recherche fondamentale et recherche
appliquée. La troisième question, apparue plus récemment, ramène en réalité à un faux débat :
celui qui prétend opposer la recherche à l’expertise.
L’alternative Marginalisation – Engrenage – Dénonciation
La position de l’analyse académique de relations internationales vis-à-vis du monde
décisionnel est presque toujours malaisée. Si elle traite de sujets qui n’occupent pas
directement l’esprit des décideurs, le premier risque est celui de la marginalisation. Ce risque
intervient lorsque l’agenda de recherche poursuivi par une communauté scientifique nationale
ne recoupe pas celui du Politique, situation qui peut résulter d’une combinaison de plusieurs
facteurs : a) les compétences scientifiques manquent pour produire rapidement des analyses
ré-injectables dans le monde décisionnel ; b) les compétences existent mais les questions ne
sont pas posées de part et d’autre dans les mêmes termes ; c) sans qu’il soit question de
compétence, les sujets traités par les uns sont tout simplement très éloignés de ceux qui
intéressent les autres. Prenons le cas de la demande d’analyse sur les révolutions arabes au
lendemain des mouvements du début de l’année 2011. Dans la situation a), le décideur
cherchera à mobiliser rapidement des spécialistes de la Tunisie, qu’il ne trouvera pas
nécessairement en nombre. Il se montrera déçu, aux Etats-Unis comme en Grande-Bretagne
ou – plus étonnant – en France, de trouver finalement davantage de spécialistes du Proche-
Orient et de la question israélo-arabe, que des relations bilatérales avec, ou des dynamiques
politiques et sociales de, la Tunisie de Ben Ali (et de l’Afrique du Nord en général). Dans la
situation b), on pourra déposer sur la table du même décideur un ouvrage important sur
L’Egypte au présent,
6
réalisé sur plusieurs années par plusieurs générations de chercheurs
français financés au CEDEJ du Caire
7
par l'Etat lui-même, et publié opportunément en 2011.
Voilà qui recoupe a priori, avec talent et pertinence, l’intérêt du moment pour le basculement
5
Il est plus rare qu’un individu au demeurant peu connu se présente, à la télévision ou la radio, comme
un « spécialiste d’économétrie », du Moyen-Age ou de la croûte terrestre.
6
V. Battesti, F. Ireton, L'Egypte au présent, Inventaire d’une société avant révolution, Acte Sud, Paris,
2011.
7
Centre d'Études et de Documentation Économiques, Juridiques et Sociales. www.cedej-eg.org/

politique de ce géant du monde arabe, qui préfigure tant de recompositions stratégiques. Las,
la taille du volume (plus de 1.200 pages), son caractère exhaustif, qui va des
dysfonctionnements de l’urbanisme aux évolutions culturelles, présentent des « signaux
faibles » si subtils que l’entourage du Prince aura tendance à n’y voir qu’une somme de
réponses elliptiques ou peu exploitables à d’autres questions que les siennes. Dans la situation
c) enfin, il y aura tout simplement divorce entre les agendas. A l’heure où la diplomatie
américaine s’interroge sur la façon de traiter avec des interlocuteurs religieux dans le nouveau
monde arabe, le Congrès de l’International Studies Association (ISA), tenu au printemps 2012
à San Diego, se penche avec ferveur sur le rôle sociologique de Facebook et de Twitter dans
les processus révolutionnaires.
8
Ailleurs, et comme leurs responsables en feront publiquement
l’amer reproche, des programmes universitaires consacrés à la zone seront fermés quelques
semaines seulement avant les soulèvements.
9
Nul procès d’intention aux uns ni aux autres ici, qui ont chacun leurs priorités légitimes. Mais
plutôt le constat que ces priorités, qui ne sont pas tenues de s’accorder, ne s’accordent pas en
effet. Dès lors, la recherche universitaire de relations internationales vit sa propre vie. Le prix
à payer peut en être la marginalisation, vis-à-vis d’un monde de la décision conforté dans son
idée que c’est bien ailleurs, et d’abord en son sein, qu’il faut chercher les réponses à ses
questions.
Ce divorce peut naturellement être évité, si le monde universitaire s’efforce d’orienter ses
programmes de recherche en fonction de la demande publique d’analyse. Plusieurs
instruments permettent de le faire, qui vont de la consultation régulière entre chercheurs et
décideurs jusqu’à la réponse aux appels d’offre émis par ceux-ci, en passant par les
financements fléchés de bourses doctorales ou autres programmes permettant d’orienter la
production.
10
Mais le risque prend alors un autre visage : celui de l’engrenage, dans un
processus qui consiste à suivre l’expression politique du besoin sans jamais pouvoir la
satisfaire totalement (tant cette dernière est à la fois exigeante et mouvante), ni s’assurer de sa
pertinence (tant elle est déterminée par des facteurs endogènes). Il y a là engrenage potentiel,
au sens où la production académique pourra, si elle n’y prend pas garde, se lancer dans une
fuite en avant consistant, à force de se montrer « policy-oriented »,
11
à s’interdire toute sortie
de la « dépendance au sentier », renonçant par là-même à jouer son rôle d’aiguillon en tant
que contribution autonome et extérieure, sans parler de la dépendance financière qui peut
s’instaurer entre un consommateur d’analyse et un producteur qui aura à cœur de ne pas tarir
cette précieuse source par des réponses dont le caractère contre-intuitif sera considéré
inapproprié.
8
Voir le programme de la conférence, qui comporte plusieurs panels consacrés à cette question, sur
www.isanet.org.
9
Voir G. Kepel, Passion arabe, Gallimard, Paris, 2013.
10
Comme les « ACI » en France, ou Actions Concertées Incitatives.
11
Au sens anglo-saxon d’une analyse dont la finalité est l’utilisation en vue de l’aide à la décision.

L’un des moyens de sortir de ce dilemme marginalisation–engrenage pourrait consister à
adopter la posture de la dénonciation. Plutôt que de prendre le risque d’être négligé du
décideur pour cause de fantaisie théorique, ou de devoir courir après son expression de
besoin, le chercheur analysera sans ménagement la politique menée par celui-ci, pour en
démontrer systématiquement les impasses ou les biais supposés. Relation de conflit structurel,
donc, entre chercheur et décideur. Le conflit étant, après tout, une forme comme une autre de
reconnaissance et de continuation du dialogue social, comme nous l’a rappelé Simmel :
12
« je
parle bien des mêmes choses que vous mais autrement, et ma valeur ajoutée est dans ma
critique, fut-elle violente ». Une bonne part des travaux académiques français sur la politique
africaine de la France, ou sur sa politique vis-à-vis du monde arabe, participe ainsi de ce
registre. Les inconvénients de cette posture sont connus : non-respect de la neutralité
axiologique, confusion entre une posture de recherche et une posture militante, risque de perte
de contact avec la réalité de la décision comme processus (process), à force de la dénoncer
voire de la caricaturer comme résultat (outcome).
Eviter ce triple danger marginalisation-engrenage-dénonciation relève de la gageure. L’étude
des relations internationales ne peut pas se couper du monde de la décision en se réfugiant
dans l’abstraction, la critique ou les sujets mineurs. Elle ne peut pas non plus « coller » à
l’agenda politique en renonçant à une scientificité qui doit rester extérieure à ce monde
décisionnel. Sa justesse dépendra d’autres positionnements, notamment sur l’équilibre entre
recherche théorique et appliquée, et sur son insertion dans l’action internationale elle-même.
Le débat recherche fondamentale / recherche appliquée, et la question de la
« prospective »
Les relations internationales ne gagnent pas forcément à reprendre à leur compte le dilemme
connu des sciences dures ou des techniques, entre recherche fondamentale et recherche
appliquée. Que signifient en effet ces deux termes lorsque nous parlons de relations
internationales ?
13
La recherche fondamentale renvoie-t-elle à une recherche purement
théorique, par exemple sur la place de l’approche réaliste ou d’une approche constructiviste /
critique aujourd’hui ?
14
A une comparaison entre les approches théoriques de différents
ensembles régionaux ?
15
A une étude épistémologique des cadres théoriques et
métathéoriques, ou de leur agencement avec les théories intermédiaires ? La recherche
appliquée est-elle nécessairement, à l’inverse, celle qui porte sur des études de cas concrètes
12
G. Simmel, Le conflit, Circé, Paris, 1984.
13
La complexité de cette question vaut naturellement pour l’ensemble des sciences sociales. Voir E.
Desveaux, M. de Fornel (dirs), Faire des sciences sociales, t.1, 2, 3, EHESS, Paris, 2012. P. Favre, Comprendre
le monde pour le changer, Épistémologie du politique, Presses de Sciences Po, Paris, 2005.
14
P.H. Haas, J.A. Hird (dirs), Controversies in Globalization: Contending Approaches to International
Relations, CQ Press, New York, 2013.
15
D.L. Blaney, A.B. Tickner, O. Waver (dirs), Thinking international relations differently, Routledge,
Londres, 2012.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%