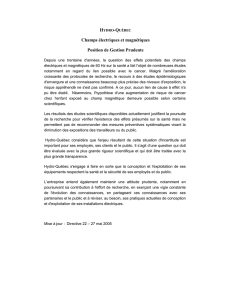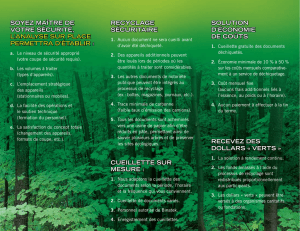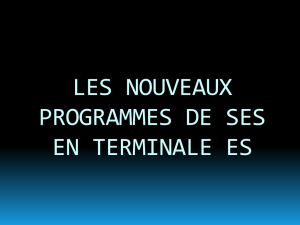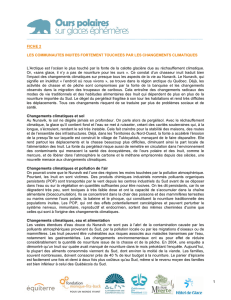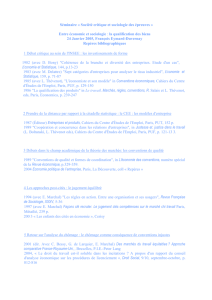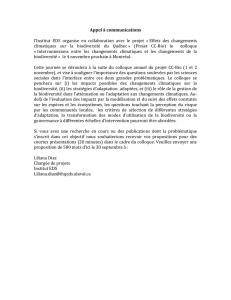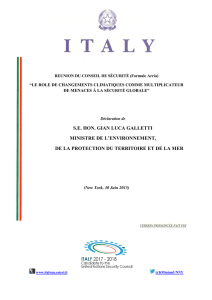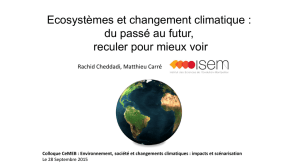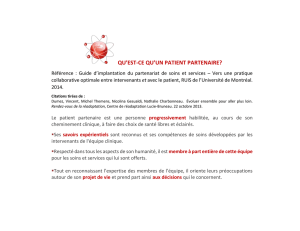savoirs et vécus des femmes inuites du Nunavik

LES CAHIERS DE L’Institut EDS
Janvier 2012
Vulnérabilité et
adaptations aux
changements climatiques :
savoirs et vécus des
femmes inuites
du Nunavik
Caroline Desbiens
Professeure au Département
de géographie
Université Laval
Laurence Simard-Gagnon
Étudiante à la maîtrise
en sciences géographiques
Université Laval

L’Institut EDS
L’Institut EDS (Institut Hydro-
Québec en environnement,
développement et société) regrou
pe des membres de la
communauté universitaire, provenant aussi bien de sciences
sociales que de sciences dures ou appliquées, qui partagent
un intérêt commun pour
la recherche et la formation en
environnement, développement et société.
Le mandat de l’Institut est de soutenir
la recherche
pluridisciplinaire et les synergies entre spécialistes, et de
promouvoir une vision d’ensemble su
r les questions
d’environnement dans la société.
L’Institut réalise ou
facilite des activités visant l’approfondissement
et la
diffusion des connaissances, dan
s le domaine de
l’environnement et du développement durable. Afin de
faciliter l’atteinte de ces
objectifs, la structure se veut
souple, rassembleuse et ouverte.
La recherche à l’Institut EDS
Les recherches menées à l’Institut s’articulent autour de
quatre thématiques :
1) Disponibilité et gestion des
ressources hydriques; 2) Atténuation,
vulnérabilités et
adaptation aux changements climatiques; 3) Dynamique et
gouvernance de la biodiversité
et 4) Stratégies du
développement durable. Ces thématiques s’inscrivent dans
les champs d’activités prioritaires en environnement et
développement du
rable identifiés dans le plan de
développement de la recherche 2006-
2010 de l’Université
Laval, institution d’attache de l’Institut EDS.
Les Cahiers de l’Institut EDS
publient quatre séries
consacrées spécifiquement à chacune de ces thématiques et
rendent compte des
résultats des recherche des membres de
l’Institut, notamment celles
développées dans le cadre des
projets qu’il finance.
Site Internet : www.ihqeds.ulaval.ca
Coordonnées de l’Institut EDS
Institut Hydro-Québec en environnement,
développement et société
2440, Pavillon des Services
Boul. Hochelaga, local 3800
Université Laval, Québec, G1K 7P4
Téléphone : (418) 656-2723
Télécopieur : (418) 656-7330
Courriel : [email protected]

Les Cahiers de l’Institut EDS, janvier 2012
Institut Hydro-Québec en environnement,développement et société 1
Photo : Studio Perspective
Caroline Desbiens
Caroline Desbiens est professeure adjointe au d
épartement de
Géographie de l’Université Laval et titulaire de la
Chaire de
recherche en géographie historique du Nord depuis juillet 2004.
Elle détient une maîtrise en littérature comparée et un doctorat en
géographie de l’Université de la Colombie-
Britannique (UBC).
Suite à l’obtention de son doctorat en 2001, elle occupa un poste
conjoint en Géographie et Études des femmes à l’Université de la
Georgie (UG
A) près d’Atlanta. Depuis son retour au Québec, ses
recherches portent spécifiquement sur les dynamiques de
l’humanisation du Nord québécois et sur l’impact de l’imaginaire
nordique du Sud sur les relations entre autochtones et non-
autochtones. En plus de s’intéresser aux discours sur le Nord, ses
travaux font appel aux méthodes de la géographie historique pour
comprendre les régimes autochtones d’occupation du territoire,
avec une attention particulière pour les savoirs et pratiques des
femmes.
Laurence Simard-Gagnon
Laurence Simard-
Gagnon est étudiante à la maîtrise en géographie
culturelle, sous la direction de Caroline Desbiens
à la Faculté de
foresterie, de géographie et de géomatique
. Sa recherche, ancrée
dans une approche féministe, explore les savoirs et pratiques des
femmes inuites par rapport à la cueillette et à l'utilisation des petits
fruits. Laurence bénéficie du soutien financier du Fonds de
recherche du Québec, société et culture. Elle est membre du réseau
DIALOG de recherche et de connaissances relatives aux peuples
aut
ochtones, ainsi que du Centre interuniversitaire d'études
québécoises (CIEQ).

Les Cahiers de l’Institut EDS, janvier 2012
Institut Hydro-Québec en environnement,développement et société 2
VULNERABILITE ET ADAPTATIONS AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES :
SAVOIRS ET VECUS DES FEMMES INUITES
DU NUNAVIK
Caroline Desbiens
Professeure au Département de géographie
Université Laval
Laurence Simard-Gagnon
Étudiante à la maîtrise en sciences géographiques
Université Laval
20 décembre 2011

Les Cahiers de l’Institut EDS, janvier 2012
Institut Hydro-Québec en environnement,développement et société 3
Dans toute société, les fluctuations en matière d’accès aux ressources et d’organisation du
travail – perçu dans son sens large comme l’éventail de tâches traditionnelles, domestiques, ou
rémunérées – entraînent des changements au niveau des rapports entre hommes et femmes; cette
situation s’explique par la complémentarité des tâches effectuées par chacun des sexes (Hanson et
Pratt 1995, Labrecque 2001). Dans les communautés inuites du Nord du Québec, ces dynamiques
se complexifient en contexte de changements climatiques puisque ceux-ci transforment la relation
au savoir, au territoire, et aux modes de production d’hier et d’aujourd’hui. Malgré cela, les
recherches stratégiques qui mènent à l’élaboration de politiques relatives aux peuples autochtones
font souvent abstraction des dynamiques de genre dans leurs travaux, une approche qualifiée de
« gender blindness » par les auteurs d’un rapport soumis en 1998 à Condition féminine Canada
(Dion Stout et Kipling). L’absence d’une telle grille d’analyse nous prive de données
fondamentales non seulement concernant les impacts sociaux du réchauffement climatique mais
aussi concernant les impacts sur le milieu de vie. En effet, les femmes sont détentrices
d’importants savoirs traditionnels issus des activités de production qui leur reviennent en vertu de
la division des tâches selon les sexes. Une analyse plus fine du social, dont les dynamiques de
genre sont une composante au même titre que les dynamiques entre différentes ethnies, classes,
générations ou régions, révèle que les hommes et les femmes ne subissent pas nécessairement les
mêmes contraintes reliées aux transformations de leur sphère de vie. Ainsi, lorsque la mobilité
sur le territoire est entravée et que la chasse devient moins productive, hommes et femmes
doivent développer des stratégies différentes d’adaptation en lien avec la part des activités
traditionnelles ou de marché auxquelles ils ou elles s’adonnent pour subvenir aux besoins de la
famille et de la communauté.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%