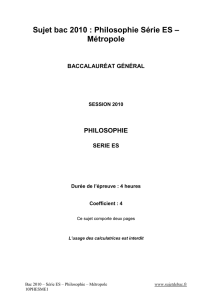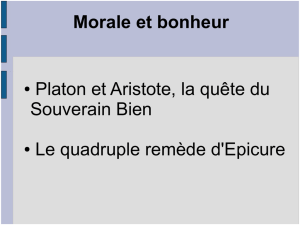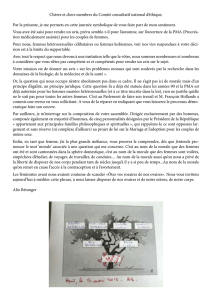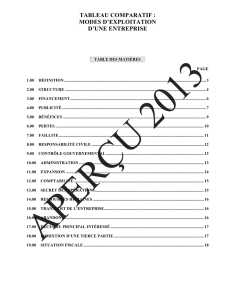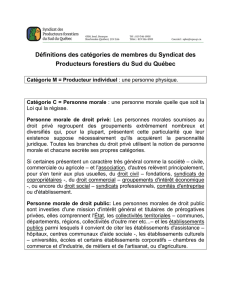Introduction historique à la philosophie morale

Une histoire de la philosophie morale∗
ANR ETHICAA – ANR-13-CORD-0006
Delivrable #2
14 décembre 2014
∗Robert Voyer (IMT et LASCO - robert.voy[email protected])
1

Table des matières
I Introduction historique à la philosophie morale 5
1 Introduction 5
1.1 Fondement religieux .................................. 5
1.2 Fondement social .................................... 6
1.3 Fondement positif ................................... 6
2 Protagoras (485-411) 7
3 Socrate (470-399) 7
4 Platon (427-348) 8
5 Aristote (384-322) 8
5.1 Le notion de justice .................................. 10
6 Épicure (341-270) 10
6.1 Les soucis ........................................ 12
6.2 La justice ........................................ 12
7 Le stoïcisme 13
7.1 Le stoïcisme ancien ................................... 13
7.2 Le stoïcisme moyen ................................... 14
7.3 Le stoïcisme nouveau .................................. 15
7.3.1 La justice .................................... 15
8 Réflexions sur la morale du sage 15
8.1 Technique de raisonnement dans la morale du sage ................. 16
8.1.1 La conformité avec la nature dans la morale du sage ............ 16
8.1.2 La maitrise de soi et la morale du sage .................... 18
8.1.3 L’incompatibilité entre la morale et une simple technique du bonheur . . 18
8.1.4 L’idée de la nature dans la morale du sage .................. 19
9 Plotin (+- 205 - +- 270) 20
9.1 Influence du brahmanisme ............................... 20
9.2 Influence du bouddhisme ................................ 20
10 La morale biblique et évangélique 22
10.1 La Bible et les prophètes ................................ 22
10.2 L’enseignement de Jésus de Saint Paul ........................ 23
11 Saint Augustin (354-430) 24
12 Saint Thomas d’Aquin (1225-1274) 25
12.1 Saint Thomas et saint Augustin ............................ 26
12.2 Saint Thomas et Aristote ............................... 26
12.3 Le droit naturel ..................................... 27
12.4 Le rapport de l’homme avec la cité .......................... 27
2

13 Thomas Hobbes (1588-1679) 28
14 Sponiza (1632-1677) 29
14.1 Le système de Spinoza ................................. 29
14.2 La morale de Spinoza ................................. 30
15 Shaftesbury (1671-1713) 31
15.1 Critique de la morale de Shaftesbury ......................... 33
16 Butler (1692-1752) 33
17 Hume (1711-1776) 35
18 Kant (1724-1804) 36
19 La morale de Kant 37
19.1 La morale et la théorie de la connaissance ...................... 37
19.2 La condition de la moralité : la bonne volonté .................... 38
19.3 Le critère de la bonne volonté : la conformité au devoir ............... 38
19.4 Comment concevoir la loi morale ? .......................... 38
19.5 Que pouvons-nous espérer ? .............................. 41
19.6 Conclusions ....................................... 41
19.7 Remarques conclusives ................................. 42
20 L’utilitarisme 42
20.1 Jérémie Nentham (1748-1832) ............................. 42
20.1.1 Principe d’utilité ................................ 42
20.1.2 Les vertus fondamentales de l’utilitarisme .................. 43
20.1.3 L’arithmétique des plaisirs ........................... 44
20.1.4 L’intérêt individuel et l’intérêt général .................... 44
20.2 John Stuart Mill (1806-1873) ............................. 45
20.2.1 Sa morale .................................... 45
20.3 Henry Sidgwick (1938-1900) .............................. 46
20.3.1 Sa morale .................................... 46
20.4 Synthèse entre l’utilitarisme et le kantisme ...................... 47
20.5 Conclusions ....................................... 48
21 Hegel (1770-1831 48
21.1 Sa vision globale .................................... 48
21.2 La morale qui découle de cette vision ......................... 51
21.3 Conclusions ....................................... 51
22 Marx (1818-1883) 52
22.1 Le conditionnement social de l’individu ....................... 52
22.2 L’activité consciente de l’individu ........................... 53
23 Kierkegaard (1813-1855) 54
23.1 Philosophie et morale ................................. 54
23.2 Conclusions ....................................... 56
3

24 Nietzsche (1844-1900) 57
24.1 Sa morale ........................................ 57
24.2 Conclusion ....................................... 59
25 Conceptions sociologiques de la morale 59
25.1 La notion de société dans les philosophies morales de Protagoras à Lévy-Bruhl . 59
26 La morale sociologique de Lucien Lévy-Bruhl (1857-1929) 61
27 La morale sociologique d’Émile Durkheim (1858-1917) 63
27.1 La conformité aux règles pré établies ......................... 64
27.2 Trois éléments de la moralité dans la conception de Durkheim ........... 64
27.2.1 L’esprit de discipline .............................. 64
27.2.2 L’attachement aux groupes sociaux ...................... 64
27.2.3 L’autonomie de la volonté ........................... 68
28 Henri Bergson (1859-1941) 68
29 Eugène Dupréel (1879-1967) 70
29.1 La moralité en générale ................................ 71
29.1.1 Aspect sociologique de la morale ....................... 71
29.1.2 Aspect subjectif de la morale ......................... 76
29.2 Les formes particulières du mérite moral ....................... 78
29.2.1 Classification des formes de mérite (règles et vertus) ............ 78
29.2.2 examen des principales vertus ......................... 79
29.3 Conclusions ....................................... 86
30 Conclusions générales 86
4

Première partie
Introduction historique à la philosophie
morale
Nous synthétisons principalement les travaux de Chaïm Pereleman sur la philosophie morale.
À noter que Chaïm Perelman a été élève de Eugène Dupréel dont l’approche sociologique de la
morale a eu un certain écho, que Michel Meyer (le modèle des distances que j’ai présenté dans
un autre document) a été élève de Chaïm Perelman et que finalement Michel Meyer a été très
influencé par André Comte-Sponville dont j’ai présenté le modèle des ordres.
1 Introduction
La philosophie morale se présente sous deux aspects très différents.
Approche traditionnelle. C’est la philosophie qui ne se contente pas d’accepter
les règles telles quelles mais cherche à les améliorer et à les perfectionner. Depuis
Parménide la philosophie grecque a cherché à opposer ce qui était accepté et admis
par l’opinion à ce qui était la vérité, or la morale admise dans un certain milieu
social est toujours objet d’opinions auxquelles on peut opposer une morale qui serait
fondée philosophiquement, qui serait l’objet d’une science qui ne se contente plus des
opinions courantes. C’est à cette conception de la philosophie morale que se rattache
l’idée traditionnelle de la sagesse grecque.
Approche descriptive et analytique. C’est la philosophie morale qui étudie la
structure et le sens des notions morales et des notions annexes (responsabilité, liberté
etc.). Cette tendance, différente de la philosophie morale traditionnelle, prévaut dans
la philosophie contemporaine, surtout anglo-saxonne 1.
Dans la conception traditionnelle, la philosophie morale a pour objet d’élaborer une morale fon-
dée en raison, par la recherche de la vérité en morale, vérité qui, contrairement aux opinions des
morales sociales, se présente comme une et commune à tous.
1.1 Fondement religieux
Le résultat de cette étude est de proposer une fin aux humains : le souverain Bien. Petit souci,
la pensée grecque a énuméré 288 conceptions différentes. Le scepticisme fait place au rationa-
lisme, situation illustrée de façon adminirable par Montaigne dans ses Essais. Par les Pensées de
Pascal, la religion révélée est la seule voie d’accès à la vérité de la religion 2. La Révélation est le
1. Il y a là un choix méthodologique s’agissant des agents autonomes éthiques. S’intéresse-t-on aux notions
utiles (logiques, concepts épais, etc.) ou aux conditions de possibilités d’une éthique pour les agents ? Cette
question peut avoir son importance dans le cadre d’une communauté d’agents. Dans cette orientation, on peut se
focaliser sur l’origine (et non le fondement auquel pour ma part je ne souscris pas car il est de droit, alors que
l’origine est de fait) même des comportements éthiques. C’est ici qu’il y a, de mon point de vue, un problème
délicat. Toute morale est issue de la conscience de l’autre et surtout, par la médiation du corps, de sa propre
fragilité qui est source du mal ressenti et donc par compassion, par analogie de la fragilité d’autrui. Comment
peut-il en être de même pour un agent virtuel ? Si vous ne savez ce qu’est le mal, la réponse est finalement simple :
« si vous ne savez pas ce qu’est le mal, écoutez votre corps ». « Ce que le corps sait, l’esprit le veut » (Traité du
désespoir et de la béatitude, A.C.-S.).
2. La raison est incapable de trouver la vérité morale
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
1
/
92
100%