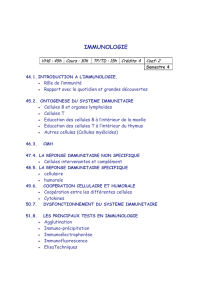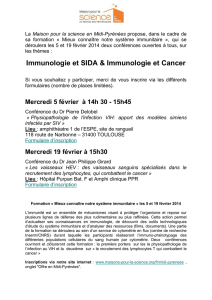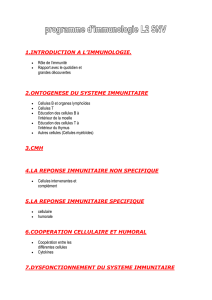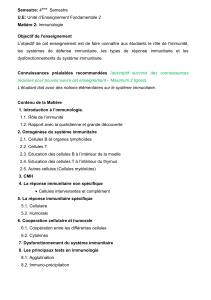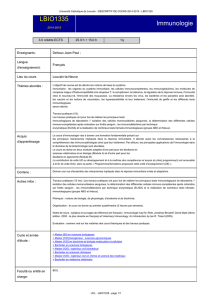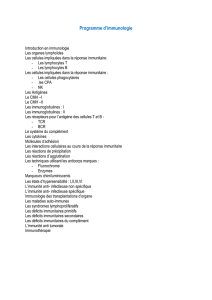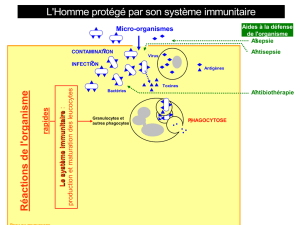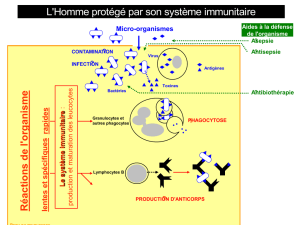Anthony Rongvaux

IMMUNOLOGIE
Anthony Rongvaux
Connaître le fonctionnement du système
immunitaire sur le bout des doigts
Arrivé à l’université avec l’envie de sauver les forêts d’Amazonie, Anthony Rongvaux y découvre
l’immunologie et ses questions fondamentales. Son objectif avoué à partir de ce moment: comprendre
comment fonctionne le système immunitaire dans le moindre détail. Une quête qui l’amène à Yale pour y
apprendre les techniques de pointe avec les meilleurs chercheurs de ce domaine.
abnégation. Et ça il n’y a que lui qui puisse
le faire, personne ne va venir faire des
expériences à 5h du matin si ce n’est lui. ».
Un second défi ?
L’enseignement !
Quand il arrive à Yale et qu’il apprend qu’il
devra encadrer des étudiants au laboratoire
Anthony Rongvaux est loin d’être enthou-
siaste… Il avait le sentiment que le temps
qu’il consacrerait à ses étudiants serait
du temps en moins pour se propres re-
cherches. « Finalement, ça s’est révélé être
un deuxième défi dans ma carrière. Quand
on explique une expérience à un étudiant, il
faut encore plus réfléchir à ce qu’on fait, que
lorsqu’on le fait soi-même pour ne pas lui
bIO EN bREF
1978 Naissance à Esch-sur-Alzette
1999 Obtention d’une licence en biologie, ULB
2004 Docteur en biologie, ULB
2005 Post-doctorat, ULB
2006-2013 Post-doctorat, Université de Yale (USA)
2013 Chercheur qualifié FRS-FNRS, ULB
projet -Rôle des sous-populations murines et humaines de
monocytes/macrophages dans la réponse immune innée dans
le contexte de l0infection et du cancer, à l0aide de modèles de
souris et de souris humanisées
Anthony Rongvaux,
physiologie cellulaire, ULB
De l’ornithologie à
l’immunologie
A la fin de ses études secondaires, ce ne
sont pas forcément les globules blancs et
les lymphocytes qui intéressent Anthony
Rongvaux. Ce qu’il aime, c’est l’ornithologie.
« Je m’intéressais beaucoup à la biodiversité,
l’évolution et l’écologie. Je voulais sauver
la planète, les forêts d’Amazonie, tout ça
», se rappelle-t-il. Mais au cours de ses
études, il approche l’immunologie et
découvre une science moins contemplative,
plus cartésienne. « Quand on va chez le
médecin, il n’y a pas une seule maladie
pour laquelle le système immunitaire
n’entre pas en jeu. Il est partout. En outre,
en étudiant le système immunitaire et en
comprenant mieux comment il fonctionne,
on peut contribuer à l’amélioration et à la
découverte de nouveaux traitements ».
Un enchaînement logique
Une fois mordu d’immunologie, tout n’a été
qu’une suite logique explique le chercheur
: le doctorat, le postdoctorat à Yale et
finalement le poste de chercheur qualifié
F.R.S.- FNRS, tout s’est passé naturellement
sans qu’il n’ai l’impression de devoir faire
un choix. « Je voulais comprendre comment
fonctionne le système immunitaire et pour
ce faire, la recherche était ma seule option.
J’avais d’ailleurs déjà postulé comme
aspirant FNRS avant d’avoir commencé
mon mémoire dans le laboratoire de
Jacques Urbain à l’Université Libre de
Bruxelles ». Au départ, il n’y avait que la
recherche fondamentale qui l’intéressait.
Il n’avait pas d’attrait particulier pour la
recherche appliquée. « Mais avec le temps,
j’ai revu mes positions. En effet, à mesure
de mes recherches, j’ai réalisé que c’est
lorsqu’il y a un problème que le système
immunitaire s’active. Il n’y a donc pas
d’intérêt à l’étudier indépendamment
de maladies telles que les infections,
l’inflammation ou les tumeurs. Depuis, j’ai
une vision à plus long terme : je réfléchis à
comment mes travaux pourront être traduits
en recherche appliquée. »
Son modèle : la souris
Pour étudier le système immunitaire,
Anthony Rongvaux travaille sur des rongeurs.
Plus précisément, il construit des modèles
de souris avec un système immunitaire
humain. Mais la souris ne permet pas
de tout étudier ! « La souris est un super
modèle pour les études en immunologie
mais ce ne sont pas des êtres humains, je
dois donc aussi m’intéresser à l’homme. Ce
que je fais en travaillant avec des médecins
et des échantillons isolés de leurs patients.
En travaillant avec eux, je me suis forcément
rapproché de la recherche appliquée mais
je reste un biologiste moléculaire plus
proche de la recherche fondamentale que
la recherche appliquée », sourit-il.
Travailler avec les
meilleurs à Yale
Si à chaque étape de son parcours
scientifique, Anthony Rongvaux a
rencontré des personnes qui l’ont motivé
et enthousiasmé au point de lui donner
envie d’en savoir plus, sa rencontre avec le
Professeur Oberdan Leo a très clairement
été décisive. « Ca a commencé pendant ma
licence quand il m’a dit que si l’envie de
faire de la recherche me prenait, les portes
de son labo m’étaient grandes ouvertes.
Ensuite, quand j’ai fini mon doctorat, il
m’a poussé à postuler chez les meilleurs
chercheurs en immunologie. Ca m’a
forcément motivé et poussé à croire que
c’était possible ».
C’est comme ça qu’en 2006, il s’envole
pour l’Université de Yale aux Etats-Unis.
« Là-bas, j’ai eu la chance de travailler
dans un environnement du top mondial.
C’était vraiment très enrichissant : tant au
niveau intellectuel qu’au niveau technique.
Dans ce laboratoire, il y avait toujours un
chercheur qui connaissait quelqu’un qui
était au courant de la dernière découverte
importante. Par ailleurs, on travaillait
tous dans le même domaine mais de
manière différente et avec différents
modèles expérimentaux. C’est le meilleur
environnement pour apprendre et voir ses
problèmes sous des prismes différents.
Récemment en rédigeant un article, je
me suis demandé comment telle ou telle
expérience avait vu le jour et je me suis
rendu compte qu’aucune n’est sortie de la
tête d’un seul chercheur. Elles sont toutes
le fruit de la discussion entre chercheurs.
Evidemment, après, il n’y a que le chercheur
qui puisse faire avancer ses expériences. Il
faut se concentrer avec détermination et
apprendre d’erreur. Il faut aussi apprendre
à travailler avec chacun individuellement,
ce qui motive l’un ne fonctionnera pas
forcément avec l’autre. J’ai l’impression
que si mes étudiants n’accrochent pas
à la recherche, c’est que j’ai été mauvais.
Et quand on y arrive, on obtient des résul-
tats excellents, ça c’est vraiment super »,
conclut-il.
Elise dubuisson
1
/
1
100%