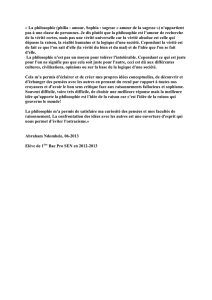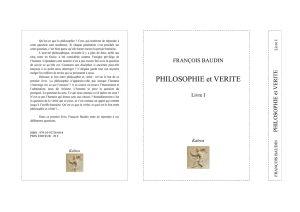Introduction

INTRODUCTION
« L’homme n’est pas seulement un être qui s’adapte,
il est un être qui s’invente. C’est un être qui ne peut
pas vivre en société sans se donner ou recevoir dès
sa naissance la capacité de produire de la société
pour vivre. »
1
C’est une habitude commune pour la vaste majorité des thésards, au
moins à notre connaissance, d’écrire l’introduction de leurs ouvrages après
avoir mis définitivement terme au travail de leur plume. Une fois la recher-
che achevée, vient l’heure de l’annoncer et paradoxalement de
l’entamer
…
comme si la fin
pouvait légitimement et à tout moment devenir le
commen-
cement
et vice-versa. Pourtant, on continue de nommer le passage
intro-
duction
au lieu d’un vrai
épilogue
même si le temps de la rédaction
demeure à peu près le même pour les deux. Autrement dit, chaque fois qu’on
écrit une introduction, destinée à toujours précéder le corpus principal, si
souvent accomplie au moment ultime avant le dépôt de notre étude, même
après avoir conclu notre texte, on commet inévitablement un délit logique ;
on enfreint gravement le contenu sémantique du mot, on trahit la lettre en
raison de la malignité de notre esprit, et de la force de notre volonté, on ren-
verse absurdement l’ordre du temps et du sens que le mot « introduction »
semble conventionnellement suggérer. Il se peut que la citation de ce para-
digme soit éventuellement exagérée ou superflue mais on se permet d’en
retenir la problématique centrale du
paradoxe
, particulièrement chère à la
1
Maurice G
ODELIER
,
Au fondement des sociétés humaines. Ce que nous apprend l’anthropologie
,
Albin Michel, Bibliothèque Idées, Paris, 2007, p. 189. L’éminent anthropologue français aborde les ques-
tions de la constitution de l’individu en sujet social ainsi que du moment fondateur de la société humaine,
en récapitulant les recherches qu’il mène depuis une quarantaine d’années. L’individu constitue alors un
être social qui « naît et se développe dans une société qui lui préexiste toujours et qui est structurée par
des rapports sociaux et des institutions spécifiques… » (p. 179), mais qui peut aussi produire la société,
et inventer les institutions. Car « au terme de ces premières remarques, on peut définir le sujet social
comme un individu inséré dans un réseau de rapport aux autres qui font sens pour lui et pour les autres,
et conscient de l’être, capable d’agir sur lui-même et sur les autres pour pérenniser ces rapports ou les
faire évoluer, voire les faire disparaître… » (p. 180). Nous nous permettons aussi d’informer ici le lecteur
que partout dans le texte c’est nous qui soulignons.
DBB.12116 Page 13 Mercredi, 23. janvier 2013 11:56 11

14
L’AUTONOMIE DE LA PERSONNE EN DROIT PUBLIC FRANÇAIS
pensée postmoderne
2
, car elle nous semble, désormais – après avoir commis
ou plutôt répété l’acte illogique précité, lequel, cependant, paraît avoir gagné
la logique des agents qui l’entreprennent – constituer le fil conducteur, la clé
de compréhension de notre étude sur l’autonomie. On le verra bien à la suite,
il revient toujours à un geste de pur paradoxe, à une décision folle, à un acte
insensé et invraisemblable de constituer le fondement indépassable d’une
notion floue et complexe qui anime la confusion du philosophe et
a fortiori
du juriste.
Néanmoins, contrairement à ce que pourrait laisser entendre ou supposer
l’intitulé de notre étude «
L’autonomie de la personne en droit public
français
», le présent travail n’obéit pas du tout à une sorte de monologisme
juridique, où le juriste se croit autosuffisant et confiant en lui-même de bien
signifier le concept, de délimiter ses contours et d’exposer sa portée,
d’autant plus que celui-ci connaît peu d’histoire juridique, notamment si on
le traite du côté de la volonté
3
, alors qu’il a un poids philosophique, à la fois
2
Notamment dans l’œuvre de Jean-François Lyotard qui reprend le concept de jeux de langage du
second Wittgenstein pour dresser son propre scepticisme épistémologique. Dans cette perspective
déconstructionniste qui sape les fondements de la raison, et sur laquelle sera épistémologiquement fon-
dée notre étude, il n’y a pas de vérité objective, la vérité elle-même étant un jeu de langage, une condition
où la détermination du sens passe forcément par la force de la volonté. Lyotard tire les conséquences du
tournant linguistique en général et pragmatique en particulier et affirme à juste titre que la philosophie du
langage sert comme outil de compréhension des liens sociaux, c’est-à-dire des institutions du sens, pour
parler ici comme Vincent Descombes, car le soi demeure très peu « mais il n’est pas isolé, il est pris dans
une texture de relations plus complexe et plus mobile que jamais » (p. 31)… ou plus simplement encore :
la question du lien social, en tant que question, est un jeu de langage, celui de l’interrogation, qui posi-
tionne immédiatement celui qui la pose, celui à qui elle s’adresse, et le référent qu’elle interroge : cette
question est ainsi déjà le lien social » (p. 32), voir
idem
,
La condition postmoderne
, Minuit, 1979. Cette
voie scepticiste rend caduque non seulement l’idée de vérité mais de la possibilité même de philosopher,
car la parole philosophique est considérée comme un acte de pure rhétorique, à l’instar de la pensée
sophistique, comme un jeu de langage historiquement et socialement muable et par conséquent absolu-
ment invalide aux termes de connaissance vraie. Cependant, il convient de préciser que la fondation du
scepticisme sur le second Wittgenstein, malgré son relativisme évident, n’est pas forcément rassurante
sur le statut épistémologique accordé à la Raison car pour Wittgenstein chaque jeu de langage, à l’exem-
ple d’un jeu d’échecs, est porteur d’une raison fondatrice, d’un sens commun qu’il ne nous appartient pas
– car cela dépasserait notre connaissance – de qualifier comme conventionnel/volontaire ou naturel.
Cependant, le fait que le jeu de langage représente une forme de vie semble impliquer qu’en droit, par
exemple, il « nous conduirait à soutenir une ontologie du droit conventionnaliste modérée. Enfin l’applica-
tion de la notion de forme de vie en philosophie du droit nous fait penser à la théorie du contrat social. Il
semblerait logique d’affirmer en ce sens, que les jeux de langage, y compris les jeux du langage juridique,
sont le résultat d’une convention passée entre les membres d’un milieu, d’une communauté ou d’une cul-
ture. Wittgenstein, nous semble-t-il, aurait contesté cette dernière affirmation à un double titre. D’un
côté, la notion de forme de vie, pour lui devrait avant tout faire ressortir que le langage n’est pas une
entité isolée qui proviendrait, comme le voulaient et le veulent les internalistes, d’une pensée résidant à
l’intérieur de l’homme. Le jeu de langage appartiendrait à une manière d’être, à un milieu, à une activité, à
une culture. De l’autre, Wittgenstein, avec la notion de forme de vie, prétend à notre avis, éliminer la dis-
tinction opérée à partir de Descartes ente culture et nature ». Voir Eduardo S
ILVA
-R
OMERO
,
Wittgenstein
et la philosophie du droit
, P.U.F., « Droit, éthique, société », Paris, 2002, p. 306.
3
L’autonomie de la volonté est traitée surtout d’un point de vue civiliste. Voir notamment Emmanuel
G
OUNOT
,
Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé
, Contribution à l’étude critique de
l’individualisme juridique, thèse, Paris, 1912 et l’étude plus récente, comprenant des développements sur
DBB.12116 Page 14 Mercredi, 23. janvier 2013 11:56 11

INTRODUCTION
15
ontologique, moral et politique extraordinaire
4
. Par conséquent, il s’est
avéré quasiment impossible, malgré toute intention initiale de notre part et
avec un certain regret, en raison de notre formation de juriste, d’écrire sur
l’autonomie d’un point de vue purement juridique, car, épistémologique-
ment et méthodologiquement
5
. l’aboutissement d’une telle décision, par
crainte peut-être d’explorer des objets de connaissance si étrangers, des
domaines qui nous paraissent encore largement des
terrae incognitae
,
serait, on le suppose
ex post
, la description ou plutôt la citation mécanique
4
Il serait inutile, voire impossible de citer ici une bibliographie interminable ; or, la question de l’auto-
nomie, traverse explicitement ou implicitement la majorité des ouvrages de philosophie morale et politi-
que, à travers les notions voisines de liberté, de subjectivité, de dignité, de bonheur, de propriété etc. On
se borne à la citation des contributions qui sont très proches de la problématique de la relation entre la
volonté et la raison comme celle de Harry F
RANKFURT
, « Freedom of the will and the concept of a person »,
in Gary W
ATSON
(ed.),
Free Will
, Oxford, 1982, Joseph R
AZ
,
Engaging Reason
, Oxford, 1999, Joel F
EIN-
BERG
,
Harm to self
, Oxford, 1986, Gerald D
WORKIN
,
The Theory and Practice of autonomy
, Cambridge,
1991, Jeremy W
ALDRON
, « A right to do wrong »,
Ethics
, vol. 92, octobre 1981, pp. 21-39, Michela M
AR-
ZANO
,
Je consens, donc je suis
, P.U.F., 2006, Alain R
ENAUT
,
L’ère de l’individu
, Gallimard, 1989, Jerome
B. S
CHNEEWIND
,
L’invention de l’autonomie. Une historie de la philosophie morale moderne
, Nrf
Essais, Gallimard, Paris, 2001. Voir aussi les deux tomes de la revue
Droits
, consacrés à
La liberté du
consentement
, PUF, Paris, 2009, Marlène J
OUAN
, Sandra L
AUGIER
(dir.),
Comment penser l’autonomie,
Entre compétences et dépendances
, PUF, Paris, 2009, Corinne P
ELLUCHON
,
L’autonomie brisée, bioéthi-
que et philosophie
, PUF, Léviathan, Paris, 2009.
5
Christian A
TIAS
,
Épistémologie juridique
, P.U.F, Paris, 1985. On a opté alors pour une approche qui
associe le droit à la philosophie politique, voire à la philosophie morale en raison de la complexité et de la
pluridisciplinarité de notre objet de recherche. En effet, cette étude entend une jonction entre la philoso-
phie du droit et le droit positif, car il nous semble que la majorité des études sur la liberté ou l’autonomie
de la personne se limite soit à une sorte d’encyclopédisme du droit positif, soit à une pure abstraction.
Pour être plus précis, il n’y a aucune étude de droit public traitant la question de l’autonomie comme
autonomie de la volonté.
A fortiori
, les ouvrages récents sur l’autonomie de la personne, comme celui de
Michela Marzano, portent sur la valeur philosophique de la question sans tenir sérieusement compte de
ses effets juridiques. C’est alors également une critique de la connaissance juridique qu’on essaie d’adres-
ser par l’acceptation implicite de la faiblesse de la science pure du droit d’expliquer les phénomènes nor-
matifs, notamment quand il s’agit des concepts comme l’autonomie qui doivent beaucoup à l’abstraction
philosophique. En outre, le renouveau de la philosophie politique et l’intérêt croissant actuel pour la théo-
rie du droit semblent conforter l’opportunité de notre tentative.
Last but not least
, c’est l’ambigüité du
libéralisme français qui a fait naître en nous l’envie d’aborder un sujet qui touche le cœur de tout régime
libéral. Depuis la période (post)-révolutionnaire, le libéralisme français semble moins préoccupé de la
liberté individuelle que de la libéralisation des institutions. Il nous paraît que cette sorte d’« holisme »
régit même aujourd’hui le domaine sensible de l’autonomie individuelle.
la définition philosophique de la notion, de Véronique RANOUIL, L’autonomie de la volonté : naissance et
évolution d’un concept, préf. de Jean-Philippe LÉVY, travaux et recherches de l’Université de droit d’éco-
nomie et de sciences sociales de Paris, Paris II, P.U.F., 1980. Voir aussi les articles de Jean-Claude VENEZIA,
« Réflexions sur le rôle de la volonté en droit administratif », in Mélanges Pierre Cayser, Tome II,
P.U.A.M., 1979, p. 383 et s. et plus récemment Sébastien SAUNIER, « L’autonomie de la volonté en droit
administratif français : une mise au point », R.F.D.A., 2007, p. 609 et s. La transposition contemporaine du
principe civiliste en droit administratif confirme l’émancipation de l’administration de la loi au nom de son
efficacité, notamment dans le domaine sensible de contrats publics. Traditionnellement méfiante envers le
principe d’autonomie de volonté, la doctrine administrative prend davantage en compte la « privatisation »
du droit public, où les personnes morales publiques peuvent désormais contracter à la façon des personnes
privées. D’autres études récentes ont traité le consentement et le rôle de la volonté dans le droit pénal. Voir
Xavier PIN, Le consentement en matière pénale, thèse, préf. Patrick MAISTRE DU CHAMBON, Bibliothèque
de science criminelle, L.G.D.J., tome 36, Paris, 2002 et Frédéric ARCHER, Le consentement en droit pénal
de la vie humaine, préf. Alain PROTHAIS, L’Harmattan, Sciences Criminelles, Paris, 2003.
DBB.12116 Page 15 Mercredi, 23. janvier 2013 11:56 11

16
L’AUTONOMIE DE LA PERSONNE EN DROIT PUBLIC FRANÇAIS
des évolutions du droit positif, sans leur explication ou leur compréhension,
ou, de surcroît, leur attribution à une abstraction, bâtie pourtant sur des
données juridiques–théoriques, susceptible de proposer, comme on le pré-
tend actuellement, avec la modestie évidente que la grandeur du sujet nous
impose, une théorie et une portée normative de l’autonomie.
Mais, avant tout, c’est le contexte contemporain qui nous a inspiré le souf-
fle scientifique de traiter la question de l’autonomie, car il s’y est montré
extrêmement favorable, sans, cependant, anticiper ici la réussite de notre
recherche, autant philosophiquement que juridiquement. Pour dire les cho-
ses plus clairement, le concept d’autonomie constitue à la fois une valeur
indépassable et une illusion incontestable de la philosophie et du droit,
comme s’il s’agissait d’une béquille absolument nécessaire pour la constitu-
tion de l’individu en particulier et l’exaltation de l’humanité en général dont,
pourtant, la teneur et la solidité sont gravement controversées. L’ambiguïté
du concept traverse, en effet, à la fois la philosophie politique, morale et juri-
dique et affecte irrémédiablement, comme il semble être toujours le cas, la
pratique du droit. La question de l’autonomie transcende également la théo-
rie du sens et de la connaissance, la problématique hautement sophistiquée
et absolument disputée de la possibilité de la fondation ultime de la vérité 6,
elle interroge le bonheur et le malheur du libéralisme 7, la restauration
6 Ce que Jean-Marc FERRY annonce dès la première ligne de son ouvrage sur la Philosophie de la
communication, tome 1, « De l’antinomie de la vérité à la fondation ultime de la raison », Cerf, Humani-
tés, Paris, 1994. « … Celui-ci rencontre à nouveau les questions ontologiques du fondement : fondement
de la raison et de la vérité. Et – comme toujours – la réflexion se heurte à la structure d’antinomies, à tra-
vers l’opposition de l’universalisme et du contextualisme, de l’absolutisme et du relativisme. Comment ces
questions fondamentales se posent-elles, aujourd’hui, en fonction des “changements de paradigme” inter-
venus dans la philosophie après les fameux “tournants” herméneutique, de la linguistique et de la
pragmatique ? Depuis Descartes, Kant, Hegel, la philosophie moderne et contemporaine semble avoir tra-
versé, malgré ses retours, les différentes figures de la subjectivité et de l’intersubjectivité : figures de la
conscience, puis de la réflexion, puis du langage, et à présent, de la communication. La philosophie fran-
çaise ne peut impunément ignorer ce trajet. Elle ne saurait, sans se provincialiser, se désintéresser du
nouveau paradigme : celui de la raison communicationnelle, à l’horizon duquel les traditionnelles ques-
tions de la philosophie, de l’antinomie de la vérité à la fondation ultime de la raison, s’actualisent sous le
signe d’une pensée qui se veut “postmétaphysique” », pp. 7-8.
7 Les critiques de la modernité confondent largement le libéralisme avec l’individualisme, l’autonomie
volontariste des modernes avec l’indépendance immorale et la fermeture égoïste sur soi-même, alors que
les modernes avaient précisément dénoncé le même individualisme, propre à l’état de nature, pour instau-
rer la nécessaire mais non obligatoire relation avec autrui. La philosophie étatiste et légicentriste de la
modernité n’est pas du tout porteuse de barbarie, mais de civilisation. Selon Pierre Zaoui, « non le libéra-
lisme n’est pas une sauvagerie, ne sont sauvages que les gouvernants et les idéologues qui prétendent
connaître d’avance le sens que chacun devrait donner à sa liberté (recherche de son intérêt égoïste ou
recherche désintéressée du bien commun) […] D’autre part, elle (la politique libérale) a besoin d’un
interlocuteur assez puissant pour à la fois structurer l’adresse de ses revendications et de ses dénoncia-
tions, et l’imposer, au moins minimalement, à l’ensemble des acteurs du marché. Autrement dit, elle a
doublement besoin de l’État, et d’un État à la fois assez fort pour la relayer et pas trop fort, ni trop mal-
veillant, pour ne pas l’écraser », voir idem, Le libéralisme est-il une sauvagerie ?, Bayard, Paris, 2007,
pp. 69-70. Marcel Gauchet affirme que l’individu et l’État ont été réciproquement nés car « le règne singu-
lier de l’individu suppose l’empire général de l’État », in idem, La démocratie contre elle-même, Galli-
mard, Tel, Paris, 2002, notamment pp. 15-21.
DBB.12116 Page 16 Mercredi, 23. janvier 2013 11:56 11

INTRODUCTION 17
contemporaine de la raison pratique 8 et la définition de la volonté par les
sciences cognitives, la sauvegarde d’une subjectivité dépassée, sans oublier
qu’elle entraîne forcément la narration du récit non moins exempt de vives
polémiques du déterminisme, de la nécessité et de la liberté, en renvoyant,
en outre, sans doute, aux querelles théologico-politiques du libre arbitre et
de l’origine divine de nos sociétés sécularisées. Bref, elle semble recentrer
dans son cœur sémantique la thématique épineuse (anthropologique, politi-
que, morale et juridique) de la condition et de la nature humaines 9.
À dire vrai, le chercheur ne peut qu’éprouver, simultanément, le plus
grand désespoir et le plus vif enthousiasme à l’égard d’un sujet qui suscite
d’une part le sentiment de la banalité – car il s’agit d’une question énormé-
ment traitée – et d’autre part de l’exceptionnalité scientifique, intellec-
tuellement, aussi, existentielle – étant donné qu’il constitue un objet
d’étude quasiment insoluble et inépuisable qui touche profondément
l’esprit en tant que tel et excite non seulement le Moi du chercheur, en
remettant même en cause la liberté épistémologique et méthodologique de
son travail, mais également le Moi individuel tout court. En effet, comme ce
Moi n’est nullement auto-fondé ou auto-posé, pour reprendre ici la termino-
logie de la critique incompréhensiblement adressée contre le sujet de la
modernité, et notamment contre le cogito cartésien qui fâche même
aujourd’hui 10 – il faudrait l’avouer, le choix du sujet, libre ou nécessaire,
important peu dans la perspective moderne 11, nous fut im-posé par l’air
du temps. C’est alors notre consentement au déterminisme inévitable et
notre liberté de signifier le même… déterminisme, notre droit herméneuti-
que de nous… inventer comme chercheur qui nous a persuadé de poursui-
vre cette recherche, qualifiée désormais comme un choix libre, une
décision qui s’insère dans notre mode de vie personnel et dont on se porte
responsable, une validation de la liberté que… la servitude de la prépara-
tion d’une thèse implique.
8 Proposée notamment par Alain RENAUT, L’ère de l’individu, op. cit. C’est à travers la découverte de
l’intersubjectivité chez Fichte, après les interprétations d’Alexis Philonenko, que les néo-kantiens fran-
çais, malgré leur virage heideggérien initial, entendent fonder une raison pratique contemporaine où la
raison de la Troisième Critique, c’est-à-dire la raison réservée par Kant lui-même à l’esthétique, permet-
trait d’écarter la naïveté et la simplicité de l’ancrage du sujet sur l’autoposition et la spontanéité. Voir
notamment Luc FERRY,Alain RENAUT, Système et critique : essais sur la critique de la raison dans la
philosophie contemporaine, Ousia, 1984.
9 Pour une présentation synthétique de la question très délicate de la liberté de la volonté voir Joëlle
PROUST, La nature de la volonté, Folio, Essais, Gallimard, Paris, 2005.
10 Selon l’expression pertinente de Slavoj Zizek qui souligne également que le cogito cartésien n’est
pas le fondement d’une conception transparente du soi. Voir idem, Le sujet qui fâche, Flammarion,
Paris, 2007.
11 Car, on le sait bien, depuis Hobbes, un choix nécessaire demeure, malgré tout, un choix libre.
DBB.12116 Page 17 Mercredi, 23. janvier 2013 11:56 11
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
1
/
35
100%