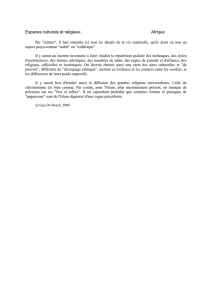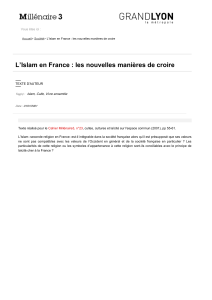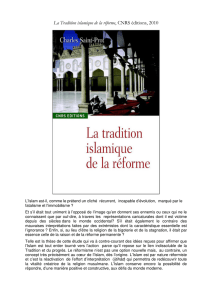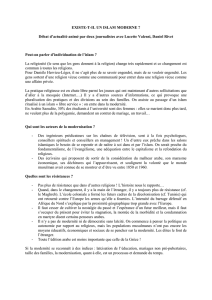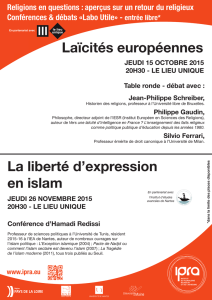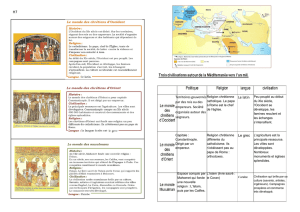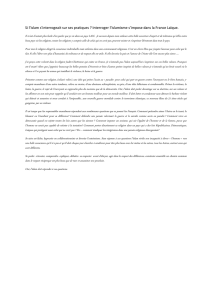Islam, avec ou sans majuscule

Écrire islam ou Islam ?
Cet article est un résumé de mon intervention sur le thème « Étude critique de la
définition et de l’étymologie du terme Islam dans les dictionnaires français du XVIIe
à aujourd’hui », lors de la Séance de la SELEFA du Jeudi 10 décembre 2015. Un
texte proche est parue sous le titre « Islam avec ou sans majuscule » sur le site
ORIENT XXI (voir http://orientxxi.info/documents/mots-d-islam/islam-avec-ou-
sans-majuscule). Cette question sera traitée plus en détail dans les Actes de la
Journée d’études L’islam dans les dictionnaires français (XVIIe-XXIe siècles
organisée le vendredi 9 octobre 2015 en hommage à Abdelwahab Meddeb (1946-
2014), par François Gaudin, Moulay-Badreddine Jaouik et Mahfoud Mahtout à The
University of Chicago Center, 6, rue Thomas Mann, Paris XIIIe.
Mise en ligne Le 20/01/2016
L’édition française a pris l’habitude d’écrire avec une initiale minuscule les noms de religions
et de courants de pensée ainsi que leurs adeptes, mais avec une initiale majuscule ceux des
peuples et de pays ainsi que leurs membres ou habitants. Selon les règles typographiques
généralement suivies par l’Imprimerie nationale, l’Université et la Presse, on écrit donc islam
‒ avec un /i/ minuscule ‒, lorsqu’il s’agit de la religion islamique, mais on use de la graphie
Islam ‒ avec un /I/ majuscule ‒ quand il s’agit des sociétés.
En quoi le français se distingue des langues de nos voisins
Laissons de côté la langue arabe qui ne connaît pas l’usage des majuscules. Parmi les langues
d’Europe, l’allemande n’éclaire pas davantage notre propos dans la mesure où tous les
substantifs reçoivent une initiale majuscule. Mais considérons d’abord la langue anglaise :
celle-ci confère aux religions et courants de pensée comme peuples et aux pays, une initiale
majuscule, comme cela était la règle en français au XVIIIe siècle, comme on peut s’en rendre
compte dans la 4ème édition du Dictionnaire de l’Académie, datée de 1798. Quant aux langues
latines, l’italien et l’espagnol, au rebours de l’usage dans celle de nos voisins d’outre-Manche,
tous ces noms sont employés avec une initiale minuscule.
Les règles suivies par nos voisins sont probablement trop simples pour le français qui a pris
une attitude intermédiaire entre ces deux extrêmes. Il réserve une minuscule aux religions et,
partant, aux courants de pensée, tandis que peuples et pays sont honorés d’une majuscule. Car
il s’agit bien d’une valorisation, celle de l’élévation au pinacle de la Nation aux dépends la
Religion, en conséquence des charges des Lumières et de la Révolution contre l’Église. Le
résultat est que, dès le début du XIXe siècle, tous les dictionnaires entérinent cet usage, par
ailleurs confirmé en 1835 par la 5ème édition du Dictionnaire de l’Académie. Ce qui n’exclut
nullement que l’on puisse dans la littérature assortir les noms de courants de pensée d’une
majuscule comme élément intentionnel. Cela prouve bien que, mise en la balance avec la
minuscule initiale, la majuscule possède une connotation méliorative et, partant, la minuscule
une connotation péjorative. Nous avons bien là un choix idéologique.
Les problèmes posés par la graphie canonique
Selon l’orthographe que l’on peut qualifier de canonique, parce que sacralisée en quelque sorte
par l’Imprimerie nationale, on devrait écrire christianisme et chrétienté avec un /c/ minuscule.

Seulement, dès qu’il s’agit de l’Islam, la règle s’est heurtée à une incertitude grave du fait que
ce mot est employé indistinctement, pour la religion de Mohammed et les sociétés qui s’en
prévalent, comme le pendant commun des deux termes précédents dans la religion du Christ et
dans les sociétés où celle-ci est influente, même si le rapport religion/société est fort différente
dans les unes et les autres. La langue française tente d’échapper à cette indétermination, source
de confusion, en écrivant Islam ‒ avec /I/ majuscule donc ‒, quand il s’agit de l’« Ensemble des
peuples qui professent », le Trésor de Langue Française dixit, étendant même cet emploi à « la
civilisation qui les caractérise ». L’intention est louable mais n’est pas sans effet pervers, en
provoquant des perturbations dans l’imaginaire collectif français. Si l’on met en effet en rapport
chrétienté et Islam en termes de populations ou de civilisations, comment distinguer que, hors
du cercle des initiés, l’usage de la majuscule est, dans le second de ces termes, une simple
convention graphique et non une intention appréciative de la notion ? Peut-on imaginer qu’un
Chrétien ou un Athée, fiers de cette identité, voire un simple partisan de la laïcité, et ce quelles
que soient ses croyances personnelles, ne ressent-pas quelque trouble en appliquant cette règle
qui fait involontairement deux poids deux mesures entre sociétés et civilisations et, partant, du
fait que les mots sont les mots avec leurs inévitables connotations, les religions dont elles
tiennent leur qualificatif ?
Autre problème, et de taille. Les dictionnaires donnent volontiers l’illustration suivante de la
graphie canonique : on parlera d’un « juif pratiquant » quand il s’agit d’une « personne qui
pratique la religion judaïque », mais une « personne appartenant à la communauté israélite, au
peuple juif » s’écrit « avec une majuscule en ce sens ». Ainsi s’exprime l’édition du Larousse
sur la toile. Qui peut trouver claire cette distinction entre juif comme « pratiquant » et Juif
comme membre de la « communauté israélite » ? N’y a-t-il pas là une manifestation de
l’ethnicisation du judaïsme ? Plus généralement, est-on vraiment obligé de trancher la
question de savoir si les Juifs sont un peuple ou une religion, débat qui traverse nos sociétés
sur les deux rives de la Méditerranée, chaque fois que l’on fait référence au judaïsme ? Il en
est de même des Arméniens et aujourd’hui des Assyriens en Irak. Mettre une majuscule dans
tous les cas n’est pas une conduite habile pour esquiver ces questions, mais peut-on les
trancher d’un artifice orthographique qui dispense de l’affronter dans leur complexité
historique et anthropologique ? Et faut-il, comme le fait le Larousse, écrire musulmans avec
une minuscule pour parler, selon ses propres termes, des « fidèles de l’islam », sans nommer
autrement les membres de ce que, par symétrie avec la « communauté israélite », il devrait
nommer « communauté musulmane ». Et cela au moment où l’ethnicisation des populations
de cultures musulmanes, arabes ou subsahariennes, gagne du terrain dans la société française
sous l’étiquette de musulmans sans majuscule.
Les règles appliquées dans le Dossier L’Islam défantasmé
Pour résumer, l’orthographe est une convention. Or toute convention a un sens, et présente
des avantages et des inconvénients. En l’occurrence la graphie canonique trébuche sur des
réalités que l’on ne peut résoudre par un biais orthographique. Ces raisons suffiraient à refuser
la discrimination que font les tenants d’une graphie orthodoxe entre les mots concernant
religions, sociétés et civilisations, et personne n’a à se soumettre à aucune graphie officielle.
Les objectifs mêmes de ce Dossier L’Islam défantasmé autorise à user de la liberté d’intention
propre à la littérature et à l’essai politique, sociologique ou anthropologique. Celle-ci nous
invite, sans déroger au beau principe de la laïcité, à faire, à l’instar de nos voisins
britanniques, un même usage de la majuscule pour les notions de religions, de sociétés et de
civilisations, avec pour résultat heureux de maintenir la balance égale entre elles sur l’agora
d’un monde contemporain où les problèmes ne peuvent se réduire à ceux qui ont poussé il y a

deux siècles la société française à figer leur approche dans ses règles orthographiques qui
présentent aujourd’hui de graves inconvénients.
Je prends par conséquent le parti suivant :
1. Les noms de religions et d’écoles de pensée ainsi que leurs adeptes, aussi bien que les noms
de pays et leurs habitants seront écrits avec une initiale majuscule ;
2. Il sera veillé dans le même temps, et pour compenser les effets négatifs éventuels de cette
disposition, à ce que le terme Islam soit réservé à la religion islamique, ou alors que soit
précisé en tout état de cause s’il s’agit de la religion, des pays, peuples et sociétés où cette
religion est prépondérante, ou encore de la civilisation dont ils se réclament.
Roland Laffitte
1
/
3
100%