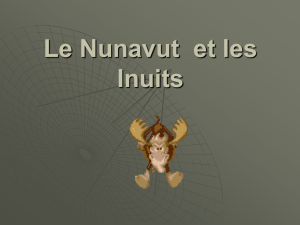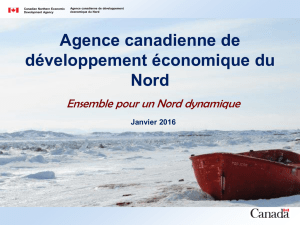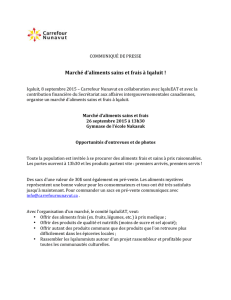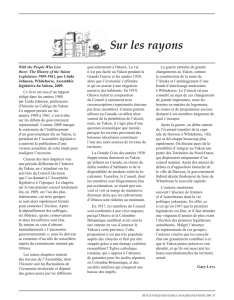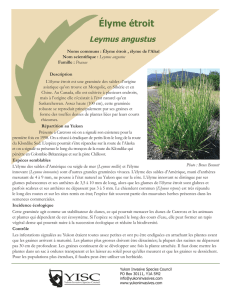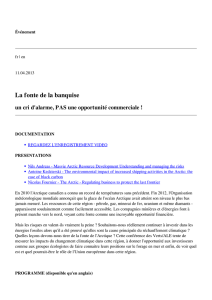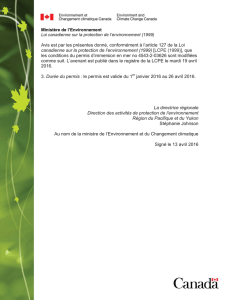Le développement économique dans le Nord canadien : Progrès

1
Le développement économique dans le Nord canadien :
Progrès récents et lacunes résiduelles en matière de connaissances et
perspectives de recherches
Commission canadienne des affaires polaires
Le 31 mars 2014
Table des matières
• Résumé et méthodologie
• Aperçu
• Progrès récents
• Lacunes en matière de connaissances et perspectives de recherches
• Bibliographie
Résumé et méthodologie
Nous donnons ici les gains, les lacunes et les perspectives de recherches liées au
développement économique et découlant du travail de la Commission canadienne des
affaires polaires dans l’exécution de son mandat, qui est de recenser l’état des
connaissances sur les régions polaires et d’en faire rapport aux Canadiens ainsi qu’à la
collectivité internationale. Le présent résumé porte sur le Nord canadien, à savoir le Yukon,
les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, le Nunavik et le Nunatsiavut, pendant la période
de sept ans commençant par l’Année polaire internationale (API) de 2007. Les observations
qui suivent sont structurées selon les thèmes suivants : progrès récents, lacunes en matière
de connaissances et perspectives de recherches. Elles reposent sur des entrevues
semi-structurées auprès de spécialistes et praticiens de la recherche nordique, validées et
complétées par un examen par les pairs et la documentation parallèle. Les progrès récents
et les lacunes de connaissances sur la navigation commerciale dans l’Arctique, la recherche
et le sauvetage et la gestion des déversements de pétrole sont abordés dans le résumé sur
les communications, l’infrastructure et les systèmes de transport.

2
Aperçu
L’économie du Nord repose en grande partie sur le gouvernement, les mines, le
pétrole et le gaz, la pêche commerciale, la chasse au phoque, le tourisme, le
piégeage, les arts et l’artisanat (y compris les films et les documents sonores), ainsi
que sur le secteur tertiaire et l’économie traditionnelle de subsistance, soit la chasse,
la pêche et la cueillette (Stapleton, 2008; Lutra Associates, 2011; Invest Yukon,
2013). D’autres secteurs ont également leur importance, par exemple la foresterie et
l’agriculture au Yukon et dans les T.N.-O., l’innovation et la technologie au Yukon,
notamment la mise au point et à l’essai de technologies pour les climats froids et la
recherche environnementale (Invest Yukon, 2013). Les perspectives de mise en
valeur des ressources minières, pétrolières et gazières du Nord ont augmenté et la
tendance se maintiendra, le réchauffement climatique facilitant l’accès à ces régions
(Huntington, 2007; Fenge, 2009; Prowse et Furgal, 2009; Administration régionale
Kativik et Société Makivik, 2010). De plus, en raison du réchauffement climatique,
les stocks de poisson de l’Arctique seront probablement plus faciles d’accès
(Stapleton, 2008).
Voyant que l’économie nordique est dépendante de la mise en valeur des ressources
(Southcott et Irlbacher-Fox, 2009) et constatant donc la vulnérabilité du Nord à ce
cycle d’expansion et de récession, les divers acteurs ont déployé des efforts pour
relever la diversification par le développement ou le renforcement d’autres
secteurs, par exemple le tourisme et le secteur du savoir (Fenge, 2009; Bolton et
coll., 2011; Pearce et coll., 2011; Goldhar et coll., 2012; Développement économique
et Transports – Gouvernement du Nunavut, 2013).
Dans nombre de régions du Nord, on a mis en place ou on prépare des stratégies
liées touchant le développement économique. La publication Pathways to Prosperity:
An Economic Growth Perspective 2005 to 2025 offre une vision à long terme de
l’économie du Yukon (Développement économique Yukon, 2006). Le gouvernement
des T.N.-O. a publié en 2013 son Economic Opportunities Strategy pour appuyer et
favoriser la diversification de l’économie des Territoires du Nord-Ouest (Chambre
de commerce des T.N.-O. et coll., 2013). Le gouvernement des T.N.-O. s’est doté d’un
certain nombre de stratégies axées sur divers secteurs, notamment Tourism 2015 et
NWT Arts Strategy (Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, s.d.). Le Nunavut
a commencé à revoir et à renouveler sa Stratégie de développement économique du
Nunavut, qui est arrivée à échéance en 2013 (Sivummut Economic Development
Strategy Group, 2003; Forum économique du Nunavut, 2012). Le gouvernement du
Nunavut a publié Tunngasaiji: A Tourism Strategy for Nunavummiut en 2013
(Développement économique et Transports – Gouvernement du Nunavut, 2013). La
Société Makivik et l’Administration régionale Kativik ont publié Plan Nunavik: Past,
Present and Future en 2010 comme élément de base des pourparlers relatifs au
développement de la région du Nunavik avec le gouvernement du Québec, en ce qui
a trait à ses projets de développement pour le Nord du Québec, le Nord pour tous. Le
processus Parnasimautik est en cours dans la région du Nunavik et vise à élaborer
une vision globale du développement durable tirant parti du Plan Nunavik
(Administration régionale Kativik et Société Makivik, 2010; Société Makivik, 2013;
Rodon et Schott, 2013; Gouvernement du Québec, 2013). Le gouvernement de

3
Terre-Neuve-et-Labrador a publié en 2007 un plan quinquennal intitulé Northern
Strategic Plan for Labrador, décrivant ses projets d’amélioration de la santé et du
mieux-être des gens du Labrador par une amélioration de l’infrastructure, de la
programmation sociale et la promotion du développement économique
(Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 2007). L’initiative SakKijânginnatuk
Nunalik est actuellement en cours au Nunatsiavut et vise à relever la durabilité des
collectivités. La Phase I de l’initiative comportait des ateliers communautaires afin
de comprendre les priorités, les défis et les points de vue des collectivités, le tout
documenté dans le rapport SakKijânginnatuk Nunalik: Understanding opportunities
and challenges for sustainable communities in Nunatsiavut, Learning from the coast.
Dans la Phase II, on étudiera des approches et solutions innovatrices et holistiques
en réponse aux constatations de la Phase I (Goldhar et coll., 2012).
Il y a, dans nombre de collectivités, un manque d’infrastructure concernant les
réseaux de transport, les communications et l’infrastructure municipale et combler
ces lacunes permettrait ou faciliterait la croissance et le développement
économiques (Forum des ministres responsables du développement du Nord,
2010a). À l’extérieur des grandes collectivités, les services financiers sont absents et
pas toujours adéquats pour appuyer le financement des entreprises. S’assurer d’une
énergie abordable et fiable ayant des incidences environnementales limitées est
également un défi (Une Vision Nordique, 2011). De la sorte, le coût de la vie est
élevé, tout comme le coût des affaires, et peut empêcher l’établissement de tarifs
concurrentiels. Malgré la création d’un certain nombre de sociétés de
développement fonctionnelles et le succès de diverses entreprises autochtones, le
développement économique et les perspectives d’emploi sont déficientes ou
absentes dans nombre de régions du Nord, notamment les collectivités plus petites
et isolées qui n’ont pas la capacité, l’infrastructure ou les économies d’échelle pour
appuyer les secteurs des affaires (Walker, 2009; Goldhar et coll., 2012).
Le changement climatique, notamment le réchauffement ou la fonte du pergélisol, et
les événements météorologiques extrêmes et plus fréquents, ont des incidences à
toutes les étapes des projets de mise en valeur des ressources, notamment la
planification, l’exploitation et la fermeture/la remise en état (Huntington, 2007;
Prowse et al, 2009; Pearce et coll., 2011). L’identification, l’évaluation et la gestion
des projets de mise en valeur des ressources et des activités connexes et
l’atténuation des effets négatifs sur la santé, la société, la culture et l’environnement
ont également leur importance en ce qui a trait au développement durable
(Huntington 2007 et 2009; Voutier et coll., 2008; Rodon et Schott, 2013), ce qui peut
poser des obstacles compte tenu des répercussions d’un climat en transformation
rapide et de la dépendance des gens du Nord de cet environnement pour leur
subsistance (Manley-Casimir, 2011).
Même si les perspectives de développement économique, par exemple l’extraction
des ressources, sont souvent pointées comme étant des occasions de création
d’emploi pour les gens du Nord et d’amélioration de leurs conditions
socioéconomiques (Huntington, 2007), ce n’est pas toujours le cas dans la pratique,
si les gens du Nord ne sont pas bien placés pour tirer parti de ces possibilités. Il
existe des problèmes socioéconomiques (p. ex. traumatisme intergénérationnel,
santé mentale, toxicomanies, etc.) et des inégalités entre les Autochtones et les

4
autres citoyens du Nord et entre les personnes vivant dans des collectivités
éloignées ou plus isolées et celles qui sont installées dans des grands centres et dans
le Sud du Canada. Ces difficultés peuvent se répercuter sur les résultats scolaires, de
sorte qu’il peut être plus difficile d’obtenir et de conserver un emploi (Centre
national de collaboration pour la santé autochtone, 2010; Inuit Tapiriit Kanatami,
2011; Sisco et coll., 2012; Davison et Hawe, 2012b).
Dans nombre de régions du Nord, les niveaux de scolarité sont faibles et la
main-d’œuvre qualifiée est rare (Fenge, 2009; Howard et coll., 2012). Pour obtenir
un emploi salarié, les gens du Nord doivent souvent quitter leur famille et leur
collectivité (Stapleton, 2008). De plus, les citoyens du Nord n’ont peut-être pas le
niveau de scolarité nécessaire pour gravir les échelons dans une entreprise et il n’y a
pas toujours de soutien adéquat et culturellement approprié (p. ex., programmes de
formation en inuktitut). Nombre de travailleurs sont recrutés dans le Sud du Canada
et font la navette par avion (Fenge, 2009).
La gouvernance est un aspect clé du développement économique. Parvenir à un
équilibre entre les intérêts, les besoins et les points de vue divergents et parfois
conflictuels des multiples intervenants peut devenir difficile, lorsqu’il s’agit
d’appuyer et de promouvoir le développement économique tout en veillant au
mieux-être et à la participation de la collectivité, à sa sécurité culturelle et à la
durabilité de l’environnement (Centre pour le Nord, 2011b).
Progrès récents, lacunes en matière de connaissances et perspectives de recherches
État de l’économie et politiques et initiatives de développement économique
Progrès récents
Dans The Economy of the North 2008, on donne un aperçu de l’économie de
l’Arctique circumpolaire, notamment les conditions économiques et sociales, une
analyse comparative des économies de l’Arctique au niveau macro-économique, un
survol de la production future de pétrole, ainsi que de l’interdépendance des
économies de subsistance et de marché (Glomsrod et Aslaksen [ed.], 2009).
Le Conference Board du Canada publie pour les territoires un document biannuel
intitulé Territorial Outlook, qui comporte une analyse économique et financière, la
production par industrie, les conditions du marché du travail et des données
démographiques. Il est accessible sur le site Web de la bibliothèque électronique du
Conference Board du Canada (Centre pour le Nord, 2011a).
Les rapports Yukon Economic Outlook 2012, Yukon Economic Review 2012 et
Northwest Territories Economic Review and Outlook offrent un survol actuel et des
projections des économies du Yukon et des T.N.-O. par secteur (Industrie, Tourisme
et Investissement, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2011;
Développement économique Yukon, 2012a et b). Le rapport de 2010 Perspectives
Économiques du Nunavut, commandé par le Forum économique du Nunavut, précise
les résultats des investissements consentis dans le capital générateur de richesse et
se concentre sur le rendement économique, social et environnemental en tant
qu’indicateurs de progrès (Forum économique du Nunavut, 2010).

5
En plus de baliser les obstacles et les perspectives en matière de mise en valeur du
potentiel économique des territoires du Canada, un rapport publié en 2012 par la
Chambre de commerce du Canada offre également un certain nombre de
recommandations pour l’immédiat et à court et à long terme à l’intention du
gouvernement fédéral, par exemple la création d’incitatifs (par exemple crédits
d’impôt) pour favoriser le mentorat et la collaboration entre les petites et grandes
entreprises (Chambre de commerce du Canada, 2012).
Des chercheurs ont mené une évaluation empirique des répercussions économiques
(sur le revenu local, le PIB et l’emploi) des dépenses publiques pour la recherche au
Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut de 2000 à 2009 à même
des programmes subventionnés par le fédéral et expressément mandatés pour
appuyer la recherche. L’auteur a constaté qu’à son sommet, l’effet sur le PIB
territorial a été de 0,04 %, le revenu de 0,09 %, et l’emploi, de 0,11 %. En utilisant
comme exemple Old Crow, au Yukon, l’auteur a établi que les collectivités où a lieu la
recherche sur le terrain peuvent en retirer des avantages financiers et intangibles
importants au niveau de la collectivité (Natcher, 2013).
En s’intéressant aux collectivités autochtones des provinces des Prairies, Olfert et
Natcher ont analysé les conditions sous lesquelles les politiques de développement
économique très localisées (en plus d’être localisées sur des personnes) peuvent
être avantageuses pour aider à régler des problèmes économiques locaux. Tout en
rappelant que les politiques propres à un lieu doivent être utilisées de façon
sélective, les conditions sous lesquelles ces politiques peuvent être justifiées
comprennent les collectivités concentrées [TRADUCTION] « dans des régions rurales et
éloignées où les populations autochtones en croissance rapide ont de faibles
niveaux de scolarité et dépendent fortement des transferts gouvernementaux » et
celles qui sont autochtones, rappelant que ces dernières tendent à disposer d’un
capital social existant ou potentiel sur lequel pourraient se fonder les politiques
locales. Les auteurs ont étudié un réseau local de la collectivité de Postville, au
Nunatsiavut, afin d’illustrer l’étendue des types de relations qui sous-tendent le
capital social. Compte tenu de la complexité et des différences de capital social entre
collectivités, les auteurs insistent sur la nécessité d’adapter au contexte particulier
les politiques de développement économique localisées en impliquant les gens de
l’endroit dans leur conception (Olfert et Natcher, 2013).
Fugmann s’est penché sur les répercussions locales et régionales du développement
par la base constaté au Nunavik et au Nunatsiavut, et dû en partie au règlement des
ententes régionales, qui ont permis la mise en place d’une base économique. Tout en
rappelant certains des défis que ces régions affrontent, par exemple le changement
climatique et les coûts élevés des affaires, l’auteur rappelle que le développement
par la base, notamment les coopératives, les investissements directs, les sociétés
subsidiaires et les co-entreprises de sociétés ethniques, ainsi que les ententes sur les
avantages de la mise en valeur des ressource ont créé des emplois et des revenus
pour les résidants et abouti à la création de petites entreprises locales. L’industrie
touristique du Nunavik et du Nunatsiavut a été mentionnée comme exemples
remarquables d’industries ayant profité du développement par la base (Fugmann,
2011).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
1
/
62
100%