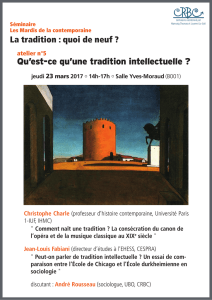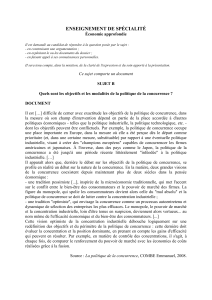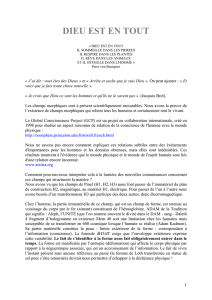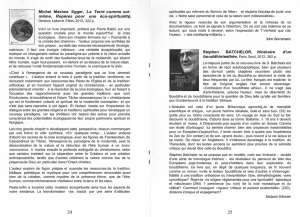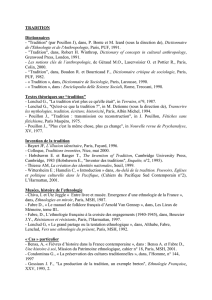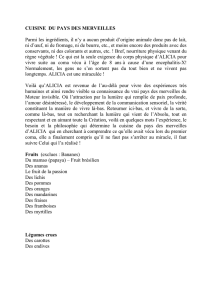qu`est-ce qu`une tradition scientifique

Mohamad K. SALHAB
QU’EST-CE QU’UNE TRADITION SCIENTIFIQUE ?
La vie humaine a un aspect cumulatif qui est inhérent à la notion même
de culture et de tradition. Le passé porte le présent, le modifie et le
tempère, à certains égards le limite et l’enrichit. On comprend mieux
Shakespeare pour avoir lu Chaucer. Mais en pratique, il est
rare qu’on connaisse déjà le plus ancien en abordant le plus récent…
Le caractère cumulatif de la science est tout différent et beaucoup plus
fondamental… Les solides fondements de faits et les lois qui les écrivent
subsistent tout au long de l’histoire de la science ; ils sont affinés et
adaptés à de nouveaux contextes, jamais négligés ou rejetés.
J. R.
Oppenheimer1
Avons-nous à nous expliquer sur le choix du thème proposé
pour notre intervention dans le cadre de ce prestigieux colloque qui
porte sur La transmission des connaissances, des savoirs et des
cultures ? Disons que la tradition constitue un mode habituel,
coutumier, traditionnel allons-nous préciser, de cette transmission. A
priori, celle de la science ne devrait pas échapper à cette règle.
On pourra certes objecter que l’expression de tradition
scientifique offre quelque chose de paradoxal, adjoignant deux termes
qui tirent manifestement chacun de son côté. En effet, la science est
souvent présentée comme étant avant tout moderne, sa démarche
consistant à remplacer les connaissances anciennes par de nouvelles,
fondées sur le renouvellement de la critique et l’actualisation de
1 J. R. Oppenheimer : La science et le bon sens, Idées Gallimard, 1955, p. 35-36. Je
remercie Jean-Claude Beaune de m’avoir signalé ce texte d’Oppenheimer.

l’observation et de la preuve. Alors que la tradition renvoie aux
croyances et aux modèles de comportement reçus du passé, dont
l’antériorité accrédite d’ailleurs l’idée de sa permanence et de son
autorité. Peut-on dès lors légitimement avoir recours à la notion de
tradition scientifique et en faire l’objet d’une étude de la science ou de
son histoire ?
Quoique nécessaire, le recours à la terminologie demeure ici
d’un secours limité. En effet, le terme de tradition fait partie du langage
commun et demeure polysémique. Le Larousse en retient quatre
significations. Deux d’entre elles renvoient à l’idée de transmission – de
doctrines, de légendes, de coutumes ou bien encore de manières d’agir
ou de penser, transmises de génération en génération -, les deux autres,
se rapportant à l’usage juridique de remise matérielle d’un bien meuble,
enfin au domaine de la foi transmise.
L’idée de permanence connotée par le terme de tradition se
retrouve dans la théorie aristotélicienne de la science, soumise
cependant à la condition de la démonstration. C’est ainsi qu’Aristote
considère que «si les prémisses dont procède le syllogisme sont
universelles, la conclusion d’une telle démonstration, c’est-à-dire de la
démonstration prise au sens absolu, est nécessairement aussi
éternelle. »2 Cette affirmation conduit Aristote à déterminer le champ
de la science, accordant d’ailleurs à la théorie de la démonstration et du
syllogisme, c’est-à-dire à la logique, une place essentielle dans la
formation de la science.
A partir de Descartes et de Galilée, c’est plutôt la catégorie de
la rupture qui va prévaloir dans la science moderne. Face à l’autorité de
la tradition, Descartes appelle à faire table rase du passé. A son tour,
Galilée rejette la physique aristotélicienne, qualitative et trop proche
du témoignage du sens commun, afin de fonder la physique moderne
sur la base de l’observation et de la quantification. Canguilhem résume
cette tendance de la science moderne en observant, à propos de la
2 Aristote : Seconds Analytiques, I, 8, 75 b 20, trad. Tricot, Vrin, 1987, p. 47.

chimie de Lavoisier, que «c’est tout un de fonder un nouveau savoir et
de le couper de tout rapport avec ce qui en occupait abusivement la
place. »3
Pourtant d’éminents épistémologues et historiens de la science
actuelle continuent à se référer à la tradition scientifique, notion qui
paraît, en effet, indispensable à une histoire des sciences. Ainsi, tout en
accordant qu’il serait actuellement absurde de se limiter à l’étude de la
science dans ses livres d’histoire, Sarton consacre une somme
impressionnante d’informations afin d’établir cette histoire, dressant,
au passage, la succession des penseurs qui ont assuré sa tradition et sa
continuité4. De son côté, Popper - pourtant très réticent à l’idée d’une
science cumulative, considérant que la science progresse non en
accumulant les connaissances transmises mais en les révolutionnant -
accorde à la tradition un rôle important dans la marche du progrès
scientifique5.
Proposant des éléments Pour une théorie rationnelle de la
tradition6, Popper identifie la science avec la tradition rationaliste et
critique. Prenant acte du « pouvoir irrationnel » accordé aux idées et
aux modèles de comportement transmis par la tradition, Popper ramène
ce pouvoir au besoin de sécurité de tout un chacun devant l’inconnu,
besoin qui peut se transformer en une intolérance face au changement.
La tradition agit ainsi à la manière d’une théorie qui tend à établir des
prévisions permettant à l’individu de s’orienter dans son
environnement naturel et social, lui conférant par là la certitude et la
3 Georges Canguilhem : Etudes d’histoire et de philosophie des sciences, septième
édition augmentée, Vrin 2002, p. 13.
4 George Sarton, dont l’œuvre a connu un important retentissement à partir des
années 1950 et a fait l’objet de l’attention d’éminents universitaires égyptiens qui
lui ont consacré une traduction arabe, sous le titre : Histoire de la science, en
plusieurs volumes, Le Caire, 1991. Le volume 4 porte sur La science et la
civilisation hellénistique aux trois derniers siècles avant Jésus-Christ. Nos
remarques sont tirées de ce volume, p. 108 et p. 97.
5 Karl Popper : Conjectures et Réfutations (1963), texte anglais, Rutledge Classics,
2002, p. 173-174.
6 C’est le titre du chapitre 4 de l’ouvrage cité de Popper, p. 161.

sécurité. Or, la grande nouveauté de la tradition scientifique est de
soumettre les idées reçues – croyances, mythes ou théories -, à la
discussion rationnelle et à la critique. C’est cette tradition critique que
nous voyons se développer en Grèce au VI° siècle avant J.-C., comme
le montre l’exemple de l’école de Thalès7.
Popper considère en outre qu’il est de bonne méthode de partir
des questions actuellement débattues, de la situation du problème du
jour, qui résument à leur manière les acquis de la tradition, afin de
progresser dans la recherche8. Il rejette la position facile des
rationalistes qui condamnent les idées traditionnelles au motif de la
table rase qui préparerait, selon eux, le penser par soi-même. Non
seulement, aux yeux de Popper, une telle démarche n’est pas
productive – car nul ne peut aller plus loin dans le domaine de la
connaissance qu’en s’appuyant sur des résultats précédents -, elle
présente en outre le grave inconvénient de ne point s’interroger sur ses
propres fondements, de laisser ainsi en dehors de l’examen rationnel et
critique sa propre conception de la connaissance – sur deux points
notamment : la conception du déterminisme et celle du rôle de
l’observation dans la pensée scientifique.
On peut certes reprocher à Popper une vision optimiste, ne
retenant de la science qu’un aspect qui amplifie le rôle de la critique et
de la libre discussion, au détriment des déterminations et des enjeux
politiques et sociaux9. Il faut dire que, contrairement aux attentes de
Popper, la tradition pythagoricienne de la science grecque par exemple
était déjà fondée sur le culte du secret et de la vénération du maître, non
sur la critique et la libre discussion. De son côté, la science normale
selon Kuhn se constitue en échappant à la discussion générale, pour
devenir une affaire de spécialistes ayant leurs propres langages et
pratiques10. Cependant, il faut préciser que l’apport de l’épistémologie
7 K. Popper : La connaissance objective (1979), Aubier, 1991, p. 507.
8 K. Popper : Conjectures et Réfutations, p. 172-173.
9 Renée Bouveresse : Karl Popper ou le rationalisme critique, Vrin, 1998, p. 181.
10 T. S. Kuhn : La structure des révolutions scientifiques (1970), Flammarion,
1983, p. 278.

poppérienne demeure, aux yeux de son propre auteur, comme nous
l’avons noté, une contribution pour une théorie générale.
Une théorie générale de la tradition scientifique aura
probablement à se pencher sur trois types d’interrogations ou de
questions : Comment connaissons-nous une tradition ? Pour quel(s)
motif(s) accordons-nous notre croyance à une tradition ? Quelle valeur
pouvons-nous attribuer à une connaissance reçue par tradition ?
Ces trois questions relèvent d’ordres manifestement
hétérogènes, puisque la première interrogation est proprement
historique ou historiographique, alors que la deuxième se rapporte à
l’investigation psychologique, la troisième relevant enfin de
l’interrogation épistémologique et de la théorie de la connaissance.
Nous nous limitons, dans ce travail, à expliciter certains aspects de ces
questions. Nous reviendrons ainsi sur les rapports qui relient la
tradition historique et la tradition scientifique, avant d’étudier
l’exemple de la tradition expérimentale.
I – TRADITION HISTORIQUE ET TRADITION
SCIENTIFIQUE : ROUAGES ET DYNAMIQUES DE LA
TRANSMISSION
Afin de dégager les éléments de la tradition scientifique, nous
partons de l’interrogation suivante : parmi les traditions historiques,
existe-t-il un ou des critères qui permettent de distinguer une tradition
scientifique ? Que faut-il d’ailleurs entendre par tradition historique ?
Pour répondre à ces questions, nous proposons de partir d’un texte de
Cicéron.
Dans un passage remarquable, Cicéron invite à donner crédit à
la légende romuléenne en ces termes : «Accordons cela à la tradition,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%