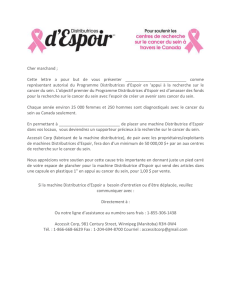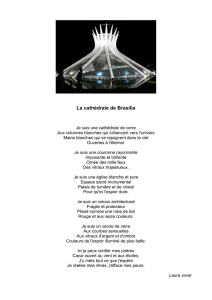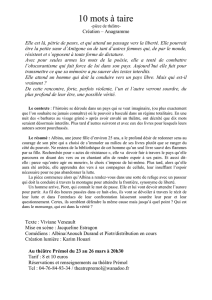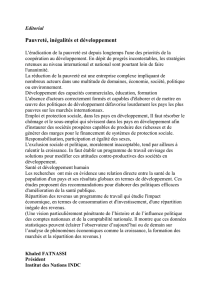Microsoft Word - article, Le doute de l`\\351conomie social

Le doute de l'économie sociale au Québec
par Jean Panet-Raymond
Depuis la Marche des femmes contre la pauvreté «Du pain et des roses» en juin 1995, il n'est pas
un jour où l'on n'entend pas parler d'économie sociale dans les médias, les bureaux du
gouvernement et les organismes communautaires.
Faut-il s'en réjouir ou faut-il s'en inquiéter? «Entre l'espoir et le doute»...1 Voilà l'état des rapports
entre le secteur communautaire et le secteur public autour de l'enjeu incontournable de l'économie
sociale. Cet article tente de situer les enjeux et défis de ces difficiles rapports.
L'économie sociale : une définition
La Marche des femmes a soulevé beaucoup d'espoir tant par l'ampleur de sa mobilisation que par
l'intérêt suscité à travers le Québec. Mais cette marche a surtout ouvert la porte à des discussions
avec le Gouvernement du Québec pour regarder l'état de la pauvreté des femmes et de l'ensemble
de la population. Une des revendications était que le gouvernement mette en place un programme
d'infrastructures sociales représentant un investissement économique important, visant à créer des
emplois accessibles dès maintenant aux femmes. Il en résultat la création d'un comité d'orientation
et de concertation sur l'économie sociale qui publia un rapport en mai 1996, Entre l'espoir et le
doute, qui définit les fondements et caractéristiques de l'économie sociale : «...les entreprises qui
tentent de concilier impératifs économiques et impératifs sociaux et qui reposent essentiellement sur
les dynamismes des collectivités locales et donc sur une participation des citoyens ou encore des
travailleurs directement impliqués» (p. 22). La création à l'été 1996 d'un fonds de développement de
$225 millions sur cinq ans a apporté un souffle d'espoir à des initiatives d'économie sociale. En fait
ce fonds émanait en partie du Sommet socio-économique de mars 1996, qui était surtout axé sur
l'assainissement des finances publiques et la création d'emplois sous la pression des milieux
d'affaires. La décision principale de ce sommet fut le plan pour arriver au «déficit zéro» en l'an 2000.
Mais lorsque le mouvement des femmes demanda ce que l'on ferait pour lutter contre la pauvreté,
rien ne fut décidé.
Les représentants des secteurs communautaire, public et privé ainsi que du mouvement syndical ont
décidé au Sommet socio-économique d'octobre 1996 de mettre l'économie sociale au coeur du
nouveau contrat social entre l'État et la société civile. Le mouvement communautaire et le
mouvement des femmes avaient largement mobilisé leurs membres pour présenter une autre
revendication qui émanait de la marche des femmes: l'objectif «appauvrissement zéro». Le Sommet
n'a pas adopté cet objectif, qui demeure le cri de ralliement du mouvement communautaire et des
femmes (d'ailleurs leurs réprésentants ont quitté le sommet devant le refus d'en faire un objectif).
Cependant, on a créé un fonds de lutte à la pauvreté de 240 millions de dollars, sur trois ans,
financé par une taxe spéciale.
Les initiatives du gouvernement pour soutenir l'emploi et favoriser le partenariat
Déjà en 1991, la loi sur les services de santé et les services sociaux reconnaissait les organismes
communautaires comme partenaires, au moment où l'on décentralisait le système et réduisait les
dépenses de l'État. Le «virage communautaire» était doublé du «virage ambulatoire» en 19942.
Donc le secteur communautaire était déjà mis à contribution pour combler les services réduits de
l'État. Avec le virage de l'économie sociale on ajoute un élément important qui est le souci de
création d'emplois et de rentabilité économique. Parallèlement aux politiques de santé et services
sociaux, la politique de sécurité du revenu, toujours à l'étude au printemps 1998, annonce des
pressions de plus en plus fortes pour insérer dans des programmes de formation («learnfare») et de
travail («workfare»)3 les personnes dépendant de l'assistance sociale. En effet la formation
professionnelle est maintenant intégrée à la sécurité du revenu et la ministre voit dans la création
des Centres locaux pour l'emploi (CLE) et des Centres locaux de développement (CLD) une
occasion de mieux coordonner la création d'emplois et le soutien à l'entreprise (CLD), l'insertion
socio-professionnelle, l'employabilité (CLE) et la sécurité du revenu. De plus le ministère de
l'éducation et de la famille a créé des centres de la petite enfance et favorisé la création de garderies
grâce au fonds de développement de l'économie sociale. La politique familiale pousse aussi les
mères monoparentales qui vivent de la sécurité du revenu à utiliser les garderies, afin d'être

disponibles à des programmes de réinsertion professionnelle.
La décentralisation et le partenariat
Une autre politique influence les rapports entre l'État et le secteur communautaire. La création, en
mars 1998, du ministère des régions consacre la «Politique de soutien au développement local et
régional» de 1997. Elle s'ajoute aux politiques des services de santé et services sociaux, de
l'éducation et de l'emploi et de la solidarité (sécurité du revenu) qui ont toutes déconcentré les lieux
de gestion sinon les lieux de décision «pour rapprocher les services du gouvernement plus près de
la population et ainsi responsabiliser les communautés locales» comme aime le dire le ministre
d'État aux régions, Guy Chevrette. Toutes ces structures se veulent partenariales et intersectorielles
: elles font donc appel aux secteurs public, communautaire, privé et syndical qui doivent travailler
ensemble pour définir des priorités de développement social et de création d'emploi.
Le récent «Forum sur le développement social» (26-28 avril 1998), qui réunissait près de 700
représentants des régions et communautés locales de tous les secteurs, a montré les difficultés de
laisser plus de pouvoir aux communautés locales et la fragilité des collaborations. On a retrouvé des
tensions à l'intérieur même du mouvement communautaire entre une tradition plus militante axée sur
le changement social et une tradition plus modérée axée sur les services. Mais les tensions les plus
importantes sont entre les visions plus sociales et les visions plus économistes où l'emploi devient
presque une obsession.
Les enjeux des rapports entre l'État et les secteurs communautaires, et les
craintes du mouvement communautaire
Un des risques importants entourant l'économie sociale et le mouvement communautaire est de
créer une pression exagérée de la rentabilité économique et de limiter les entreprises à un modèle
marchand, qui dévalorise les entreprises qui ont besoin de soutien financier public, notamment parce
qu'elles mènent des activités «non rentables» sur le plan commercial. On pense au soutien à
domicile aux personnes les plus démunies et les activités d'éducation populaire.
Un deuxième risque est de faire de l'économie sociale un programme d'employabilité. Le comité
d'orientation et de concertation sur l'économie sociale a bien précisé qu'il ne faut pas confondre les
deux, mais la tentation du gouvernement d'utiliser l'économie sociale pour «placer» les personnes
assistées sociales est grande. De fait, plusieurs organismes communautaires financent leurs
activités avec des projets d'employabilité. Cela crée des problèmes de continuité et exige de gros
efforts de formation qui alourdissent la tâche des groupes.
Un autre risque est de créer des ghettos d'emplois pour les femmes, dans la mesure où la plupart
des projets d'économie sociale sont associés au secteur des services aux personnes (aide à
domicile, garderie, services d'aide scolaire, etc).
Un quatrième risque est que le secteur communautaire devienne un sous-traitant de l'État, qui le
perçoit comme un moyen d'offrir des services à moindre coût tout en insérant des personnes exclues
du marché du travail. On pense surtout aux services de soins à domicile et aux services d'insertion
en emploi des jeunes.
Enfin ces questions soulèvent l'enjeu de la reconnaissance de l'action communautaire comme
expression libre de la créativité des communautés, axée sur le changement social et le
développement du pouvoir des personnes et des collectivités pour contrôler leur destinée. Cela
soulève aussi l'importance du financement des organismes communautaires, qui ne veulent pas être
financés uniquement pour des services définis comme prioritaires par le gouvernement, mais pour
l'expression libre et démocratique de l'initiative de la société civile.
C'est à travers tous ces enjeux que l'espoir se transforme en doute. On peut dire oui au partenariat
avec l'État... mais pas à n'importe quelle condition. Ce «oui...mais» se manifeste par une
«coopération conflictuelle» de la part du mouvement communautaire.
Il faut remarquer que plusieurs ministères, tels ceux de la famille, l'éducation, la justice,
l'environnement, la culture, l'immigration, ont aussi développé des programmes de financement du

secteur communautaire qui balisent de plus en plus son action pour qu'elle corresponde à des
objectifs gouvernementaux de rentabilité économique et d'insertion socio-professionnelle. Les règles
du jeu du financement visent à intégrer des objectifs économiques afin d'atteindre un budget
équilibré («déficit zéro») tout en luttant contre la pauvreté («appauvrissement zéro»), par la création
d'emplois durables qui vont insérer les prestataires de la sécurité du revenu.
Ces objectifs se retrouvent aussi au coeur des débats autour de la politique au printemps 1998 sur la
reconnaissance et le financement de l'action communautaire. Cette politique créerait des normes
québécoises tout en laissant beaucoup de marge aux régions pour financer le secteur
communautaire.
Conclusion : le doute va-t-il étouffer l'espoir?
C'est dans ce contexte en pleine ébullition que le contrat social entre l'État et la société civile est en
train de se modifier. D'un rôle important de monopole étatique, on évolue vers un modèle mixte
(«welfare mix») qui fait beaucoup appel au secteur communautaire dont la mission sociale doit
désormais se doubler d'une mission économique pour conserver un financement public. Le
mouvement communautaire évolue donc entre l'espoir d'un «État solidaire» partenarial et ouvert aux
initiatives locales et le doute d'une dictature des contraintes économiques imposées par l'État, lui-
même soumis aux impératifs de la mondialisation.
Textes recommandés pour en savoir plus dans ce domaine :
1. Comité d'orientation et de concertation sur l'économie sociale, Entre l'espoir et le doute,
Québec, 1996; William A. Ninacs, The Social Economy in Québec, Victoriaville, Québec,
1998.
2. Mayer, R. et Panet-Raymond, J. (1997), «The History of Community Development in
Québec», in M. Clague and B. Wharf (eds), Community Organizing: Canadian
Experiences, Toronto : Oxford University Press, 1997.
3. Panet-Raymond, J., «Les nouveaux rapports entre l'État et les organismes
communautaires à l'ombre de la loi 120», Nouvelles pratiques sociales, 1994, vol. 7, no 1,
pp. 79-93.
4. Panet-Raymond, J. et al, «L'économie sociale a ses limites», La Presse, 17 mai 1996, p.
B3. >
5. Conseil québécois de développement social, L'économie sociale. Dérision ou panacée,
janvier 1997.
6. Panet-Raymond, J., Shragge, E., «Le 'workfare' : solution miracle ou injustice?», La
Presse, 29 janvier 1997, p. B3. >
7. Conseil québécois de développement social, Le «workfare» pour quoi faire?, mars 1997.
Jean Panet-Raymond est directeur de l'École de service social de l'Université de Montréal et
membre du Conseil québécois de développement social. Il a beaucoup écrit sur les tendances du
développement social au Québec.
Canadian Council on Social Development, 190 O'Connor Street, Suite 100, Ottawa, Ontario, K2P 2R3
1
/
3
100%



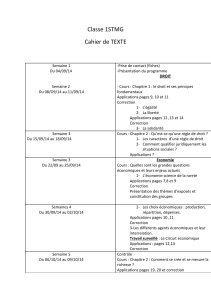


![1 ] Annexe B TABLEAU SYNOPTIQUE DES ACTIVITÉS ET DES](http://s1.studylibfr.com/store/data/005094897_1-6d21cd6d86ca715b638f45a5fe9e6c84-300x300.png)