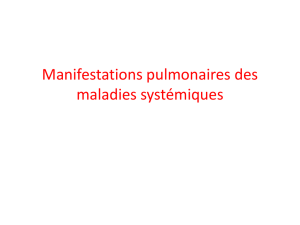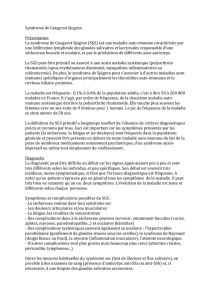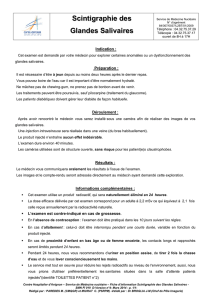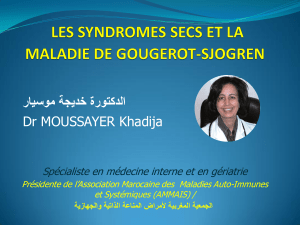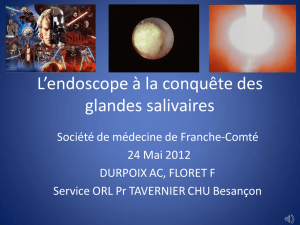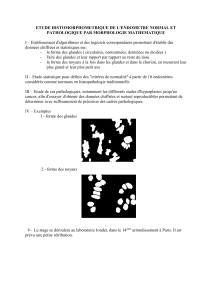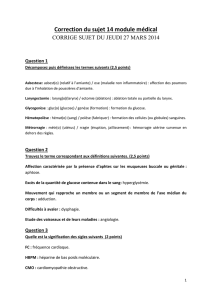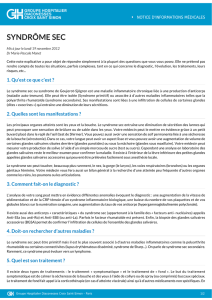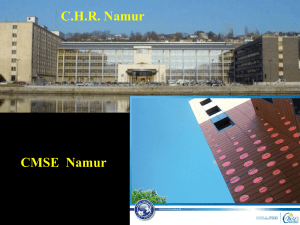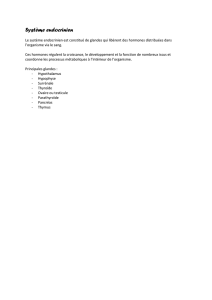hyposialie et asialie : le cas particulier du syndrome de gougerot

1
UNIVERSITÉ DE NANTES
UNITÉ DE FORMATION ET DE RECHERCHE D’ODONTOLOGIE
Année : 2011 N : 056
HYPOSIALIE ET ASIALIE : LE CAS
PARTICULIER DU SYNDROME DE
GOUGEROT-SJÖGREN
THÈSE POUR LE DIPLOME D’ÉTAT DE
DOCTEUR EN CHIRURGIE DENTAIRE
Présentée
et soutenue publiquement par
KOÏTA Ibrim-David
Né le 14 Janvier 1983
Le12 Janvier 2012 devant le jury ci-dessous
Président Monsieur le Professeur Philippe LESCLOUS
Assesseur Monsieur le Professeur émérite Wolf BOHNE
Assesseur Monsieur le Professeur Mohamed HAMIDOU
Directeur de thèse : Monsieur le Docteur Saïd KIMAKHE
Co-directeur de thèse : Monsieur le Docteur Christophe MARGOTTIN

2
SOMMAIRE
INTRODUCTION : ............................................................................. 5
I.
Généralités : ................................................................................... 6
1.
Les glandes salivaires : ............................................................ 6
1.1.
Les glandes principales : ...................................................................... 6
1.1.1. La glande parotide : ....................................................................................... 6
1.1.2. La glande sub-mandibulaire ou sous-maxillaire : .......................................... 7
1.1.3. La glande sublinguale : ................................................................................. 9
1.2.
Les glandes accessoires : ................................................................... 10
2.
La salive : ................................................................................ 10
2.1.
Composition : ..................................................................................... 10
2.1.1. Constituants inorganiques : .......................................................................... 11
2.1.2. Constituants organiques : ............................................................................. 11
2.2.
Les rôles de la salive : ........................................................................ 11
2.2.1. La lubrification et la protection : .................................................................. 11
2.2.2. Digestion et goût : ........................................................................................ 12
2.2.3. Réparation tissulaire : ................................................................................... 12
2.2.4. Pouvoir tampon et clairance : ....................................................................... 12
2.2.5. Reminéralisation : ........................................................................................ 12
2.2.6. Défense et immunité : .................................................................................. 13
2.3.
Sécrétion : ........................................................................................... 13
II.
Hyposialie et asialie : ................................................................ 14
1.
Définition : .............................................................................. 14
2.
Différentes origines d’hyposialie :........................................ 14
2.1.
Hyposialie d’origine médicamenteuse : ............................................. 14
2.2.
Radiothérapie de la tête et du cou : .................................................... 15
2.3.
Les autres causes d’hyposialie : ........................................................ 16
2.4.
Le syndrome de Gougerot-Sjögren : .................................................. 17

3
3.
Répercussions bucco-dentaires : .......................................... 17
3.1.
Conséquences fonctionnelles : ........................................................... 17
3.2.
Manifestations dentaires et muqueuses : ............................................ 18
III.
Le Syndrome de Gougerot-Sjögren (SGS) : .......................... 20
1.
Définition : .............................................................................. 20
2.
Symptômes : ........................................................................... 21
2.1.
Les manifestations glandulaires : ....................................................... 21
2.1.1. Les symptômes oculaires : ........................................................................... 21
2.1.2. Les Symptômes buccaux : ............................................................................ 22
2.1.3. Autres manifestations glandulaires : ............................................................ 25
2.2.
Les manifestations systémiques : ....................................................... 25
2.2.1. La fatigue : .................................................................................................. 25
2.2.2. L’appareil locomoteur : ............................................................................... 25
2.2.3. Les manifestations pulmonaires : ................................................................. 26
2.2.4. Les manifestations digestives : ..................................................................... 26
2.2.5. Les manifestations rénales : ........................................................................ 26
2.2.6. Les manifestations neurologiques : ............................................................. 26
2.2.7. Les manifestations dermatologiques : ......................................................... 27
2.2.8. Les manifestations cardiaques : ................................................................... 28
2.2.9. Les manifestations endocriniennes : ............................................................ 28
2.2.10. Organomégalies : ......................................................................................... 28
2.3.
Signes biologiques : .......................................................................... 28
2.4.
Complications : .................................................................................. 28
3.
Diagnostic : ............................................................................. 29
3.1.
Les critères de classification : ............................................................ 30
3.2.
Les nouveaux outils d’évaluation : .................................................... 33
3.3.
Le diagnostic différentiel : ................................................................ 34
3.4.
L’étiologie : ........................................................................................ 35
3.5.
Diagnostic positif : ............................................................................. 35

4
4.
Prévention et traitement : ..................................................... 38
4.1.
Traitement symptomatique : .............................................................. 38
4.1.1. Traitement de la xérophtalmie : ................................................................... 38
4.1.2. Traitements des autres sécheresses : ........................................................... 38
4.1.3. Prévention et traitement de la xérostomie : .................................................. 39
4.1.3.1. Substitut salivaire et stimulation : ............................................................ 39
4.1.3.2. Prévention et suivi buccodentaire : .......................................................... 39
4.1.3.3. Les sialogogues : ...................................................................................... 41
4.2.
Les traitements de fond : .................................................................... 42
DISCUSSION : ................................................................................... 44
CONCLUSION : ................................................................................ 47
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES : ...................................... 49

5
INTRODUCTION :
L’hyposialie et l’asialie sont dues à une déficience du fonctionnement des glandes salivaires
principales et accessoires et se traduisent par une diminution du débit ou une absence de
salive. Ce sont des dysfonctionnements qui peuvent être rencontrées tout particulièrement
chez les personnes âgées.
La xérostomie qui en résulte est particulièrement invalidante et a des conséquences majeures
sur les tissus et les structures de la cavité buccale. Elle entraîne des troubles fonctionnels
notamment au niveau de la mastication, de la déglutition, de la phonation et de la digestion.
La xérostomie favorise également l’apparition de lésions de la muqueuse buccale, augmente
le risque de caries et de candidoses ; diminuant fréquemment la qualité de vie des patients.
Les origines de l’hyposialie sont nombreuses, dominées par les causes médicamenteuses et le
syndrome de Gougerot-Sjögren (SGS). Il s’agit de la 2
e
maladie auto-immune en fréquence et
en incidence derrière la polyarthrite rhumatoïde. Le SGS atteint préférentiellement les
femmes d’un âge moyen (le ratio femme/homme est de 9/1), toutefois la maladie peut
apparaître à n’importe quel âge. Sa prévalence est comprise entre 0,1% et 0,5% de la
population. Le chirurgien-dentiste doit pouvoir identifier certains symptômes du SGS et
adresser son patient aux spécialistes qui pourront établir le diagnostic. Le praticien devra
ensuite assurer la prise en charge des répercussions du syndrome sur la cavité buccale.
Nous ferons tout d’abord quelques rappels anatomiques et physiologiques sur les glandes
salivaires et la salive. Nous verrons ensuite les différents types d’hyposialies et leurs
répercussions bucco-dentaires. Nous nous intéresserons enfin au syndrome de Gougerot-
Sjögren dont nous verrons les manifestations (glandulaire et extraglandulaire), le diagnostic et
les traitements.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
1
/
55
100%