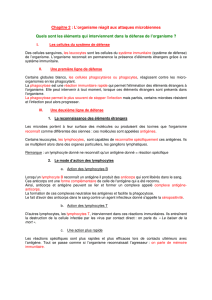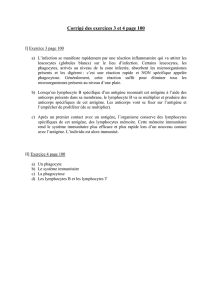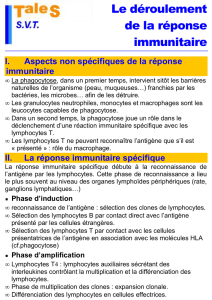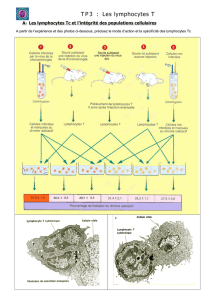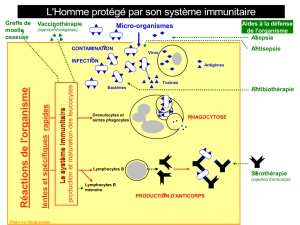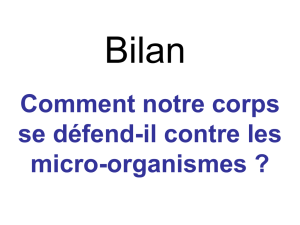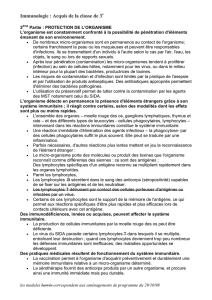Le déroulement de la réponse immunitaire

Le déroulement
de la réponse
immunitaire
I. Aspects non spécifiques de la réponse
immunitaire
• La phagocytose, dans un premier temps, intervient sitôt les barrières
naturelles de l’organisme (peau, muqueuses…) franchies par les
bactéries, les microbes… afin de les détruire.
• Les granulocytes neutrophiles, monocytes et macrophages sont les
leucocytes capables de phagocytose.
• Dans un second temps, la phagocytose joue un rôle dans le
déclenchement d’une réaction immunitaire spécifique avec les
lymphocytes T.
• Les lymphocytes T ne peuvent reconnaître l’antigène que s’il est
« présenté » : rôle du macrophage.
II. La réponse immunitaire spécifique
La réponse immunitaire spécifique débute à la reconnaissance de
l’antigène par les lymphocytes. Cette phase de reconnaissance a lieu
le plus souvent au niveau des organes lymphoïdes périphériques (rate,
ganglions lymphatiques…)
!"
Phase d’induction
• reconnaissance de l’antigène : sélection des clones de lymphocytes.
• Sélection des lymphocytes B par contact direct avec l’antigène
présenté par les cellules étrangères.
• Sélection des lymphocytes T par contact avec les cellules
présentatrices de l’antigène en association avec les molécules HLA
(cf.phagocytose)
!"
Phase d’amplification
• Lymphocytes T4 : lymphocytes auxiliaires sécrétant des
interleukines contrôlant la multiplication et la différenciation des
lymphocytes.
• Phase de multiplication des clones : expansion clonale.
• Différenciation des lymphocytes en cellules effectrices.
• Lymphocytes B : plasmocytes sécrétant des anticorps circulants (≠
lymphocytes T)
• Lymphocytes T8 : lymphocytes cytotoxiques.
• Cas du SIDA : destruction des LT4 par le virus VIH et des LT8
cytotoxiques! immunodéficience du fait de la diminution des LT4 ;
développement de diverses maladies opportunistes et des LB.
!"
Phase effectrice :
• Réponse à médiation humorale :
− Sécrétion d’anticorps circulants spécifiques du déterminant
antigénique (non-soi).
− Association anticorps/antigène (complexe immun) aboutissant à la
neutralisation de l’antigène.
− Destruction de l’antigène par phagocytose ou avec l’aide du
complément.
• Réponse à médiation cellulaire :
− S’exerçant sur les cellules infectées par des virus, bactéries…
− Reconnaissance de l’association déterminant antigénique/HLA par
les lymphocytes cytotoxiques (LTC).
− Lyse de la cellule-cible grâce à une enzyme : la perforine.
!"
La phagocytose
!"
Mémorisation de la réponse immunitaire spécifique :
• En cas d’une 2ème contact avec le même antigène : réponse plus
rapide, plus efficace.
• Au cours de la phase d’amplification lors de la 1ère rencontre,
certains lymphocytes dits « mémoires » stoppent leur différenciation.
• Ces cellules « mémoires » sont capables de réagir rapidement lors
d’un second contact avec l’agent étranger.
• La vaccination en est le meilleur exemple.
Memopage.com SA © / 2006 / Auteur : Alexandra Vivier des Vallons
1
/
1
100%