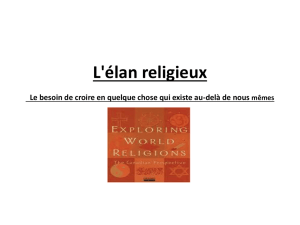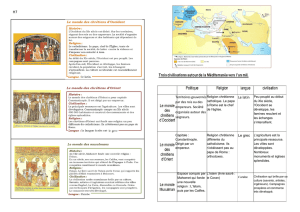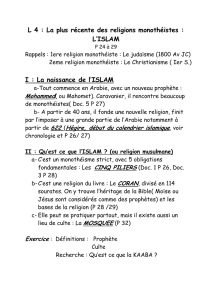La religion est-elle l`ennemi de la science

La religion est-elle l’ennemi de la science ?
La question de savoir si la religion est l’ennemi de la science n’appelle pas une
réponse assertorique à laquelle nous devrions répondre par l’affirmative ou par la négative. En
effet cette question appelle que l’on s’interroge sur la relation qu’entretient la science,
comprise au moins dans son intention comme visée de l’apodicticité, avec la religion, sachant
déjà que cette relation est marquée dans l’histoire d’une teinte particulièrement polémique.
Cette polémique tient au fait que la religion est comparable à la science dans son intention en
tant qu’elle vise, elle aussi, un absolu. C’est pourquoi, puisque l’objet même de la polémique
se rapporte à l’apodictique, à ce qui est absolument vrai, la réponse ne saurait dire que l’une
ou l’autre de ces activités séculaires de l’esprit échapperait totalement à son intention.
Toutefois il y a bien une polémique. En effet la démarche scientifique est obligée de
s’assumer comme critique alors que la démarche religieuse semble ne jamais pouvoir éviter la
forme du dogmatisme. Ces deux activités de l’esprit humain ont néanmoins un contenu
commun, à savoir la raison. Et ce contenu peut s’étendre, d’ailleurs, bien au-delà de la seule
conception monothéiste de la religion, puisqu’il n’est pas de société ni de communauté qui ne
se réfère au divin, sous quelque forme que ce soit, sans se rapporter à l’idée d’un principe
suprême. De Brahman à Zeus au nirvana bouddhiste, partout il semble se pouvoir trouver une
idée de l’unité et de la cohérence absolue. Or de même la science ne saurait se concevoir sans
la recherche de cette même unité et tout porte à croire qu’en définitive elle ne serait que la
recherche d’une fondation de ce qui a toujours déjà été cru par l’esprit.
Il apparaît clairement que la science ne peut pas évoluer sur le même plan que la
religion car cette dernière suit une nécessité morale et politique, tandis que la première semble
systématiquement devoir s’en émanciper autant que faire se peut au nom d’une nécessité
objective et justement amorale. La religion n’a pas tant pour vocation de découvrir la vérité
que de la révéler à ceux qui en ont besoin pour organiser leur vie. De ce fait ce qu’elle établit
n’a pas pour vocation de se renverser mais, bien au contraire, de se conserver. Ce
conservatisme inhérent se retrouve dans la pensée médiévale qui semble ne pouvoir jamais
sortir de l’apologétique qu’à partir du moment où elle se constitue authentiquement comme
une démarche scientifique, trompant ses censeurs sur son véritable propos, comme cela
semble avoir été le cas à partir du 17ème siècle où l’on remarquera qu’il était préférable de
donner à des considérations sur les conditions de possibilité de la science la forme d’une
considération apologétique. Mais il faut admettre néanmoins qu’il n’y aurait pas non plus de
science sans une éducation morale à son objet qu’est l’universalité. Aussi il semble que la
religion puisse être une propédeutique de la science. Toutefois il reste vrai que l’une et l’autre
diffèrent par leur forme, bien qu’elles se retrouvent du point de vue du contenu et de
l’intention. Il reste que la science semble plus glorieuse que la religion dans sa démarche.
Mais il est aussi important de savoir si la démarche scientifique ne connaît pas, elle aussi, un
écueil par rapport à son contenu et à son intention : n’est-il pas possible qu’au regard de sa
gloire la science ne finisse par s’enfermer elle aussi dans un dogmatisme ? Il nous
appartiendra d’analyser les conditions réelles de cette gloire du connaitre scientifique et ses
limites ; limites au travers desquelles nous devrions entrevoir le moyen pour l’esprit de
rejoindre en vérité et sans plus aucune polémique ce qu’il avait déjà posé à l’aube de son
apparition sur terre sans le saisir, toutefois, dans sa vérité, à savoir l’absolu qu’il renie dans la
pensée positiviste et auquel il échappe dans le rationalisme apologétique.
* *
*

Nous pouvons sans trop de difficulté dire qu’il n’est pas de communauté humaine qui
ne s’éduque autrement que par une référence à l’absolu, à ce qui détient et explique toutes les
déterminations de la vie. Ainsi selon Eric Weil dans Philosophie Morale la religion est un
phénomène humain universel, corollaire de toute morale comprise comme système de règles
prescrites pour une communauté. Par conséquent le fait religieux témoigne d’une certaine
nature humaine, nature profondément métaphysique où l’ordre n’a de sens qu’en vertu de
principes régulateurs qui confèrent à l’homme son autonomie par rapport à la nature, sa
liberté. Donc, avant toute autre affirmation nous pouvons dire que la religion est une activité
de l’esprit libre, un révélateur de sa liberté à orienter sa vie non selon les lois de la nature mais
selon la description et l’explication qu’il a choisi, d’une culture à l’autre, d’en faire.
Mais paradoxalement la morale religieuse, la morale de l’absolu, ouvre du même coup
la voie à sa propre critique et à son propre refus puisqu’à l’issue de la confrontation des
communautés morales l’individu moral, selon Weil, ne peut faire l’économie d’une
interrogation sur l’universel véritable. La rencontre de l’autre introduit une rupture dans le
dogmatisme moral d’une communauté, puisque cette rencontre révèle à la communauté la
singularité de ses valeurs qui se revendiquaient comme universelles. Dès lors la religion, clé
de voûte du système de règles qu’est la morale concrète, commence dès cet instant à devenir
l’ennemi de la démarche critique de celui qui recherche l’universel ailleurs que dans ses
prescriptions ; toutefois il reste que ceci n’aurait pu avoir lieu si la religion n’avait pas élevé
cet individu à l’idée de l’absolu.
Dès cet instant il appert que le désir d’interroger la réalité pour elle-même, au-delà des
traditions, au-delà du conformisme, certes indispensable au départ mais désormais insuffisant
à s’assurer la conviction des hommes, de tous les hommes, se pose en ennemi de la religion et
vivra la religion comme un redoutable ennemi. Ennemi d’autant plus redoutable que c’est
toujours dans une tension intérieure violente que le sujet critique ressentira sa critique et sa
recherche de vérité. Tension qui se situe entre l’immanence d’une vie réglée par la religion et
la transcendance d’une vérité exigée au départ par la religion elle-même mais où celle-ci
échoue toujours en définitive à s’accorder avec une universalité ou un absolu qui demeurent
mystérieux.
C’est pourquoi, certainement, toute la pensée médiévale semble orientée par le souci
permanent d’accorder la foi avec la raison en tentant d’éclairer les Mystères de la première.
Mais par ce même geste la démarche théologique ne peut, autrement dit, éviter l’aveu du
hiatus qui se situe entre la prétention universaliste de la religion et sa réalité singulière. Et cela
est d’autant plus significatif qu’il nous est donné de constater le paradoxe suivant : la dérive
apologétique de la théologie a ceci d’étonnant qu’elle crée une hiérarchie entre la foi et la
raison, où la raison, évidemment, est seconde, alors même que c’est cette même raison qui
était visée au départ par la religion en tant que garantie de la cohérence de son discours moral.
Pour le dire autrement, la référence divine passe du statut de justification de la cohérence des
choses au statut de principe. Comment en arrive-t-on là ? Qu’est-ce qui explique ce qui va
finalement paralyser la progression des sciences ?
L’apologétique est un champ intellectuel qui est loin d’être unifié. On peut toutefois,
schématiquement, distinguer deux tendances. L’une est politique et tend à convaincre le
pouvoir de tolérer l’exercice de la religion chrétienne en montrant que les chrétiens sont de
bons citoyens. L’autre, celle qui nous intéresse ici, et qui surviendra une fois la chrétienté
installée en Europe au moyen âge, est plus théorique et a pour vocation de justifier la foi aux
yeux des incrédules. L’auteur qui en a accompli la forme la plus achevée fut sans doute
Raymond Sebond dans sa Theologia Naturalis, sive liber creaturerum (Théologie Naturelle,
ou livre des créatures). Globalement l’on peut dire que cette œuvre de Sebond est un
rationalisme pragmatique. Son projet l’amène en effet à envisager la question théologique du

point de vue de l’essence rationnelle de Dieu. Mais par ailleurs, la vérité unifiée étant
inaccessible aux hommes, il produit une définition pragmatique, propre à l’apologétique,
basée sur la confiance et l’utilité. Est vrai ce qui gagne la confiance des hommes et ce qui est
utile à la vie. Quand une proposition n’est pas intrinsèquement évidente, c’est la considération
de son utilité qui l’emporte : face à notre finitude il n’est plus question de rechercher, comme
le firent, par exemple, les stoïciens, les conditions de possibilité de l’évidence dans la force de
la représentation intellectuelle (phantasia). Plus précisément la croyance étant le mode de
transfert des savoirs les plus répandus entre les hommes l’apologète a pour tâche de distinguer
entre les croyances bonnes et les croyances néfastes, ce qui met fin au débat sur la vérité
objective et la connaissance certifiée du grand livre de la nature.
La raison est ici mise intégralement au service de la foi mais comme le montre Sebond
et toute l’apologétique en général, il reste toujours une part de Mystères dans la foi qui
échappe au raisonnement. Pourtant Sebond fut certainement le plus rationaliste à l’égard des
Mystères de l’Eglise et son originalité tint justement dans son ambition de les résoudre. Mais
sa démarche s’échoue sur un cercle vicieux qui rend à la foi sa spécificité mais aussi et surtout
confirme son hermétisme par rapport à la rationalité : Sebond prétendait qu’une science
naturelle permettrait d’asseoir la vérité du christianisme. La lecture du livre de la nature
devrait précéder la lecture de la Bible. Mais Sebond, constatant la nécessité du pragmatisme
admet finalement que nous sommes incapables de lire le livre de la nature, si bien que
finalement la lecture de la Bible est impossible sans lui conserver ses mystères. La raison,
même au cœur du plus rationaliste des apologètes, demeure impuissante face à la foi et la foi
reste tout à fait hermétique à l’exercice de la raison. Elle pose une vérité que la science ne
saurait jamais découvrir.
* *
*
Mais ce schisme posé entre science et religion ne laissera pas indifférents les savants
qui n’y verront, finalement, qu’un échec de la religion. Une fois encore nous pouvons
retrouver ici l’analyse de Weil selon laquelle une morale concrète a beau se gorger de
préceptes rationnels, elle ne parvient néanmoins jamais au niveau de son contenu auquel elle a
pourtant élevé ses sujets.
Toutefois la morale concrète reste le socle de l’existence humaine et en tant que telle
elle est incontournable pour le savant. Si bien que, même face au constat de ses
contradictions, la morale concrète a toujours raison en ce sens qu’elle a toujours le dernier
mot. A défaut d’une autorité rationnelle la religion trouve ainsi une autorité de fait : puisque
l’homme ne peut pas vivre sans elle, elle détient une nécessité morale qui échappe à toute
critique et qui lui confère une force d’impact sans égale sur l’esprit critique scientifique. Ainsi
Socrate dans le Phédon, alors même qu’il est condamné pour des motifs injustes du point de
vue de la raison, doit montrer à ses disciples que ces derniers, devant continuer à vivre après
lui, doivent persévérer dans le respect des traditions de leur cité. S’il accepte sa condamnation
c’est justement parce qu’il a pris la mesure de la raison immanente de la cité comme condition
sine qua non de la raison scientifique tant recherchée tout au long de sa vie.
Ceci explique sans doute aussi pourquoi Descartes, dans la Préface des Méditations
Métaphysiques annonce son travail sous la forme de considérations apologétiques, bien qu’en
réalité les preuves de l’existence de Dieu qui interviennent dans les troisième et cinquième
méditations n’ont pas la place première qu’elles auraient dans un traité apologétique. Elles ne
sont en fait qu’un moyen pour lui de résoudre le problème de l’existence des choses hors de
nous, suite à une découverte autrement première et, justement, purement rationnelle, celle de

la conscience réfléchie. Mais il reste qu’il ne saurait jamais être publié s’il écrivait son propos
dans un ordre plus explicitement fidèle à sa démarche véritable.
Il y a dans le geste cartésien un fondement la science moderne, puisque d’un côté
Descartes ouvre la voie de ce que l’on peut appeler, par anachronisme, un phénoménisme. En
effet, désormais, la science doit s’attacher à considérer non plus les choses selon un ordre
extérieur à l’homme mais selon une inspection de l’ordre intérieur de l’esprit humain. A ce
titre les Méditations Métaphysiques ont une structure tout à fait étonnante.
D’un côté, dès la préface, nous trouvons une forme apologétique somme toute très
classique puisque la preuve par les effets ressemble à s’y méprendre à la preuve cosmologique
de Lactance au livre I, chapitre 2, paragraphe 5 des Institutions Divines où ce dernier montre
qu’il ne se peut concevoir un ordre si admirable dans la nature sans concevoir du même coup
un ordre plus admirable encore qui en soit la cause. Descartes semble reporter cette analyse au
niveau d’une causalité non plus entre la nature et Dieu, certes, mais formellement équivalente
en ce qu’il situe le même lien entre notre nature de sujets pensant l’ordre admirable auquel
nous rapportent les idées innées de l’infini et de la perfection. De plus, à cette même fin il
utilise une distinction conceptuelle elle-même issue de la scolastique médiévale, à savoir la
différence entre la réalité formelle de l’idée et la réalité objective de l’idée lorsque, toujours
dans la Troisième Méditation il entend démontrer l’existence de Dieu par le fait que toute idée
en moi (réalité formelle de l’idée) est toujours la représentation d’un objet (réalité objective
de l’idée) lequel doit détenir éminemment autant de réalité que ce qu’il place causalement en
mon esprit comme une forme.
Or Descartes, dans la première méditation ainsi que dans la première section du
Discours de la Méthode, fonde toute sa recherche sur la remise en cause de toute forme
d’opinion reçue, alors qu’il se servira plus loin de modes de pensée reçus de l’éducation
scolaire pour résoudre les problèmes issus de la découverte du cogito, à savoir le solipsisme et
la pérennité de notre conscience au-delà de l’instant du cogito.
Ce qui est d’autant plus étonnant que la méthode qu’il propose par ailleurs pour
conduire la raison, dans le Discours de la Méthode, se fonde sur la règle de l’évidence qui est
non seulement directement déduite de l’expérience du cogito mais qui, toutefois, semble
discrètement réhabiliter une conception stoïcienne non seulement antérieure à la théologie
médiévale, servie par la scolastique, mais de surcroît antagoniste de celle-ci. En effet
l’apologétique s’est construite sur la rupture avec le débat entre les néoacadémiciens et les
stoïciens sur l’évidence. Pour les stoïciens la vérité tenait dans la force et la netteté de la
phantasia (représentation) et elle donnait ainsi à saisir les propriétés essentielles des choses.
Pour les néoacadémiciens il n’y avait aucun moyen, en revanche, de distinguer la phantasia
du Phantasma (l’illusion) qui nous affecte dans le rêve ou dans la folie.
Descartes va jusqu’à répondre dans le cadre de ce débat lorsque dans la seconde
Méditation il radicalise le doute jusqu’à supposer qu’il puisse être tels ces insensés qui croient
voir des choses qui n’existent pas pour finalement conclure que l’argument du rêve le
préserve de conclure que son doute ne soit fondé sur un état normal de la conscience, à savoir
l’état onirique qui nous donne l’illusion de la réalité.
Donc d’un côté il y aurait un Descartes emprunt du geste apologétique qui argumente
l’ordre des choses sur la base de l’essence bonne de Dieu, et d’un autre côté, dans les deux
mêmes œuvres et principalement dans les Méditations, un Descartes héritier de l’authentique
démarche rationaliste de l’antiquité.
On note ici que la démarche scientifique moderne, dans son acte de naissance, s’inscrit
dans une imbrication à la fois formelle et objective avec un environnement idéologique tout à
fait hétérogène, celui qui succède la renaissance et, partant, il est très difficile de se prononcer
sur le rapport entre science et religion sans noter d’un côté des tensions évidentes et d’un
autre côté, comme nous l’avons souligné au départ, une cohabitation rendue nécessaire par la

primauté morale et culturelle de la religion au point que Descartes se doive de faire preuve
d’une extrême prudence lorsqu’il s’adresse aux docteurs de la faculté de théologie de son
époque, dans une préface aux Méditations où il semble n’annoncer rien moins que le contraire
de ce qu’il va faire, à savoir non pas réfléchir pour prouver l’existence de Dieu aux infidèles
mais prouver l’existence de Dieu pour justifier très paradoxalement une fondation horizontale
de la science comme inspection de l’esprit fini de l’homme, dans les limites de notre faculté à
distinguer le vrai du faux.
* *
*
Il n’en reste pas moins que, malgré la place de Dieu chez Descartes, ce dernier opère
un renversement de la pensée qui désormais dispense le chercheur de la référence au divin
dans la recherche des lois universelles de la nature. Le corps mort devient une simple chose
que l’on peut disséquer, les lois de l’optique ne sont plus soumises à quelque conception
mystique de la lumière et les météores (c'est-à-dire les corps célestes en général) ne sont plus
que des objets parmi d’autres et non plus des éléments d’une création divine parfaitement
circulaire ; enfin Galilée autant que Kepler pourront faire l’objet d’études approfondies
jusqu’à être définitivement confirmés par Newton.
Mais inversement, nous pouvons remarquer, avec Georges Canguilhem dans Idéologie
et Rationalité dans les Sciences de la Vie, combien les travaux de Newton furent conditionnés
par l’aval qu’il reçut des théologiens anglicans qui voyaient dans sa théorie la marque de la
providence divine dans la nature. Toutefois ce que note par ailleurs Canguilhem c’est la façon
dont la science elle-même se dégrade en idéologie et prend, pour ainsi dire, des allures de
religion. Ainsi la théorie de Newton interdira pendant longtemps que l’on cherche à confirmer
Darwin, puisque si le premier conserve une conception réglée de la nature, ce dernier introduit
la notion d’aléatoire dans l’évolution des espèces ce qui implique que l’homme ne peut
absolument plus exister par la volonté de Dieu. Si bien que l’idéologie religieuse, que ce soit
par un aval fortuit ou par un dogmatisme autoritaire, semble systématiquement obliger le
savant à la plus extrême prudence.
Ces deux ruptures narcissiques que sont, selon Freud dans Le Malaise de la
Civilisation, l’héliocentrisme et la théorie de l’évolution, soulignent particulièrement la
dualité d’une inscription anthropologique de la considération religieuse pour un être mû à la
fois par un principe de réalité qui l’oblige à se considérer d’un point de vue déterminé et
déterministe et un principe de désir qui propulse son esprit vers des constructions imaginaires
le plaçant au centre de l’univers. Or c’est certainement ce même problème que Canguilhem
entend souligner, au chapitre 2 de Idéologie et Rationalité, évoquant la célèbre thèse
freudienne, lorsqu’il nous fait remarquer combien l’histoire des sciences est marquée par la
rupture et le recoupement avec l’idéologie. Si bien qu’à terme il devient toujours très difficile
de faire la distinction, hormis en mathématiques, entre, en termes bachelardiens, le périmé et
le sanctionné.
Il appert dès lors que l’idéologie religieuse n’est pas le seul obstacle épistémologique
de la science mais que la science peut devenir elle-même son propre obstacle par la dérive
idéologique qu’elle peut induire, à l’instar de Newton à l’encontre de Darwin. Mais il faut
noter néanmoins que cette dérive idéologique a la forme de la religion. Le scientisme que
dénonce Bachelard dans La Formation de l’Esprit Scientifique se caractérise en effet par la
nécessité pour l’homme d’asseoir son narcissisme sur la raison, dans une tentative de
conciliation entre désir et raison.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%