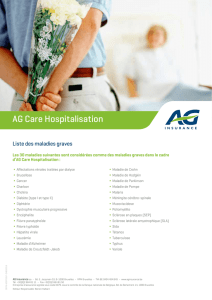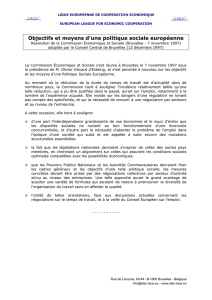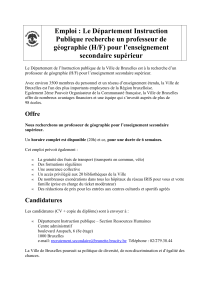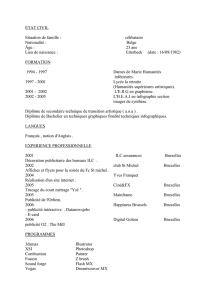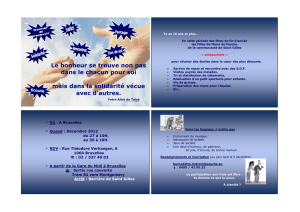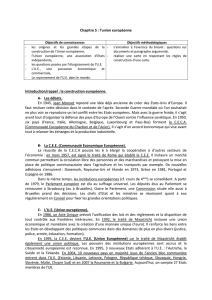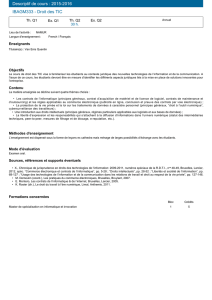Dimitri YERNAULT

1
L’EFFICACITÉ CONTRE L’EFFICACITÉ :
PLAIDOYER POUR LA RÉHABILITATION D’UN DROIT
DE LA PUISSANCE PUBLIQUE AU SERVICE DES DROITS FONDAMENTAUX
Contribution à l’atelier numéro 3 « L’Etat doit-il être efficace ? » pour le site collaboratif de recherche
interdisciplinaire sur le droit public « Le droit public existe-t-il ? »
par
Dimitri YERNAULT 1
30 décembre 2007
La présente contribution est volontiers iconoclaste. Demander à l’Etat d’être efficace en
prêtant à l’efficacité davantage que sa dimension instrumentale est une approche
idéologique, parfois juridique quand elle est traduite en normes, mais idéologique quand-
même. Ce serait aussi se mettre des œillères que de refuser d’analyser les normes à vocation
en apparence purement instrumentales en se réfugiant derrière l’antienne « une politique
n’est ni de gauche, ni de droite ; elle est efficace ou inutile ». Replacer la norme juridique
dans le contexte qui a justifié son édiction et celui de ses application et interprétation est un
exercice démocratique crucial. Pas plus qu’une règle de droit public ou de droit privé n’est
bonne ou mauvaise en soi parce qu’elle est de droit public ou de droit privé, une règle
reprise en boucle par les organisations internationales économiques n’est bonne ou mauvaise
en soi parce qu’elle émane d’organisations internationales économiques. Derrière la norme,
aussi fondamentale ou aussi technique soit-elle, il y a toujours un projet, une conception de
la société plus ou moins consensuelle, plus ou moins respectueuse des droits fondamentaux
de certains, du plus grand nombre ou de tous. Le droit est le produit de la société, il en est
également un moyen de transformation.
L’exercice demandé consistant à s’interroger sur les relations entre droit et économie, il vous
est d’abord ici proposé de discuter de la mise en pratique juridique de l’idéologie sous-
tendant le New Public Management, puissamment relayé par les organisations économiques
internationales, en la confrontant à la responsabilité de définir l’intérêt général qui en dernier
ressort doit appartenir au politique malgré les crises de la représentation (1ère partie).
L’examen succint de 6 thèmes est ensuite abordé pour illustrer en quoi des instruments
juridiques censés mener à l’efficacité de l’Etat handicapent son action plus qu’autre chose en
le rendant inefficace pour assumer les fins pour lesquelles il est institué (2ème partie). Il est
enfin proposé de bien vouloir examiner dans quelle mesure la redéfinition du rôle de l’Etat,
comme garant des droits fondamentaux (civils, politiques, économiques, sociaux et
culturels), peut se passer de la « traditionnelle » distinction entre droit public et droit privé et
d’envisager si elle n’implique pas, au contraire des lignes de force de la mondialisation
contemporaine, un renforcement de certains instruments de contrainte unilatérale, bref de
réhabiliter la puissance publique, cette vieille baderne sans laquelle justement l’Etat ne peut
être efficace (3ème partie).
1 Secrétaire politique du groupe PS au Parlement Bruxellois, assistant en droit public économique (U.L.B.),
conférencier pour l’Executive Master en Management Public de la Solvay Business School (U.L.B.). Ce vil cumul
se nourrit aussi de fonctions d’administrateur de la Société régionale d’investissements de Bruxelles et de la
Société régionale du logement de la Région de Bruxelles-Capitale. Est-il besoin de poser au préalable que les
présents propos n’engagent évidemment que leur auteur ?

2
1ère partie – La poursuite de l’intérêt général dans un monde gagné par la New Public
Management inadapté à sa complexité
I. De « la force des choses »…
« Un soldat doit tuer 3,26 ennemis par engagement en cas de conflagration en milieu urbain (marge
d’erreur : 2,4%) ».
« Un agent de niveau 2B – Z4 de l’Office des Pensions doit traiter 27 cas de catégorie 17 en 7h38 ».
« Avant son remplacement par l’ordinateur HAL8 qui agira 12,47 fois plus vite, le conseil de l’action
sociale de Trifouillis-les-Oies veillera à ce que l’allocataire putatif soit réemployable au moins à un
degré 4 sur l’échelle de Von Ktafenblum qui en compte 13 ».
Si l’on désire un monde géré en fonction de grilles élaborées par des actuaires et par des
logiciels, on ne s’y prendrait pas autrement.
La contribution de Diane DEOM au présent atelier virtuel nous ramène heureusement les
pieds sur terre. Selon elle, l’analyse de l’efficacité des politiques publiques ne devrait être
qu’un facteur de leur évaluation sans rapport direct avec la logique de marché. Mais il n’y a
qu’un pas du passage de cette analyse d’efficacité vers la rentabilité. Dans le même temps,
l’efficacité intrinsèque de la règle juridique n’est pas tout, il faut aussi avoir égard à son
effectivité. En outre, les difficultés de définition préalable des objectifs que la norme doit
atteindre se couplent à celles tenant à la mesure des résultats. Selon son expression, la quête
d’efficacité est à la fois nécessaire et dangereuse, elle ne devrait être qu’un concept
« ancillaire ».
L’Etat doit-il être efficace ? Non peut-être !
Voilà, le débat pourrait s’arrêter ici tant la réponse semble aller de soi. Un Etat inefficace
perdrait la légitimité que les multiples crises actuelles de la représentation ont déjà
solidement entamée.
Ceci étant dit, rien n’est dit. Un Etat peut à certains égards être efficace sans respecter les
canons élémentaires de l’Etat de droit. Au demeurant, cette dernière théorie peut être parfois
critiquée comme étant essentiellement formaliste ou ne s’attachant qu’à la défense de
certains droits fondamentaux en laissant de côte des droits économiques et sociaux. Rien ne
serait surtout dit, quoi que l’on puisse penser de l’école Law & Economics, si l’on s’abstenait
d’avoir égard à l’influence indéniable qu’elle a acquise dans la jurisprudence américaine et
dans les organisations économiques internationales.
Assurément, l’efficacité de l’Etat – au sens générique, celui à envisager dans toutes ses
composantes, tous ses démembrements – est une exigence foncièrement légitime.
Mais, force est de constater qu’un discours sur l’efficacité, un discours parmi beaucoup
d’autres possibles malgré tout, a depuis une vingtaine d’années le vent en poupe. Il s’agit du
discours globalement véhiculé par les organisations internationales, mondiales comme
européennes, à vocation économique, discours qui trouve d’autant plus de place pour se
répandre en Belgique que les réticences de fractions importantes de la population à l’égard
de l’impôt (nous pouvons y rajouter les redevances ou les cotisations sociales) ont aussi pour
toile de fond les nécessités liées à l’assainissement des finances publiques.

3
Si certaines parties de ladite population prétendent pouvoir s’accommoder de moindres
prestations publiques et collectives, force est toujours de constater que la demande de
prestations les plus variées demeure exprimée par la plus grande partie des habitants2. En
atteste par exemple le besoin d’assurer une protection maximale des consommateurs, en
particulier domestiques, d’énergie pendant que les coûts de celle-ci flambent, complètement
en porte-à-faux avec les miracles de la baisse généralisée des prix prêtés à la libéralisation du
secteur entamée en 1996. Ou le débat sur l’instauration d’une 8ème branche de la sécurité
sociale apte à remplir les besoins d’autonomie des personnes âgées. Le tout, avec en toile de
fond, la nécessaire constitution de réserves financières colossales en vue de faire face au
vieillissement3.
N’en déplaise aux tenants de l’efficacité en soi, il s’agit là de la mise en œuvre d’une
idéologie4, notamment formalisée par les multiples courants, parfois même contradictoires5,
qui animent ce qu’on appelle communément en français « l’analyse économique de droit »,
piètre traduction de l’anglais « Law & Economics ». Comme s’il n’y avait qu’une seule
« analyse économique du droit »6… Comme si toutes les conceptions de la société qui
peuvent exister dans des démocraties pluralistes devaient plier face à l’exigence d’un Etat
mais aussi d’un droit minimal, seule étant acceptable par application du principe de
l’autonomie contractuelle qui ne laisserait qu’à la loi qu’une place infiniment subsidiaire7. Il y
a déjà là rupture fondamentale avec la conception de la Révolution française selon laquelle la
loi est l’expression de la volonté générale, rupture dont il faut bien mesurer les
conséquences.
Sous les oripeaux de la scientificité8, de l’objectivité, du chiffre roi… se cache bel et bien une
idéologie qui, dans le domaine qui nous occupe ici, prend notamment les habits du New
Public Management.
2 La contribution du professeur Rusen ERGEC, par ailleurs ancien contributeur du think tank de la très libérale
Fondation Atlantis, au présent atelier conclut que si les gens veulent légitimement moins d’impôts, ils doivent
accepter un moindre niveau de prestations. Etonnamment, les choses sont peut-être un peu plus compliquées que
cela. Il est sans doute vrai qu’un Etat qui ferait peu serait économe. Serait-il pour autant efficace ?
3 Un socialiste invétéré comme le rédacteur a d’ailleurs la faiblesse de penser que l’instauration d’une sécurité
sociale forte est le signe d’une efficacité globale de l’Etat, elle qui a constitué le cadre de solidarité qui a
notamment permis que les fruits du progrès scientifiques, de la médecine au premier chef, soient plus
équitablement disponibles pour toutes les couches de la population.
4 Cette réflexion sur le rôle idéologique du droit comme sur l’idéologie juridique doit évidemment beaucoup à O.
CORTEN et A. SCHAUS, Le droit comme idéologie – Introduction critique au droit, Bruxelles, Kluwer, 2004.
5 V. VALENTIN, Les conceptions néo-libérales du droit, Paris, Economica, 2002.
6 Pour une présentation succincte de ces diverses approches : B. FRYDMAN, « Les nouveaux rapports entre droit
et économie : trois hypothèses concurrentes », in M. CHEMILLIER-GENDREAU et Y. MOULIER-BOUTANG dir.
Le droit dans la mondialisation, Paris, Actuel Marx et Presses Universitaires de France, 2001, p. 57.
7 Cette approche néo-libérale du droit affleure de plus en plus en France chez les juristes comme en atteste par
exemple l’article de Ph. TERNEYRE, « Secteur public et concurrence : la convergence des principes. A propos de
la liberté contractuelle », Actualité Juridique – Droit Administratif 2007, p. 1906 (également B. du MARAIS, Droit
public de la régulation économique, Paris, Presses de Science Po, 2004). Elle n’est plus l’apanage de certains
économistes francophones comme Henri LEPAGE, Demain le capitalisme, Paris, Le Livre de Poche, 1978 ou
Pascal SALIN, Libéralisme, Paris, Odile Jacob, 2000.
8 Ainsi, un des plus fameux auteurs de l’école Law & Economics, même s’il n’en est pas l’inventeur, n’hésite pas à
reprendre à son compte l’étiquette dite du « théorème de Coase » que ses commentateurs ont collée sur son
célèbre article de 1960 traduit en français comme « Le problème du coût social » : Ronald COASE, Le coût du
droit, Paris, Presses Universitaires de France, 2000, p. 77. Ledit théorème affirme que dans des conditions de
concurrence parfaite, les coûts privé et social seront égaux. En l’absence de coûts de transaction, les droits tels
qu’ils sont initialement attribués par le droit positif ne sauraient faire obstacle à une répartition efficiente des
ressources entre acteurs négociant librement sur le marché. Autrement dit, les producteurs concluraient dans
cette hypothèse tout un ensemble de contrats nécessaires à la maximalisation de la valeur de leur production. S’il
est possible que certaines actions reviennent meilleur marché que la réduction des dommages qu’elles sont
censées causer et qu’elles s’avèrent moins chères que toute autre mesure destinée à réduire le dommage, alors ce
sont ces actions qui seraient entreprises. D’après ledit « théorème », le droit est donc prié d’engendrer un

4
Ce constat n’est nullement contestable en soi mais pose problème – car plusieurs idéologies
sont parfaitement respectables – quand derrière la négation de son propre caractère
idéologique, se cache la prétention à dénier toute validité à tout discours et toute pratique
allant à l’encontre du dogme de la libéralisation et de la privatisation, de l’empire du contrat
et de la promotion du partenariat public-privé per se dans les secteurs où même les plus
fervents des – néo- ? ou ultra- ? – libéraux admettaient encore une intervention économique
publique sur le marché9. Une belle illustration dudit dogme pourrait être issue des
conclusions de la toute dernière édition du « Droit des affaires de l’Union Européenne » de
Christian GAVALDA et Gilbert PARLEANI :
« La mondialisation conduit à mettre les systèmes économiques et les lois en concurrence, à
l’aune du critère de l’efficience économique. En soi, l’idée n’est pas nouvelle, et remonte au
moins à Adam Smith. Mais elle s’affirme avec d’autant plus de force que l’économie
dominante, celle des Etats-Unis, est aussi la plus efficace. Les évolutions récentes du droit
communautaire, des sociétés, des marchés et des secteurs financiers, du droit de la concurrence
témoignent de la force des choses, et l’illusion qui consisterait aujourd’hui à s’y opposer »10.
A la fois militant actif et, disons-le, technocrate dans un parti politique dont certains
mandataires indélicats ont précipité la lourde défaite aux élections législatives de juin 200711,
il ne me resterait plus qu’à m’asseoir, attendre que l’orage passe et regarder partir en fumée
ce que le droit européen, l’assainissement des finances publiques, les privatisations et autres
PPP laissent comme maigre place au service public directement assumé par l’Etat dans le
champ économique puisque le jeu du libre marché assurerait spontanément la satisfaction
des droits fondamentaux.
« La force des choses » donc… c’est beau comme le nouveau droit naturel économique que
dénonçaient il y a peu Benoît FRYDMAN et Guy HAARSCHER12. La tentation de l’efficacité
est bien celle-là. N’avoir égard qu’aux performances économiques en soi, viser la rentabilité
de la gestion publique comme but et non comme moyen, sans aucune attention pour la
redistribution des richesses et ses effets contribuant peu ou prou à la justice sociale. Certes si
l’on part de la prémisse selon laquelle l’intérêt général est la somme, la résultante des intérêts
particuliers, le débat pourrait aussi s’arrêter ici.
minimum de coûts de transactions et de garantir une liquidité maximale des droits attachés à la propriété des
biens échangés. Le système juridique ayant ainsi, selon COASE, une influence profonde sur le fonctionnement du
système économique, ceci explique l’intérêt tout particulier que les facultés de droit américaines portent à l’école
Law & Economics.
9 Ces questions ont été largement abordées dans mon étude « La contractualisation (forcée ?) du droit
administratif de l’économie et l’organisation du service public », Revue de Droit de l’U.L.B. 2006, pp. 67-206.
10 C. GAVALDA et G. PARLEANI, Droit des affaires de l’Union européenne, 4ème éd., Paris, Litec, 2006, p. 507.
Nous soulignons.
11 Il serait vain et inutile de se lancer dans la litanie sur les indélicatesses et autres fraudes à la loi également
relevées dans le chef d’autres formations politiques. Dans le meilleur des cas, l’arbitre renverrait la balle au centre
et nous ne serions pas plus avancés dans notre discussion sur l’efficacité de l’Etat par-delà le juste souci de la
sanction à l’égard du responsable et l’invocation au changement de la norme quand celle-ci est inadaptée.
12 Philosophie du droit, Paris, Dalloz, 1998, en particulier le chapitre 3. Dans la 2ème édition de 2002 qui comporte
un chapitre identique qui ne s’intitule plus le « Un nouveau droit naturel économique » mais « Le partage des
biens » (p. 47), les mêmes auteurs relèvent la place grandissante de l’école Law & Economics : « (…) l’analyse
économique ne se borne pas à décrire le fonctionnement du droit. Elle ambitionne de prescrire, à l’attention des individus et
des entreprises, mais aussi des organisations internationales et des Etats, les normes juridiques optimales dans les situations
problématiques ou conflictuelles ». Et plus loin : « Dans cette optique, les droits subjectifs tirent d’abord leur force, non pas
de la loi ni plus largement du droit objectif, mais directement des négociations aux termes desquelles les individus
s’échangent et se reconnaissent des prérogatives mutuelles. Le droit n’a qu’à « laisser faire » librement ces transactions et
entériner leurs résultats, mais certainement pas à intervenir à tout bout de champ, fût-ce au nom de l’intérêt général, pour
influencer leurs modalités ou corriger leurs effets ».

5
II. Une réponse simpliste à la complexité sociétale : les mirages du New Public Management
qui bénéficie d’un terreau fertile dans les organisations internationales
L’idée maîtresse du New Public Management (NPM) est d’une simplicité biblique : les
instruments de gestion du secteur privé doivent être transposés dans la gestion du secteur
public. Toutefois, par-delà ses prétentions opérationnelles qui sont déjà largement
contestables, ses partisans assument pleinement qu’il ne s’agit pas seulement d’importer des
techniques de gestion mais aussi des nouvelles valeurs pour que le « juridisme » cède face à
l’« économisme ». Le NPM serait caractérisé par ces 3 fameux « E » : économie, efficacité,
efficience13. Vu comme cela, que pourrait effectivement une « science humaine », le droit,
face à une « science pure », l’économie, qui elle, manie les chiffres, ma bonne dame ?
Le professeur Geert BOUCKAERT est dans nos contrées certainement l’un des défenseurs les
plus acharnés de ce nouvel idéal-type résumé par la double formule « minimiser – mettre sur
le marché ». Il estime cependant que cet idéal n’a été mis en œuvre que sur la période
resserrée 1990-2000 dans des pays essentiellement anglo-saxons et n’a atteint son paroxysme
qu’en Nouvelle-Zélande. Son principal mérite, selon lui, est d’avoir fait plus généralement
évoluer l’idéal-type de l’Etat wébérien vers le palier intermédiaire « maintenir –
moderniser ». Parmi les très nombreuses conclusions qu’il tire de cette évolution, retenons-en
trois :
1) le droit administratif peut persister mais doit être complété par le droit civil dans les
affaires publiques ;
2) la fonction publique doit voir son souci de légalité tempéré par le souci du résultat ;
3) la légitimité n’est pas seulement affaire de légalité mais aussi des 3 « E »14.
Dans la foulée, la Banque Centrale européenne a développé un étalon reposant sur des
indicateurs de performance (lutte contre la corruption, poids de la réglementation, qualité du
système juridique et judiciaire, importance de l’économie souterraine,…), étalon rapporté
assez grossièrement aux dépenses en biens et services reflétées par les comptes nationaux. Le
professeur VAN DE WALLE a cependant mis le doigt sur l’origine de ces indicateurs. Elle est
à rechercher du côté du Forum économique mondial de Davos qui publiait le « World
Competitiveness Yearbook » avant de céder le relai à l’International Institute for
Management Development ; le Forum de Davos publie aujourd’hui le « Global
Competitiveness Report ».
Or, cette « vue d’ensemble » de l’efficacité prêtée peu ou prou aux diverses législations
nationales repose essentiellement sur des sondages effectués auprès de cadres d’entreprises,
généralement de grande taille et/ou implantées dans plusieurs pays. On a déjà fait mieux
comme débat contradictoire. De tels indicateurs relativement subjectifs ne donnent au
demeurant qu’un aperçu d’une image, bonne ou mauvaise ; ils passent rapidement par le
menu toutes les différences sociales, économiques, politiques, culturelles,… qui peuvent
expliquer certains choix législatifs et réglementaires dans un pays et pas dans un autre.
13 D. VANCOPPENOLLE et A. LEGRAIN, « Le New Public Management en Belgique : comparaison des réformes
en Flandre et en Wallonie », Administration Publique – Trimestriel 2003 , p. 113
14 G. BOUCKAERT, « La réforme de la gestion publique change-t-elle les systèmes administratifs ? », Revue
Française d’Administration Publique 2003 , pp. 53-54. Sur les, liens entre le NPM et l’école du « Public Choice » :
I. MATTIJS, « Belgique, terre de contrats : contexte managérial, juridique et économie politique du mouvement de
contractualisation », Les Cahiers des Sciences Administratives 12/2007, n° coordonné par C. HUYGENS sur « Les
contrats de gestion : un facteur de performance pour les entreprises publiques de la région de Bruxelles-
Capitale ? », p. 15.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
1
/
48
100%