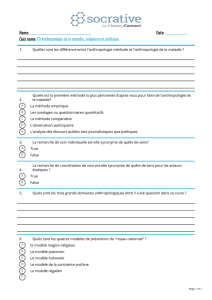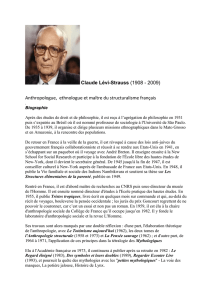Quelle anthropologie économique face à une économie intégrant

Quelle anthropologie économique face à une économie intégrant les
concepts de l’anthropologie? L’exemple des normes sociales
Alice Nicole Sindzingre1
Journée d’Etude « L'anthropologie économique : un domaine qui reste à explorer »,
Laboratoire EDEHN (Équipe Doctorale d’Économie Le Havre-Normandie), ISEC
(Institut de Sociologie Économique et Culturelle du Havre), FREE (Fonds pour la
Recherche en Éthique Économique), Université du Havre, Faculté des Affaires
Internationales, 15-16 octobre 2015
Résumé
Tandis que l’anthropologie économique connaissait à la fin du 20ème siècle une éclipse
relative, l’économie étendait ses objets d’étude à des phénomènes auparavant situés hors
de son champ, tels que les institutions et les normes sociales régissant les
comportements, les institutions politiques ou les représentations cognitives. L’économie
estime désormais qu’elle analyse les objets des autres sciences sociales avec davantage
de rigueur scientifique en raison de sa méthodologie fondée sur les mathématiques. Sur
l’exemple des institutions régissant les appartenances sociales, et dans le contexte de
l’Afrique sub-saharienne, l’article montre que les institutions ne sont pas des variables
mesurables et que pour en analyser les effets économiques, l’approche de
l’anthropologie demeure épistémologiquement supérieure.
Summary
While at the end of the 20th century economic anthropology witnessed a relative eclipse,
economics extended its subjects of study to phenomena that were previously situated
outside of its scope, such as institutions and social norms, political institutions or
cognitive representations. Economics now considers that it analyses the subjects of
other social sciences with more scientific rigour due to its mathematics-based
methodology. Through the example of institutions that govern social memberships and
in the context of Sub-Saharan Africa, the article shows that institutions are not
measurable variables and that, in order to analyse their economic effects, the approach
of anthropology remains epistemologically superior.
1. Introduction
L’anthropologie économique a montré durant le 20ème siècle sa puissance explicative
quant à la compréhension des sociétés non occidentales – définissables comme celles où
des normes non capitalistes, hors marché, coexistent avec des mécanismes de marché.
Elle s’est centrée sur des phénomènes qualifiables sans ambigüité d’économiques, ainsi
les modes de production, le travail, les marchés, l’échange, parmi d’autres. Cependant,
1 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), EconomiX-Université Paris-Ouest; Visiting
Lecturer, School of Oriental and African Studies (SOAS), Université de Londres, département
d’économie. Contact email: ansindzingre@orange.fr

2
au même moment où l’anthropologie économique connaissait une éclipse relative à la
fin du 20ème siècle, les objets de l’économie se sont significativement modifiés. En
économie de la croissance et en économie du développement par exemple, confrontées
aux limites des théories existantes (ainsi celles du ‘rattrapage’, ou de la ‘convergence’)
au vu de la stagnation de nombre de pays en développement (notamment en Afrique
Sub-saharienne), mais aussi en microéconomie, l’économie a étendu ses objets d’étude
à de nombreux phénomènes considérés auparavant comme situés hors de l’économie :
en particulier, les institutions et les règles régulant les comportements, les institutions
politiques et les processus cognitifs et représentations mentales des individus.
L’économie estime désormais que la plupart des objets des autres sciences sociales –
sociologie, anthropologie, psychologie, sciences politiques – sont aussi de son ressort et
analysés par elle avec une rigueur scientifique supérieure, puisque traités par des
modèles mathématiques. Une anthropologie économique du 21e siècle doit ainsi tenir
compte de cette extension des objets de l’économie par rapport au siècle précédent, et
notamment la revendication de cette dernière d’être compétente sur les phénomènes aux
fondements même des concepts de l’anthropologie (ainsi les règles sociales, la ‘culture’,
les croyances, etc.).
De même, pour la plupart des économistes, y compris ceux considérés comme
« hétérodoxes », l’économie se définit par la mesure des phénomènes construits par ses
concepts – prix, utilité, optimisation, etc. Les nouveaux objets de l’économie issus de
l’extension de son champ sont donc également quantifiés, tandis que dans le même
temps les méthodes quantitatives de l’économie se sont propagées aux autres sciences
sociales (ainsi la science politique ou la sociologie), où les statistiques descriptives y
sont non seulement un prérequis, mais où les causalités doivent désormais être
modélisées et éventuellement quantifiées via un modèle économétrique.
L’article développe les arguments d’une anthropologie économique du 21ème siècle
désormais confrontée au fait que l’économie prétend absorber les objets
« traditionnels » de l’anthropologie, via l’exemple de ces nouveaux objets de
l’économie que sont les institutions et les normes - alors que l’anthropologie s’est
fondée sur leur analyse et a construit de son côté des concepts et théories différents,
ainsi ceux de structure, de représentations, de croyances, de culture, etc. L’article
analyse les caractéristiques les plus saillantes des deux cadres conceptuels
(anthropologie économique et économie), et montre que l’approche théorique de
l’anthropologie économique demeure épistémologiquement supérieure pour la
compréhension de phénomènes tels que les institutions et normes sociales et de leurs
effets économiques. Il montre notamment que les hypothèses d’individualisme
méthodologique et de maximisation de l’utilité, l’économie standard ne contribue pas à
la compréhension des spécificités des comportements économiques dans les pays en
développement, que les assertions de l’économie quant à la supériorité de la
quantification sont inexactes, et que certains phénomènes économiques ne sont pas
quantifiables.
Ceci est montré en se référant aux pays en développement, notamment ceux d’Afrique
sub-saharienne, sur l’exemple des institutions et des normes organisant les sociétés et le
comportement des individus en tant qu’ils sont membres de groupes et échangent dans
et au dehors de ceux-ci, i.e. les institutions régissant les appartenances à un groupe – ces
institutions étant autant « économiques » que « politiques » ou « sociales ». Ces
derniers concepts sont en effet depuis les années 90 absorbés par l’économie sous la

3
forme de l’économie des institutions et de celle dite des normes sociales, mais aussi par
la microéconomie du développement, devenue prééminente, et la psychologie
économique (‘behavioural economics’).
L’article est donc organisé de la façon suivante. La première partie présente les
principaux concepts qui seraient définitionnels de la boite à outils de l’anthropologie
économique. La seconde partie examine le reflux de cette dernière à partir des années
90 en raison de l’hégémonie croissante des concepts purement économiques. La
dernière partie montre qu’au début du 21ème siècle l’anthropologie économique a
conservé toute sa puissance explicative, en se centrant sur la thématique des institutions
d’appartenance, l’un des objets historiques par excellence de l’anthropologie.
2. L’anthropologie économique: le déclin des « grandes » théories
Bien qu’ils demeurent matière à discussion, les critères qui différencient l’anthropologie
des autres sciences sociales découlent de sa méthodologie spécifique, une participation
directe de l’observateur sur la longue durée aux situations observées, produisant une
connaissance de première main de phénomènes par nature de niveau « micro » mais
subsumables dans le concept « d’humain » - typiquement l’organisation sociale d’un
groupe (cette thématique a rendu possible l’anthropologie historique ou archéologique).
L’anthropologie est par essence fondée sur une méthode d’analyse holistique, et sur la
prémisse que la compréhension des phénomènes est intrinsèquement dépendante des
contextes, dans le temps (l’histoire) et dans l’espace : ainsi les systèmes de normes
sociales, de parenté, politiques, économiques, religieux, les décisions individuelles, les
processus cognitifs sont tous liés les uns aux autres et chacun donne aux autres leur sens
et cohérence. Ce holisme est certes interprété à l’aune de différentes théories
privilégiant différents principes fondateurs, par exemple les rapports de classe,
l’échange, etc. L’anthropologie peut s’appuyer sur des outils quantitatifs – ainsi
l’analyse des systèmes de parenté après Lévi-Strauss, ainsi l’anthropologie cognitive
située à l’interface de l’anthropologie physique, de la neurologie, etc., ainsi bien sûr
l’anthropologie économique (un exemple furent les travaux de socio-économie en
Afrique de l’ouest des années 1970-90 basés sur la réalisation de grandes enquêtes, sur
la production, la consommation, les migrations, etc.). La méthodologie holistique
demeure cependant ce qui définit l’anthropologie par rapport aux autres sciences
sociales, économie, sciences politique, sociologie ; les concepts sont qualitatifs, centrés
sur les contextes (historiques, spatiaux), fondés sur la méthodologie de l’observation
participante d’un individu extérieur « immergé » dans un autre groupe social.
L’anthropologie économique est consubstantielle à la construction de l’anthropologie,
puisque dès ses débuts à la fin du 19ème siècle celle-ci a eu pour but d’investiguer tous
les aspects de la nature humaine, la parenté, activités économiques, croyances, etc. Dès
ses pères fondateurs les phénomènes économiques des « autres sociétés » ont été son
objet – Marcel Mauss, Bronislaw Malinowski, E. E. Evans-Pritchard, Meyer Fortes,
Edmund Leach, Clifford Geertz, Marshall Sahlins, Jack Goody…, tous explorant
l’échange, de biens ou de personnes, l’organisation du travail, les effets économiques
des règles de parenté, la coexistence de marchés avec des normes sociales organisant
des circuits situés hors de ceux-ci, etc.

4
Egalement, l’anthropologie économique a connu dans les années 70 des moments
particulièrement féconds avec les analyses cherchant à tester la validité de la théorie
marxiste dans les sociétés non occidentales (promues par des anthropologues français,
Claude Meillassoux, Emmanuel Terray, Maurice Godelier) et se voulant critiques du
structuralisme lévi-straussien, des théories maussiennnes de l’échange, de la philosophie
politique critique de l’Etat (ainsi de l’Etat comme émanation de rapports de classe,
défendue par exemple par Pierre Clastres), des théories de Sahlins contre la centralité du
travail, parmi d’autres. La nature des rapports d’exploitation ou même de classe sous-
jacente aux règles de fonctionnement des lignages, les relations entre ainés-cadets ou
hommes et femmes a ainsi été l’objet de vifs débats. Cette période fut remarquable car
malgré des méthodologies radicalement différentes, elle opéra une jonction de
l’anthropologie et de l’économie parce que des concepts théoriques leur étaient
communs - l’approche marxiste réfléchissant sur des concepts, en contraste avec
l’économie néoclassique de plus en plus réduite à sa méthode, i.e. la construction de
modèles mathématiques. Ces débats conceptuels ont connu ensuite un déclin, même
s’ils ne sont pas éteints (comme le rappellent par exemple les travaux de
l’anthropologue David Harvey2), car ils ont subi la disqualification du marxisme
accompagnant la montée du néolibéralisme dans les années 80.
Les deux disciplines, économie et anthropologie, restent cependant séparées, dans un
mouvement de plus en plus marqué pendant le 20e siècle avec la mathématisation
croissante de l’économie et la prééminence du paradigme néoclassique (contre Keynes,
contre les institutionnalistes, Veblen, Schumpeter, Robbins et d’autres théoriciens
questionnant cette évolution) – Karl Polanyi occupant une place à part comme
économiste ayant réussi à superposer les deux disciplines via le concept
« d’embeddedness », précisément construit pour rendre compte de cette jonction. Le
numéro spécial de l’American Economic Review de 1978 s’interroge ainsi sur l’intérêt
qu’un économiste pourrait porter à l’anthropologie économique (Dalton, 1978), même
si dans le même numéro Geertz illustre la possibilité d’analyser de l’économie du
« bazaar » marocain via les concepts de quête d’information, de bruit, de réputation
(Geertz, 1978).
Au tournant du 21ème siècle, l’anthropologie a mis l’accent sur les facettes multiples de
la nature de l’homme et de ses activités, abandonnant les ambitions d’une élucidation de
« grands » principes explicatifs du fonctionnement des sociétés humaines tels que
l’échange, la parenté ou la classe (avec certes des exceptions telles que M. Godelier), et
s’est démultipliée en études sur les biographies, la culture, le genre, le politique et les
inégalités, la cognition, l’évolution, les systèmes agraires, les relations des sociétés à
leur environnement, les sociétés urbaines, parmi d’autres…L’ethnographie des
spécificités culturelles a rejeté dans d’autres disciplines l’exploration des universaux de
la pensée humaine3.
L’anthropologie économique conserve au 21ème siècle sa vitalité au sein de
l’anthropologie (comme le montrent les travaux de Jane Guyer ou Sara Berry, ou, sur un
registre néoinstitutionnaliste d’inspiration néoclassique, Jean Ensminger), mais sur un
2 http://davidharvey.org/
3 Les travaux d’un anthropologue tel que Dan Sperber étant ainsi davantage perçus par les anthropologues
comme relevant de la linguistique ou de la psychologie.

5
mode fragmenté et à distance de « grandes » théories qui avaient permis auparavant un
dialogue, même controversé, avec l’économie.
3. Les dynamiques d’absorption-marginalisation de l’anthropologie économique
par l’économie dans les années 90
Les développements de l’économie au cours du 20ème siècle ont de facto rendu de plus
en plus difficile les discussions avec d’autres disciplines - outre les difficultés plus
générales de l’interdisciplinarité en raison de la spécialisation des sciences (même
l’économie dite hétérodoxe, en principe plus ouverte, ayant des réticences vis-à-vis des
approches purement qualitatives). Plus spécifiquement, toute science sociale se définit
par des concepts et une méthode qui la définissent en contrepoint des sciences sociales
voisines (avant que des disciplines interfaces ne se consolident, ainsi la psychologie
économique, la « neuroéconomie », etc.). De façon significative, lorsque les disciplines
échangent, cela s’effectue lorsque les méthodes sont analogues, et essentiellement
lorsque les méthodes sont quantitatives : des exemples en sont la science politique et la
sociologie contemporaines, de plus en plus mathématisées et dont les frontières avec
l’économie se sont estompées (et de même la formalisation des systèmes de parenté
échange aisément avec l’anthropologie physique, l’épidémiologie, la démographie ou la
biologie)
Dans les années 80 l’économie comme discipline a manifesté une triple dynamique ; i)
Le paradigme néoclassique devient universellement dominant (la « contre-révolution
néoclassique »), les débats sur les prémisses conceptuelles sont évincés hors du champ
de l’économie, l’économie évolue autour d’un petit nombre de concepts (tels
qu’équilibre, utilité, incitation, optimisation, agent représentatif, homothétie entre
niveaux micro et macroéconomiques) et ne conserve qu’une seule méthode, le
réductionnisme en vue d’une mathématisation (Bigo et Negru, 2014) ; ii) l’économie ne
se conçoit plus comme une science sociale mais comme une science physique. La
méthode devient définitionnelle du champ conceptuel et se substitue à celui-ci. Tous les
phénomènes sont subsumables en variables circonscrites, discrètes, quantifiables et que
l’on peut faire entrer en causalité avec d’autres variables dans un modèle, et les
causalités sont fonctionnalistes ; iii) enfin, à partir des années 90, l’économie étend de
façon croissante son champ aux objets définitionnels des autres sciences sociales, y
compris l’anthropologie. Par exemple, les études se multiplient en économie montrant
que certaines institutions économiques et politiques (les droits de propriété, les régimes
– démocratiques, autoritaires -, les croyances – « individualistes », « collectivistes »,
« altruistes ») expliqueraient les performances (ou échecs) économiques des pays ou le
niveau de revenu des ménages mieux que les concepts économiques traditionnels (tels
que l’investissement ou la productivité). De nouvelles sous-disciplines de l’économie
résultant de l’absorption des thèmes des autres sciences sociales se multiplient de la
même façon - l’économie néoinstitutionnaliste, la new political economy, la behavioural
economics, parmi d’autres).
Cette extension de l’économie aux thématiques des autres sciences sociales se double
d’une hiérarchisation : l’économie établit une hiérarchie découlant de sa
mathématisation croissante, où l’approche qualitative (typiquement l’anthropologie), est
le plus souvent considérée comme « anecdotique » (les approches qualitatives au sein de
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%