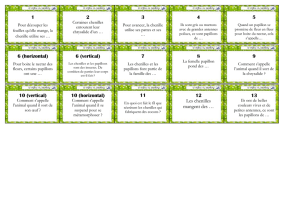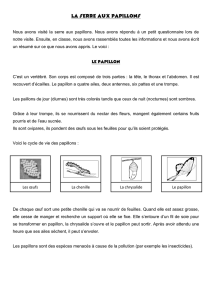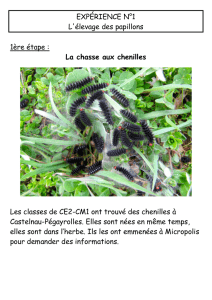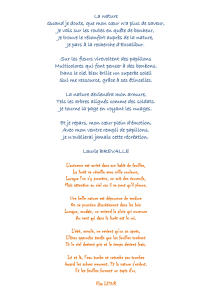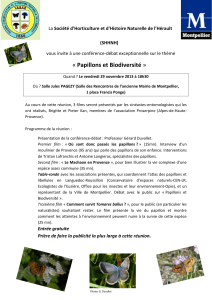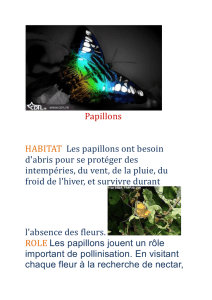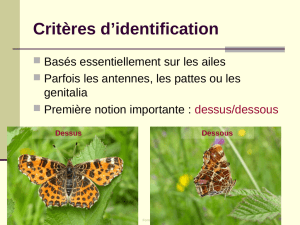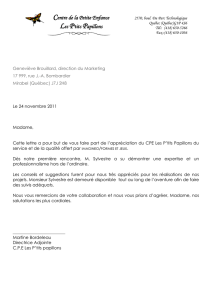en savoir plus sur les papillons

Les papillons commencent leur vie sous forme d'oeuf.
Les papillons peuvent pondre jusqu'à plusieurs centaines
d'oeufs, soit individuellement, soit en masses.
De ces oeufs naissent des chenilles (1). Les chenilles, qui sont
en réalité les larves des papillons, se nourrissent activement
et muent un certain nombre de fois, se débarrassant chaque
fois de leur exosquelette devenu trop petit. Puis, après un
certain temps, elles cessent de se nourrir, partent à la
recherche d'un endroit approprié pour se transformer en
adulte et se métamorphosent en chrysalide. D'importants
changements physiologiques se produisent à l'intérieur de
la chrysalide.
Chez les papillons diurnes, la chrysalide est habituellement
fixée la tête en bas sur une branche de la plante hôte ou sur
tout autre support approprié se trouvant à proximité. Une
fois cette profonde transformation achevée, l'adulte, ou
imago, émerge enfin.
Le cocon est une enveloppe de soie tissée par les chenilles
de certaines espèces de papillon nocturne dont la bouche
est pourvue de glandes séricigènes dérivées des glandes
salivaires. Le cocon a pour fonction de protéger la chrysalide.
Les chenilles de certains papillons nocturnes ne tissent pas
de cocon et s'enfouissent plutôt dans le sol ou se réfugient
à l'intérieur de la tige de la plante hôte pour se transformer
en chrysalide.
Le papillon constitue l'étape ultime du développement de
l'insecte et ne subit donc plus de mue. Les papillons, quelle
que soit leur taille, ont terminé leur croissance et ne gran-
dissent donc plus. Par contre, tout comme chez les humains,
on peut observer des différences de taille importante entre
les individus d'une même espèce.
Dans une même espèce, chaque individu diffère de tous les
autres par une série de détails : la taille, les dessins sur les
ailes... peuvent varier. Cette variabilité est plus importante
chez les espèces récentes, non encore stabilisées, que chez
les anciennes espèces.
À mesure qu'un papillon vieillit, ses ailes se détériorent au
contact des feuilles, des fleurs et des branches. À la suite de
ces contacts répétés, les papillons perdent non seulement
des écailles, mais aussi des fragments d'ailes. Même avec
les ailes endommagées, les papillons parviennent cependant
à voler, quoique leur performance peut s'en trouver affectée.
Le degré de détérioration des ailes est une bonne façon
d'évaluer l'âge d'un papillon et de déterminer s'il vient
d'émerger ou, au contraire, s'il vole déjà depuis un certain
temps.
Même s'ils parviennent à échapper à leurs prédateurs, de
nombreux papillons ne vivent que quelques jours ou, au
mieux, quelques semaines. En revanche, certains papillons
diurnes comme le morio (Nymphalis antiopa) peuvent vivre
jusqu'à dix mois en passant l'hiver dans un état de diapause.
(1) Information supplémentaires sur les chenilles
Les chenilles possèdent des pièces buccales de type broyeur
et se nourrissent habituellement du feuillage d'une ou de
quelques espèces de plante bien précises. Certaines chenilles
sont si spécifiques qu'elles n'ont qu'une plante hôte, tandis
que d'autres se montrent beaucoup plus polyvalentes à
cet égard. Certaines chenilles spécialistes se nourrissent
d'excréments d'animaux ou d'autres insectes, tandis que
d'autres mènent même une vie aquatique et se nourrissant
de plantes aquatiques.
Cycle de vie

Toutes les chenilles finissent par devenir des papillons.
Les larves de certains autres groupes d'insecte peuvent
ressembler étrangement à des chenilles. Les larves les plus
susceptibles d'être confondues avec des chenilles sont
celles des mouches à scie (tenthrèdes, diprions, etc.), qui
sont en réalité des guêpes, et non des mouches. La ressem-
blance est si frappante que même des spécialistes se
laissent berner.
Dans le meilleur des cas, l'identification d'un papillon à
l'espèce d'après les caractéristiques de sa chenille soulève
des difficultés importantes. Premièrement, les chenilles
peuvent changer de couleur en vieillissant et devenir plus
sombres avant de muer. Deuxièmement, la forme de la
chenille varie souvent d'un stade larvaire à l'autre.
À l'heure actuelle, il n'existe aucun guide décrivant les chenilles
de toutes les espèces de papillon vivant dans une région
donnée. Un certain nombre de guides permettent cependant
d'identifier les chenilles au moins jusqu'à la famille. L'élevage
de chenilles jusqu'à l'âge adulte est souhaitable, car il per-
met de mieux comprendre les premières étapes du cycle de
développement. En résumé, pour la très grande majorité
des espèces de papillon, le stade adulte est bien connu,
mais les stades larvaires le sont souvent beaucoup moins.
Cycle de vie

Actuellement, on estime à environ 140 000 le nombre des
espèces de papillons, dont 20 000 espèces diurnes et 120
000 espèces nocturnes. C’est l’un des ordres d’insectes les
plus importants quantitativement. Chaque année, plus de
600 nouvelles espèces de papillons sont découvertes.
Même si les papillons de nuit (hétérocères) sont réellement
beaucoup plus nombreux dans le monde, l’exposition
présente principalement des papillons diurnes (rhopalocères)
puisqu’ils sont beaucoup plus actifs de jour et rendent ainsi
la visite plus agréable.
Le mot « papillon » dérive directement du latin « papilio ».
En anglais, l'origine du mot « butterfly » est plus incertaine.
On croit qu'il provient du mot anglo-saxon « butterfloege
», qui signifie beurre volant. Ce mot désignait fort proba-
blement le citron (Gonepteryx rhamni), belle espèce aux
ailes jaune vif commune en Europe et déjà bien connue à
l'époque des anglo-saxons. On ignore cependant comment
et quand on en est venu à étendre le sens du mot à tous les
papillons.
Les papillons sont plus actifs et visibles par temps ensoleillé
ainsi que le matin lorsqu’ils se nourrissent.
Chez la plupart des papillons, la bouche est modifiée en une
longue trompe repliée sur elle-même à la façon d'un ressort
de montre. Les papillons utilisent leur trompe pour aspirer le
nectar des fleurs ou les jus qui s'échappent des fruits fer-
mentés ou de la charogne, ou encore la sève qui exsude des
arbres. Quelques espèces de papillons nocturnes possèdent
des pièces buccales de type broyeur, tandis que d'autres
sont totalement dépourvus de bouche et ne s'alimentent
plus au stade adulte. Il y a même une espèce de papillon
nocturne qui se nourrit du sang qui s'échappe des blessures
des animaux.
Les papillons les plus rapides sont probablement les hes-
péries et certains Nymphalidae. Certains de ces papillons se
déplaceraient à plus de 50 km à l'heure. La plupart des pa-
pillons diurnes ne dépassent cependant pas les 8 à 20 km à
l'heure. Les papillons se laissent souvent porter par le vent
pour accroître leur vitesse de vol, en particulier lorsqu'ils se
sentent menacés par un prédateur. Les papillons diurnes qui
vivent en milieu découvert, notamment les espèces des ré-
gions arctiques et de la toundra ou celles qui vivent dans les
prairies, maîtrisent très bien cette technique. Durant ses mi-
grations, le monarque se laisse également porter par les
vents rapides, même le courant-jet.
Un très grand nombre d'organismes, allant des bactéries et
des virus jusqu'aux reptiles et aux oiseaux, se nourrissent de
papillons. Les papillons ont recours à diverses stratégies
pour éviter de devenir la proie de ces prédateurs..
Mode de vie

C’est sous les tropiques que les papillons présentent les
couleurs et les formes les plus variées, et que le nombre des
espèces est le plus élevé. Dans les zones au climat tempéré,
les espèces de grande taille représentent l’infime minorité
des peuplements de lépidoptères, n’atteignant que des di-
mensions tout à fait modestes. En revanche, la diversité de
leur mœurs est bien plus grande, ce qui est une con-
séquence directe des conditions climatiques très partic-
ulières à ces régions, soit l’alternance d’une saison chaude
et d’une saison froide.
Un très grand nombre d'organismes, allant des bactéries et
des virus jusqu'aux reptiles et aux oiseaux, se nourrissent de
papillons. Les papillons ont recours à diverses stratégies
pour éviter de devenir la proie de ces prédateurs. En voici
quelques-unes :
Le camouflage : Le polygone est un expert dans l'art du
camouflage. Le contraste entre la coloration vive du dessus
des ailes et les marbrures sombres du dessous est frappant.
Lorsque ce papillon se tient immobile sur la litière, les ailes
relevées, il se confond si bien avec les feuilles, les ombres et
les ramilles qui l'entourent qu'il devient pratiquement invis-
ible.
La coloration prémonitrice ou avertissante : En raison de
sa livrée orange et noire des plus contrastantes, le monar-
que passe difficilement inaperçu. Certains pourront s'éton-
ner de voir un insecte s'afficher aussi ostensiblement.
Pourtant, la plupart des prédateurs l'évitent. En réalité, il
utilise cette coloration vive pour avertir ses prédateurs po-
tentiels qu'il est inconsommable en raison des toxines qu'il
contient. La stratégie est efficace, car en général, les pré-
dateurs comme les oiseaux apprennent rapidement à éviter
les insectes qui possèdent une livrée prémonitrice.
La coloration-éclair : Une likenée perchée sur l'écorce d'un
arbre est très difficile à voir, mais si elle est découverte et
attaquée par un oiseau, elle relève subitement ses ailes pour
exposer ses ailes postérieures vivement colorées. L'effet de
surprise est tel qu'il permet souvent à la likenée d'échapper
à son agresseur.
Les ocelles : Les ocelles peuvent avoir plus d'une fonction.
Par exemple, les papillons hiboux (également connus sous le
nom de caligos) présentent sur la face inférieure de leurs
ailes postérieures, vers l'arrière du corps, deux gros ocelles
qui ressemblent étrangement aux deux grands yeux que
pourrait avoir un animal de plus grande taille. Si le prédateur
n'est pas effrayé par ce qu'il voit, il peut passer à l'attaque.
Dans ce cas, c'est habituellement ce qu'il croit être la tête de
sa victime qu'il vise. Avec ses deux grands ocelles situées à
l'arrière du corps, le papillon hibou a donc plus de chance
de survivre. Les papillons qui ont survécu à de telles at-
taques se reconnaissent facilement à leurs ailes postérieures
échancrées.
Absorption de chaleur
Comme tous les autres organismes poïkilothermes (p. ex.
les reptiles), les insectes sont des animaux « à sang froid ».
Toutefois, quelques groupes d'insectes ont acquis la faculté
d'élever leur température corporelle par diverses adapta-
tions comportementales. Un de ces comportements con-
siste à s'exposer au soleil pour absorber la chaleur produite
par les rayons solaires.
Les couleurs plus foncées absorbent évidemment mieux la
chaleur que les couleurs plus pâles. C'est la raison pour
laquelle la proportion de papillons foncés est en général
plus élevée à haute altitude ou dans les régions polaires que
dans les régions plus chaudes ou de basse altitude.
Coloration

Par rapport aux autres insectes, les papillons ont une vision
moyenne. Ils sont par contre avantagés par rapport à la plu-
part des autres insectes, car ils perçoivent les couleurs. La
différenciation des couleurs chez les papillons est toutefois
plus fine dans la bande ultraviolette du spectre lumineux.
Les papillons ne perçoivent donc pas les couleur comme
nous. Un grand nombre de fleurs possèdent des zones qui
sont visibles uniquement dans l'ultraviolet. Nous sommes
donc incapables de voir ces taches, mais les papillons et
d'autres insectes, comme les abeilles, les perçoivent très
bien et sont attirées par elles.
L’existence des papillons avec traces fossiles remonte au
crétacé, soit à 180 000 000 d’années. Leurs ancêtres, très
primitifs, sont probablement apparus avant la période du
Carbonifère, plus de 350 000 000 d’années avant notre ère.
(2) Information supplémentaire :
DIURNES VS NOCTURNES
Techniquement parlant, les papillons diurnes ne représen-
tent en réalité qu'un type particulier de papillon nocturne.
Voici toutefois quelques caractéristiques générales qui
aident à les distinguer : les papillons diurnes volent unique-
ment le jour, tandis que certains papillons nocturnes volent
le jour et d'autres, la nuit. Au repos, les papillons nocturnes
replient leurs ailes en toit de chaque côté du corps, tandis
que les papillons diurnes les relèvent et les maintiennent ac-
colées les unes contre les autres. Le thorax et l'abdomen
sont habituellement plus gros et plus velus chez les papil-
lons nocturnes que chez les papillons diurnes. Le meilleur
trait distinctif demeure cependant la structure des antennes,
qui sont terminées en massue chez les papillons diurnes,
plumeuses et amincies de la base au sommet chez les pa-
pillons nocturnes. Mais pour chaque différence relevée entre
les deux groupes, on peut trouver des exceptions.
Coloration
1
/
5
100%