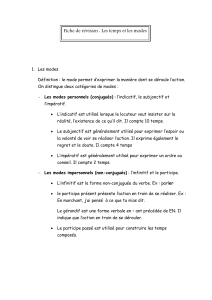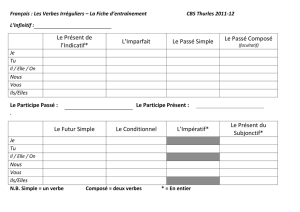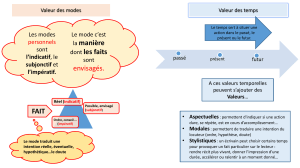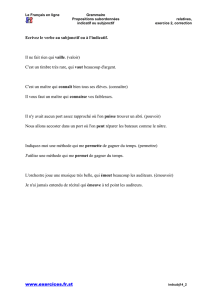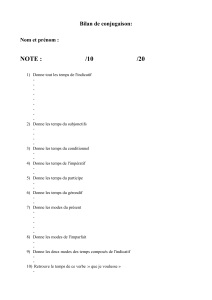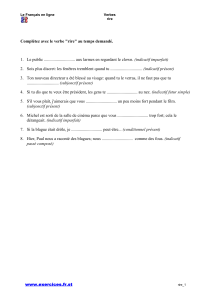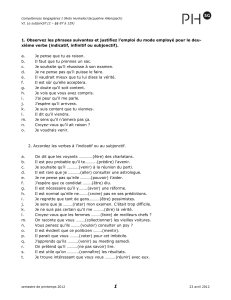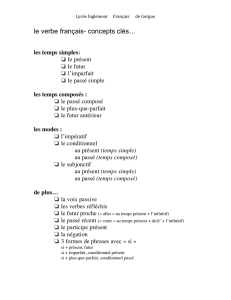DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Les phrases conditionnelles françaises

1
DOKTORI DISSZERTÁCIÓ
Les phrases conditionnelles françaises et portugaises construites avec si
aux XIVe-XVe siècles
FODOR ANTÓNIA
2010

2
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
DOKTORI DISSZERTÁCIÓ
Fodor Antónia
Les phrases conditionnelles françaises et portugaises construites avec si
aux XIVe-XVe siècles
Nyelvtudományi Doktori Iskola
vezetője: Dr. Bańczerowski Janusz DSc
Romanisztika Program
vezetője: Dr. Salvi Giampaolo, DSc
A bizottság tagjai:
Elnök: Dr. Bárdosi Vilmos, CSc
Bírálók: Dr. Salvi Giampaolo, DSc
Dr. Domokos György, PhD
Titkár: Dr. Szabó Dávid, PhD
Tag: Dr. Náray-Szabó Márton, PhD
Póttagok: Dr. Lax Éva, PhD
Dr. Pálfy Miklós, CSc
Témavezető: Dr. Kiss Sándor, CSc
Budapest, 2010

1
Chapitre 1 : Introduction
1.1. L’objectif de l’étude
Pour exprimer une hypothèse, les langues néolatines modernes utilisent différents
temps et modes dans les phrases conditionnelles construites avec si. Si nous examinons les
trois types principaux de phrases conditionnelles – phrases relevant du futur, phrases
relevant du présent et phrases se rapportant au passé –, nous pouvons voir que ce sont les
différents temps de l’indicatif qui sont employés dans la protase en français moderne, alors
qu’en portugais ce sont les différents temps du subjonctif qu’on y trouve. En ce qui
concerne l’apodose, nous y trouvons le futur de l’indicatif ou le présent de l’indicatif, le
conditionnel présent et le conditionnel passé aussi bien en français moderne qu’en
portugais moderne, mais la langue portugaise peut substituer l’imparfait de l’indicatif au
conditionnel présent et le plus-que-parfait composé de l’indicatif au conditionnel passé.
Notre intention est de présenter et d’analyser toutes les structures utilisées dans les
phrases conditionnelles françaises et portugaises des XIVe-XVe siècles, d’étudier l’emploi
des différents temps et des modes dans ces phrases. Nous avons choisi cette période car, en
ce qui concerne l’évolution des phrases conditionnelles françaises, c’est une époque que
nous pourrions appeler « période de transition », car l’imparfait du subjonctif est encore
utilisé aussi bien dans la protase que dans l’apodose des phrases conditionnelles, il peut
encore se référer au présent ou au passé, mais, en ce qui concerne les phrases relevant du
présent, la construction moderne avec l’imparfait de l’indicatif et le conditionnel présent
est déjà prédominante. Le plus-que-parfait du subjonctif est également utilisé dans la
protase et dans l’apodose des phrases conditionnelles relevant du passé et nous trouvons
déjà des exemples pour l’emploi du plus-que-parfait de l’indicatif et du conditionnel passé.
En ce qui concerne l’évolution des phrases conditionnelles portugaises, à notre
connaissance, aucune étude de l’envergure de celle de Wagner1 n’a été faite. Leão a publié
en 1961 son œuvre sur les phrases conditionnelles portugaises construites avec se. Cette
étude a le mérite de nous donner un aperçu des différentes structures utilisées dans les
textes qu’elle a analysés, elle nous présente leur fréquence au cours des siècles dans
plusieurs tableaux. Mais, malheureusement, nous n’y trouvons aucune autre analyse, elle
n’analyse pas l’emploi des différents temps et des modes, elle ne parle pas de la valeur
1WAGNER, Robert Léon (1939) : Les phrases hypothétiques commençant par « si » dans la langue française
des origines à la fin du XVIe siècle.

2
sémantique des différentes constructions, de la modalité de l’assertion. Nous considérons
donc que notre présent travail pourrait être la première étape d’une future étude de
l’histoire des phrases conditionnelles portugaises.
1.2. Corpus et méthode
Nos corpus français et portugais sont constitués d’œuvres en prose datant du XIVe et
du XVe siècles. Nous avons décidé de choisir des œuvres en prose car la langue poétique
est plus conservatrice, les contraintes imposées par les rimes et par les vers peuvent
influencer le choix entre deux structures équivalentes et concurrentes.
Dans les tableaux suivants, nous présentons les œuvres constituant nos corpus avec les
abréviations utilisées dans les références :
Corpus français :
Bérinus Bérinus
Froissart : Chroniques III Froissart
Le Ménagier de Paris Ménagier
Les quinze joies de mariage XV Joies
Alain Chartier : Le Quadrilogue invectif Quadrilogue
Antoine de la Sale : Jehan de Saintré Saintré
Les cent nouvelles nouvelles CNN
Le roman de Jehan de Paris Jehan
Corpus portugais :
Crónica Geral de Espanha de 1344 C1344
A Demanda do Santo Graal Graal
Orto do Esposo Orto
O Castelo Perigoso Castelo
Livro da Ensinança de Bem Cavalgar Toda Sela Ensinança
Fabulário Português Fabulário
Fernão Lopes : Crónica de D. Pedro I. Pedro

3
Les phrases conditionnelles dont l’apodose est subordonnée et dans lesquelles l’emploi
des temps est déterminé par les règles de la concordance des temps imposées par le style
indirect ou le style indirect libre ne font pas partie de nos corpus français et portugais.
Nous avons également exclu de notre corpus portugais les phrases conditionnelles dans
lesquelles le verbe de la protase et/ou de l’apodose est à la troisième personne du pluriel du
plus-que-parfait simple de l’indicatif ou du pretérito perfeito simples de l’indicatif2 car le
morphème flexionnel de ces deux temps est souvent homographe à cette époque3.
Selon la tradition grammaticale, le conditionnel est un mode à part entière, mais de nos
jours presque tous les linguistes rangent cette forme parmi les temps de l’indicatif4.
Certains abandonnent même le terme conditionnel et utilisent l’expression « formes en
-rais »5. Dans notre étude, nous n’analyserons pas cette problématique, c’est la raison pour
laquelle nous avons préféré garder l’appellation traditionnelle « conditionnel présent » et
« conditionnel passé », qui est plus courante.
En ce qui concerne les temps et les modes portugais, nous utiliserons, tout comme
Sten6 dans son étude sur l’emploi des temps en portugais écrite en français, l’appellation
française des différents temps et modes, mais nous garderons dans notre analyse le nom
portugais de deux temps du passé de l’indicatif – pretérito perfeito simples et pretérito
perfeito composto. Bien que ces deux temps correspondent morphologiquement au passé
simple et au passé composé français, nous avons préféré conserver l’appellation portugaise
car leurs emplois ne coïncident pas.
2 Dans son étude sur les Diálogos de São Gregório, Silva a également décidé d’exclure ces formes car elle
considère que « o morfema de tempo e de pessoa – 3a. pessoa do plural do perfeito e mais-que-perfeito – já
se apresenta homógrafo, senão também homófono. » (Silva 1964-1973 : 278)
3 Selon Williams, la fusion en diphtongue [ɐ̃w] des formes portugaises terminées en voyelles nasales -ã, -õ
aurait commencé au XIIIe siècle et elle était complète dans la deuxième moitié du XVe siècle (Williams
1994 : 181). Teyssier affirme que la fusion était complète vers 1500 (Teyssier 1990 : 46).
4 Dans son article, Abouda nous présente les arguments diachroniques, morphologiques, analogiques de
différents linguistes et ses propres arguments syntaxiques utilisés pour affirmer la nature temporelle de cette
forme. (Abouda 1997 : 179 et s.)
5 Nous pouvons trouver ce terme dans l’étude de Wagner et dans celle de Buridant également.
6 Sten 1973.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
1
/
211
100%