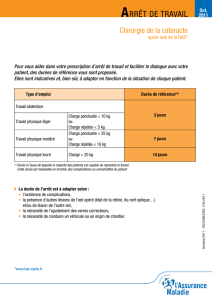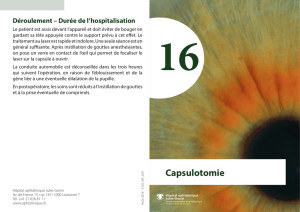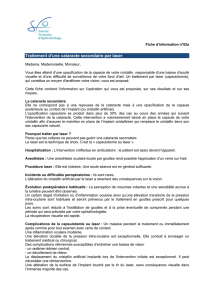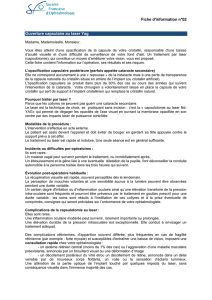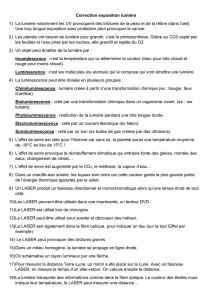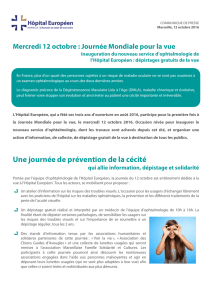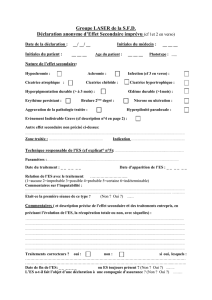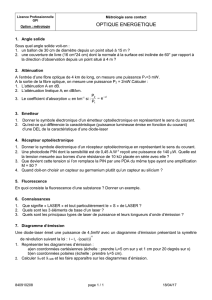Téléchargez le PDF - Revue Médicale Suisse

H. Abouzeid
introduction
La cataracte est responsable d’environ la moitié des cas de cé-
cité dans le monde. Selon les estimations de 2004 de l’OMS,
la Suisse a un taux de chirurgie de plus de 4000 cas par mil-
lion/habitants par an, ce qui fait partie des plus hauts dans le
monde.1 Depuis son introduction en 1967 par Charles Kehlman,
la phacoémulsification représente la technique de choix pour
cette chirurgie. Elle a permis de réduire largement le risque de complications et
d’améliorer les résultats réfractifs postopératoires.2,3 Toutefois, les complications
peropératoires telles que la rupture de la capsule postérieure ou antérieure du
cristallin, ou l’astigmatisme induit, et les complications postopératoires telles que
l’œdème cornéen secondaire ou surtout l’endophtalmie sont autant de complica-
tions à gravité et fréquence variables qu’il serait souhaitable d’arriver à limiter au-
tant que possible.4
Le femtolaser (figure 1) (laser femtoseconde) pour la chirurgie de la cataracte
a été utilisé pour la première fois au monde en 2008 par le Professeur Zoltan Nagy
à Budapest.5 A ce jour, 1000 chirurgiens dans 42 pays utilisent déjà cette techno-
logie et cela représente environ 100 000 interventions de cataractes pratiquées
dans le monde sur les environ 20 millions opérées. Au dernier congrès de l’Ame-
rican Academy of Ophthalmology, à la question de savoir si le femtolaser était
l’avenir de la chirurgie de la cataracte, 93% des participants ont répondu par l’af-
firmative. De grands experts internationaux se positionnent en faveur de cette
nouvelle technologie dans la chirurgie de la cataracte.6 Le femtolaser permet de
pratiquer trois étapes importantes de la chirurgie de la cataracte : les incisions
cornéennes, le capsulorhexis ou ouverture de la capsule du cristallin et la frag-
mentation du noyau.7-9 Il est également possible de pratiquer des incisions arci-
formes cornéennes pour corriger l’astigmatisme. Quatre machines produites par
quatre compagnies différentes sont à ce jour commercialisées (Alcon LenSx,
Bausch and Lomb Victus, Optimedica Catalys, LensAR), mais seules deux d’entre
elles permettent aujourd’hui de pratiquer les trois étapes précitées.
Cette technologie est en plein essor, et il est certain qu’elle bénéficiera d’amé-
liorations notables dans les prochaines années, voire même les mois à venir. L’ac-
Femtocataract surgery : a promising
future ?
Introduced in 2008, femtolaser is playing a
more and more significant role in cataract sur-
gery. This laser allows to perform three steps
of the cataract surgery : the corneal incisions,
the capsulotomy, and the lens fragmentation.
The prooved advantages of the technique
are a better quality of the incisions with a re-
du ced induced astigmatism, a better reliabi-
lity and reproducibility of the capsulotomy
with a better stability of the implanted lens
and a reduction of the use of ultrasounds
which can negatively affect the cornea. To
date, there is no prospective randomized
study that has proven the superiority of this
technique in terms of refractive results or sa-
fety compared to the standard manual tech-
nique. The significant extracost generated by
the laser, which has to be undertaken by the
patient, is a limi ting factor for both its use
and study.
Rev Med Suisse 2013 ; 9 : 2350-3
Introduit en 2008, le femtolaser prend une place grandissante
dans la chirurgie de la cataracte. Ce laser permet de pratiquer
trois étapes clés : les incisions cornéennes, l’ouverture de la
capsule et la fragmentation du cristallin. Les avantages prouvés
sont une meilleure qualité des incisions qui limite l’astigma-
tisme induit, une ouverture de la capsule plus reproductible
et fiable qui confère une meilleure stabilité de l’implant intra-
oculaire, et une réduction de l’utilisation des ultrasons, délé-
tères pour la cornée. Aucune étude prospective randomisée n’a
été menée pour prouver la supériorité de cette technique en
termes de résultats réfractifs ou de sécurité en comparaison à
la technique manuelle standard. Le surcoût important généré
par le femtolaser, qui est à la charge du patient, est un élé-
ment limitant son utilisation et son étude.
Femtolaser dans la chirurgie de
la cataracte : un avenir prometteur
le point sur…
2350 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
11 décembre 2013
Dr Hana Abouzeid, MER
Policlinique et Unité de la cataracte
Hôpital ophtalmique Jules-Gonin
15, avenue de France
1004 Lausanne
www.ophtalmique.ch
Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
5 janvier 2013 0
38_41_37289.indd 1 05.12.13 10:07

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
11 décembre 2013 2351
célération dans le développement de ce laser a été im-
pressionnante, et plus importante que prévu. Il ne s’agit plus
d’attendre les machines de deuxième ou troisième géné-
ration, car à présent ce sont de simples mises à jour de
programmes informatiques qui se font à des rythmes pres-
que mensuels dans les centres de développement des
compagnies productrices.
caractéristiques du femtolaser
Le femtolaser est déjà largement utilisé en ophtalmolo-
gie pour la chirurgie réfractive. Il utilise le principe de pho-
todisruption, sorte d’évaporation tissulaire. Grâce au fait
que la durée d’impulsion du laser se compte en femtose-
conde (soit 10-15 seconde), le laser délivre une très forte
puissance sur un point d’impact très limité, tout en utili-
sant un faible niveau d’énergie, ce qui protège les tissus
environnants. Le tissu touché se transforme en un micro-
plasma, constitué d’eau et de dioxyde de carbone, qui se
dilate et produit une bulle de cavitation. La succession de
milliers de minuscules bulles va permettre de réaliser un
plan de clivage et une découpe du tissu visé. Pour appli-
quer le femtolaser à la chirurgie de la cataracte, il a fallu lui
conférer une plus profonde pénétration tissulaire et un plus
grand volume cible. Les quatre machines présentes sur le
marché ont également toutes un système très précis de vi-
sualisation continue ou séquentielle du segment antérieur
de l’œil, qui permet de tenir compte des variations anato-
miques cornéennes et pupillaires et surtout de définir des
marges de sécurité pour la fragmentation du cristallin, évi-
tant ainsi de léser sa capsule postérieure. Les différences
entre ces machines concernent principalement le système
d’imagerie, l’interface entre le patient et la machine, et les
propriétés du rayon laser lui-même.
L’interface entre le patient et la machine peut être soit
à immersion liquide, soit solide avec une succion et une
aplanation de l’œil. L’avantage du système solide est la meil-
leure performance de la pratique des incisions cornéennes
sur un œil plus stable mais l’inconvénient est l’aplanation
qui, par les plis de la cornée (Descemet) qu’elle confère,
peut réduire l’efficacité de la pratique de la capsulotomie
avec une induction de points de non-rupture de la capsule,
chirurgicalement difficile à gérer. Par ailleurs, seules deux
machines montrent assez de recul à ce jour pour la pratique
des incisions cornéennes (Alcon LenSx, Optimedica Catalys).
Enfin, les propriétés du laser, telles que la fréquence
utilisée, sont importantes car elles influencent l’efficacité
de la fragmentation du cristallin et la dissipation d’énergie
dans l’œil. Aucune des quatre machines sur le marché ne
con centre tous les avantages que cette technologie ap-
porte, il s’agit donc, à l’acquisition, de faire un compromis
entre les propriétés qui semblent les plus importantes et
les plus sûres à chaque chirurgien.
avantages du femtolaser
En ce qui concerne les incisions cornéennes, l’utilisation
du femtolaser permet de réduire l’astigmatisme induit
chirurgicalement grâce à une meilleure construction des in-
cisions.2 Ces incisions pratiquées au femtolaser montrent
une excellente stabilité et étanchéité,10 ce qui pourrait ré-
duire le risque potentiel d’infection secondaire, mais ceci
n’a pas été démontré. Les incisions pratiquées au femtolaser
réduisent également les éventuelles atteintes de la cornée
postérieure (membrane de Descemet) relativement fré-
quentes avec la chirurgie manuelle.2
L’ouverture de la capsule du cristallin, la capsulotomie
(qu’on appelle capsulporhexis quand l’ouverture est prati-
quée manuellement), doit idéalement avoir une forme par-
faitement circulaire pour équilibrer les forces de tension
sur la capsule et maintenir un centrage parfait de l’implant
placé au centre, à court et long termes. C’est une étape dé-
licate de la chirurgie manuelle dont la courbe d’apprentis-
sage est traditionnellement la plus longue dans la chirurgie
de la cataracte. Or, la circularité de la capsulotomie est
meilleure quand elle est pratiquée au femtolaser et le cen-
trage de cette ouverture est également meilleur.5,11 En
conséquence, le recouvrement de l’implant dans la capsule
est également supérieur avec le femtolaser, de même que
la stabilité de l’implant dans la capsule à une année.11
Quand on compare le diamètre atteint de la capsulotomie
par rapport au diamètre voulu au départ, le rapport est
meilleur avec le femtolaser, améliorant ainsi la prédictibi-
lité du geste.11,12 La qualité optique semble également
améliorée avec le femtolaser.8
Le troisième atout du femtolaser est sa pratique de la
fragmentation du cristallin, étape à laquelle la majorité des
complications de la chirurgie surviennent.13 Non seulement
la pratique de cette étape par le femtolaser permettrait de
réduire les complications, mais surtout de diminuer la
quantité d’ultrasons utilisés pour émulsifier le cristallin.
Considérant que l’utilisation des ultrasons est délétère pour
l’endothélium qui maintient la transparence de la cornée,
la réduction de leur utilisation, qui est démontrée avec le
femtolaser, est un avantage certain.2,14
Enfin, l’utilisation d’une machine à la reproductibilité,
prédictabilité et précision accrues devrait permettre d’at-
0 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
5 janvier 2013
Figure 1. Image montrant le femtolaser LenSx
(Alcon) avec l’interface en plastique qui fixe l’œil du
patient
38_41_37289.indd 2 05.12.13 10:07

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
5 janvier 2013 0
teindre un niveau de sécurité supérieur. Alors que l’effet
sur l’inflammation postopératoire est inconnu à ce jour, une
étude à large échelle, incluant 1500 patients, montre un
taux de complications aussi faible que ceux les plus bas
publiés dans la littérature pour la chirurgie manuelle.15 On
citera notamment le taux de la très redoutée rupture de la
capsule postérieure qui varie entre 0,45 7 et 3,5% 9 selon les
séries, et qui est de 0,31% dans la plus grande série publiée
sur le femtolaser, avec 1500 patients.15
la chirurgie assistée au femtolaser est-
elle supérieure à la chirurgie standard
de la cataracte ?
Cette question n’a pas encore trouvé de réponse. Les
quelques études comparatives publiées à l’heure actuelle
ne permettent pas de tirer de conclusion, principalement en
raison de leur méthodologie. Il n’existe en effet aucune
étude prospective randomisée qui compare les résultats
réfractifs et la sécurité de la chirurgie standard de la cata-
racte à ceux de la chirurgie assistée au femtolaser.16 Le coût
d’une telle étude est un élément dissuasif, mais également
le fait que la très grande majorité des machines acquises à
ce jour l’ont été par des centres privés dont l’orientation ne
va pas vers ce type d’étude. La réponse viendra probable-
ment de centres universitaires. Nous lançons à Lausanne
une étude pilote qui pourra mener à la conduite d’études
de plus larges échelles. Il est à noter que la phacoémulsi-
fication a été introduite en 1967 et que ce n’est qu’en 2001
que sa suprématie comparée à la chirurgie extracapsulaire
a été établie en termes de coût-efficacité par une étude
prospective randomisée.3 Ce fait illustre la difficulté à me-
ner de telles études bien qu’il faille s’attendre à un délai
probablement plus court pour le femtolaser.
précautions
La procédure du femtolaser est hautement technique et
demande ainsi une formation adéquate du chirurgien qui
veut la pratiquer. En effet, ce n’est pas l’étape du laser qui
est difficile mais plutôt l’adaptation à l’étape chirurgicale
qui suit l’application du laser. En effet, le laser crée des
bulles de gaz à l’intérieur de l’œil qui font augmenter la
pression intra-oculaire et des cas de perte de noyau dans
le vitré ont été décrits.17 Par ailleurs, ces mêmes bulles de
gaz rendent la visualisation de la capsulotomie pratiquée
par le laser plus difficile. S’ajoutent à cela les cas de cap-
sulotomie incomplète, qui font prendre un risque accru de
déchirure de la capsule antérieure du cristallin avec exten-
sion postérieure possible. Les autres complications per-
opératoires décrites, moins dangereuses, sont la perte de
succion de l’œil (pour les machines qui l’utilisent), et la
contraction de la pupille secondaire à l’énergie libérée par
le laser. L’utilisation du femtolaser demande ainsi une for-
mation spécifique pour le chirurgien qui doit adapter sa
gestuelle chirurgicale et appliquer des précautions, à pré-
sent connues, à sa pratique.15 Il semble que les chirurgiens,
qui ont déjà une expérience de chirurgie réfractive, aient
une courbe d’apprentissage plus rapide et moins de com-
plications au début, en raison notamment de leur habitude
du système de succion du femtolaser, pour les machines qui
utilisent ce système.18 Il est recommandé de ne pas com-
mencer la pratique avec des cas compliqués.
contre-indications
Par ailleurs, certaines situations sont contre-indiquées
pour l’utilisation du femtolaser, telles que les dilatations
pupillaires inférieures à 5 mm, les opacités cornéennes ou
les cataractes blanches, à travers lesquelles le laser ne peut
pas passer, les glaucomes avancés qui pourraient souffrir
de l’augmentation de pression due à la succion, et les con-
ditions qui rendent la succion difficile (petit écartement
palpébral, nystagmus, spasme facial, etc.).
coût
A ce jour, aucune assurance, de base ou complémen-
taire, ne prend en charge le surcoût inhérent à l’utilisation
de femtolaser. Ce surcoût est généré par plusieurs éléments
dont le coût de la machine (environ CHF 500 000.–) et de
son entretien (environ CHF 40 000.– par an), le coût du temps
supplémentaire d’utilisation du bloc opératoire (environ
20-30 min), et le coût du temps supplémentaire passé par
le chirurgien. Ces deux derniers éléments dépendent de la
rapidité du chirurgien et de la facturation et structure de
chaque établissement. Si la médecine basée sur les preu-
ves montre à l’avenir un avantage clair du femtolaser, la
question de son remboursement pourrait être considérée
à terme par l’Etat et les assureurs. Les patients ont toute-
fois prouvé par le passé leur appréciation de la technologie
du femtolaser, principalement pour la sécurité qu’elle ap-
porte. En effet, le femtolaser a été introduit pour la création
des capots cornéens de LASIK en 2001. A l’époque, 100%
des LASIK étaient pratiqués au microkératome. En 2011, une
étude américaine de marché a montré que 70% des LASIK
sont pratiqués au femtolaser malgré un surcoût à la charge
du patient d’environ 1200 dollars (http://market-scope.com/
refractive-report). Il a ainsi fallu dix ans pour qu’à présent
l’utilisation du femtolaser soit largement majoritaire et que
les avantages certains de l’automatisation de ce geste pous-
sent les patients à préférer cette technique malgré le coût
supplémentaire qu’elle induit. Il est probable que le fem-
tolaser pour la chirurgie de la cataracte, qui est encore à
ses débuts, suive la même évolution. A ce jour, le forfait à
la charge du patient pratiqué par l’hôpital ophtalmique,
pour l’utilisation du femtolaser, est de CHF 1450.–.
conclusion
Bien qu’aucune étude prospective randomisée et con-
trôlée à large échelle n’ait été effectuée pour démontrer la
supériorité des résultats de la chirurgie de la cataracte au
femtolaser, cette technique semble tout à fait prometteuse
et pourrait représenter l’avenir de la chirurgie de la cata-
racte. Cet avis est partagé par de nombreux experts inter-
nationaux en chirurgie de la cataracte. Pour le chirurgien se
pose la question de l’adaptation de ses gestes chirurgicaux
et d’un investissement personnel important. Du point de
vue du patient, l’investissement financier est conséquent,
2352 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
11 décembre 2013
38_41_37289.indd 3 05.12.13 10:07

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
11 décembre 2013 2353
mais comparable à celui d’une chirurgie réfractive de type
LASIK. Pour le chirurgien comme pour le patient, des meil-
leurs résultats réfractifs et surtout une meilleure sécurité
sont les objectifs qui justifient ces investissements. A ce
jour, le taux de complications avec l’utilisation de ce laser
est similaire, voire plus faible que les taux les plus bas pu-
bliés pour la chirurgie manuelle. Historiquement, l’automa-
tisation de la chirurgie en général semble corroborer ces
attentes.
0 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
5 janvier 2013
L’auteur n’a déclaré aucun conflit d’intérêt en relation avec cet
article.
Implications pratiques
La chirurgie de la cataracte peut aujourd’hui se faire avec une
assistance par laser femtoseconde
Les complications opératoires pourraient être réduites grâce
à l’utilisation du laser
Le surcoût généré par l’utilisation du femtolaser est à la
charge du patient, aucune assurance-maladie, même privée,
ne fait aujourd’hui de prise en charge
>
>
>
1 World Health Organization. Global cataract surgical
rates 2004. www.who.int/blindness/data_maps/CSR_
WORLD_2004.jpg
2 * Palanker DV, Blumenkranz MS, Andersen D, et
al. Femtosecond laser-assisted cataract surgery with
integrated optical coherence tomography. Sci Transl
Med 2010;2:58ra85.
3 Minassian DC, Rosen P, Dart JK, et al. Extracapsular
cataract extraction compared with small incision sur-
gery by phacoemulsification : A randomised trial. Br J
Ophthalmol 2001;85:822-9.
4 * Lundstrom M, Barry P, Henry Y, et al. Evidence-
based guidelines for cataract surgery : Guidelines based
on data in the European Registry of Quality Outcomes
for Cataract and Refractive Surgery database. J Cata-
ract Refract Surg 2012;38:1086-93.
5 Nagy Z, Takacs A, Filkorn T, Sarayba M. Initial cli-
nical evaluation of an intraocular femtosecond laser in
cataract surgery. J Refract Surg 2009;25:1053-60.
6 ** Steinert RF. Femto future : Sizzle or steak ? Oph-
thalmology 2012;119:889-90.
7 Gimbel HV, Sun R, Ferensowicz M, et al. Intraope-
rative management of posterior capsule tears in phaco-
emulsification and intraocular lens implantation. Ophthal-
mology 2001;108:2186-9 ; discussion 2190-2.
8 Mihaltz K, Knorz MC, Alio JL, et al. Internal aber-
rations and optical quality after femtosecond laser an-
terior capsulotomy in cataract surgery. J Refract Surg
2011;27:711-6.
9 Greenberg PB, Tseng VL, Wu WC, et al. Prevalence
and predictors of ocular complications associated with
cataract surgery in United States veterans. Ophthal-
mology 2011;118:507-14.
10 Masket S, Sarayba M, Ignacio T, Fram N. Femtose-
cond laser-assisted cataract incisions : Architectural
stability and reproducibility. J Cataract Refract Surg
2010;36:1048-9.
11 Kranitz K, Takacs A, Mihaltz K, et al. Femtosecond
laser capsulotomy and manual continuous curvilinear
capsulorrhexis parameters and their effects on intra-
ocular lens centration. J Refract Surg 2011;27:558-63.
12 Friedman NJ, Palanker DV, Schuele G, et al. Fem-
tosecond laser capsulotomy. J Cataract Refract Surg
2011;37:1189-98.
13 Bellini LP, Brum GS, Grossi RS, Borowsky C. Ca-
taract surgery complication rates. Ophthalmology 2008;
115:1432 ; author reply 1432-3.
14 Abell RG, Kerr NM, Vote BJ. Toward zero effec-
tive phacoemulsification time using femtosecond laser
pretreatment. Ophthalmology 2013;120:942-8.
15 ** Roberts TV, Lawless M, Bali SJ, et al. Surgical
outcomes and safety of femtosecond laser cataract sur-
gery : A prospective study of 1500 consecutive cases.
Ophthal mology 2013;120:227-33.
16 ** Trikha S, Turnbull AM, Morris RJ, et al. The
journey to femtosecond laser-assisted cataract surgery :
New beginnings or a false dawn ? Eye (Lond) 2013;27:
461-73.
17 Roberts TV, Sutton G, Lawless MA, et al. Capsular
block syndrome associated with femtosecond laser-as-
sisted cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2011;
37:2068-70.
18 * Bali SJ, Hodge C, Lawless M, et al. Early expe-
rience with the femtosecond laser for cataract surgery.
Ophthalmology 2012;119:891-9.
* à lire
** à lire absolument
Bibliographie
38_41_37289.indd 4 05.12.13 10:07
1
/
4
100%