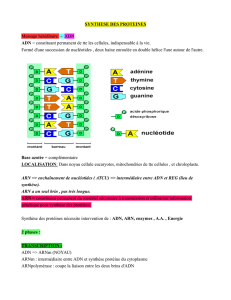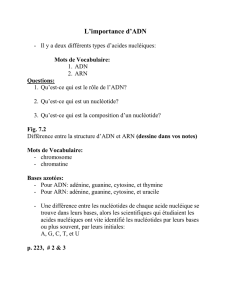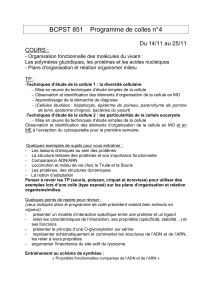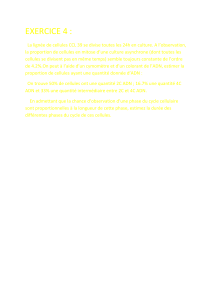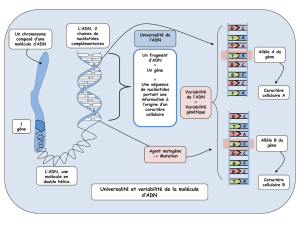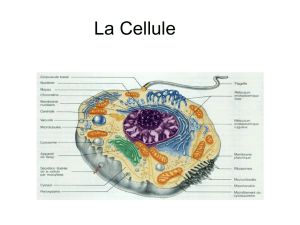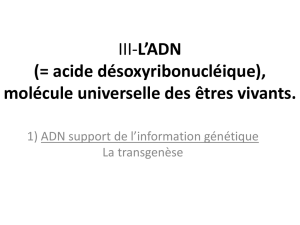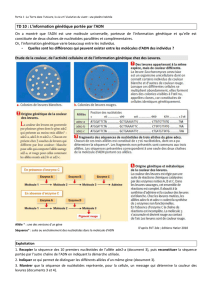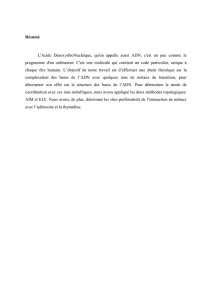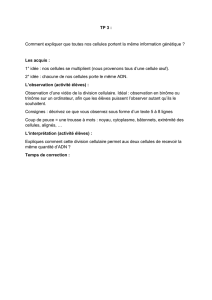Génétique - fichestropbonnes


I. Le cycle cellulaire
Le cycle cellulaire est une portion de la vie de la cellule dont la
durée est variable. En moyenne chez l'Homme, ce cycle dure une
vingtaine d'heures. Il est constitué d'une interphase et d'une
division cellulaire.
1) L'interphase
L'interphase est la phase durant laquelle la cellule croît et réplique son
ADN. Elle est constituée de trois phases : la phase G1, la phase S et la phase
G2.
La phase G1 est une phase de préparation à la réplication de l'ADN. La
cellule grossit. Tant que la taille de la cellule n'est pas correcte et que
l'environnement n'est pas favorable, la cellule est bloquée dans cette phase.
Durant cette phase, il y a aussi un contrôle des lésions éventuelles de l'ADN.
Cette phase est donc la plus longue et la plus variable du cycle.
La phase S (phase de synthèse) est la phase de réplication de l'ADN. La
quantité d'ADN est alors doublée.
La phase G2 est une phase de vérification de la réplication. La cellule
vérifie s'il n'y a pas eu d'erreurs et si tout l'ADN a été répliqué. C'est aussi une
phase de préparation à la division cellulaire.
Les cellules spécialisées ne se divisent plus. Elles sont en phase G0.
Durant cette phase, elles réalisent de nombreuses synthèses. Certaines
d'entre elles peuvent être à nouveau recrutées et retourner dans le cycle
cellulaire précédent.
2) La division cellulaire
La division cellulaire est aussi appelée mitose. Les chromosomes de la
cellule eucaryote qui étaient invisibles jusque là se condensent et deviennent
visibles. La cellule « mère » donne naissance à deux cellules « filles »
identiques.
Durantcette phase, la quantité d'ADN est divisé par 2. Les chromosomes
se séparent de façon à ce que l'information génétique soit identique dans les
deux cellules « filles ». Le caryotype des deux cellules filles sera identique.
Interphase
Réplication de l'ADN
Mitose
Chromosomes
Cellule eucaryote
caryotype

II. La réplication de l'ADN
Lors de la phase S de l'interphase du cycle cellulaire, la quantité
d'ADN est doublée. L'ADN est reproduit à l'identique
1) Mise en évidence expérimentale
En 1957, Meselson et Stahl cultivent des bactéries afin d'étudier la
réplication de l'ADN. Pour cela, ils utilisent des milieux utilisant de l'azote
14 ou de l'azote 15. L'azote 15 est plus lourd que l'azote 14. L'ADN formé avec
de l'azote 15 sera donc plus dense que celui formé avec de l'azote 14. Ils
pourront être séparés par centrifugation. La position de la molécule dans le
tube indiquera sa densité.
Ils cultivent d'abord les bactéries dans un milieu contenant de l'azote
15 pendant un grand nombre de générations de sorte que leur ADN ne
contient plus d'azote 15. La densité de l'ADN de ces bactéries sur le milieu à
azote 14.Elles répliquent leur ADN sur ce nouveau milieu.
Leur hypothèse était qu'une nouvelle molécule serait produite à côté de la
première, ils obtiendraient alors une molécule lourde avec l'azote 15
(l'ancienne) et une légère avec l'azote 14 (la nouvelle). Or ce n'est pas ce
qu'ils ont observé. La centrifugation du tube 3 montre densité intermédiaire
(1.675). La génération suivante donne deux types d'ADN : l'un de densité
intermédiaire et l'autre de faible densité. Il leur faut donc imaginer un
autre système de réplication.
2) Le mécanisme de la réplication
La réplication de l'ADN s'effectue selon un mode semi-conservatif, fondé
sur la complémentarité des bases azotées. Les deux brins de l'ADN se séparent
et de nouveaux nucléotides se fixent sur chacun d'eux selon la
complémentarité A-T et C-G. On aboutit à deux molécules absolument
identiques. Cette réplication est gouvernée par des enzymes tels que l'ADN
polymérase entre autres. Son fonctionnement nécessite de l'énergie.
Les résultats s'expliquent par ce mécanisme. La première génération de
bactéries avait un ADN mixte composé d'un brin contenant de l'azote 15
(ancien) et un brin contenant de l'azote 14 (nouveau). Lors de la deuxième
génération, cette molécule mixte s'est ouverte et des nouveaux nucléotides se
sont fixés formant ainsi une molécule mixte et une molécule entièrement
constituée de brins contenant de l'azote 14.
ADN
Base Azotée
Nucléotide
Complémentarité des bases
Enzyme

III. La reproduction conforme de
la cellule
La reproduction conforme correspond à la formation de
deux cellules « filles » identiques à la cellule de départ. Appelée
aussi mitose, elle se produit chez tous les eucaryotes avec un
rythme variable selon les espèces et est constituée de 4 phases.
1) La prophase
Les chromosomes se condensent à partir de la chromatine présente
dans le noyau. Chaque chromosome possède deux chromatides puisque l'ADN
a subit une réplication lors de la phase S de l'interphase. Chaque
chromatide est donc constituée d'une molécule d'ADN. Les deux chromatides
d'un même chromosome sont donc identiques. L'enveloppe nucléaire
disparaît.
2) La métaphase
Les fibres du fuseau se fixent au centromère de chaque chromosome.
L'ensemble des chromosomes se groupe sur le plan équatorial de la cellule.
C'est à ce stade que l'on peut réaliser des caryotypes.
3) L'anaphase
Les chromosomes se clivent au niveau du centromère et les deux
chromatides de chaque chromosome migrent chacune vers un pôle de la
cellule. La forme en V prise par les chromatides est due au fait qu'elles sont
tractées par les fibres du fuseau au niveau du centromère. A la fin de cette
phase, on obtient à chaque pôle de la cellule, la moitié des chromatides,
chacune d'elle représentant un chromosome.
4) La télophase
Le fuseau de fibres disparaît, les chromatides se décondensent dans
chaque future cellule « fille », dont ils formeront les noyaux. L'enveloppe
nucléaire se reconstitue autour dela chromatine. Le cloisonnement du
cytoplasme permet d'aboutir aux deux cellules filles.
Dans chaque cellule nouvellement formée, il y a le même équipement
chromosomique donc la même information génétique, et il y a tout le
matériel nécessaire à la vie de la cellule : le cytoplasme de la cellule mère
s'est séparé en deux de manière équitable.
Chromatines
Chromatide
Centromère
Diploïde

IV. Variabilité et mutation de
l'ADN
Lors de la réplication de l'ADN, des erreurs spontanées et rares peuvent
se produire. Ces erreurs sont des mutations. Elles modifient la séquence
d'ADN, ce qui peut avoir des conséquences plus ou moins importantes sur
l'expression des gènes.
1) Les différents agents mutagènes
La fréquence des mutations est très faible, mais leur nombre peut être
augmenté par des facteurs externes comme certains rayonnements (UV,
rayons X, rayonnements radioactifs...) ou certains produits chimiques
(amiante, benzène)
Les rayonnements : ils provoquent des modifications dans la séquence
d'ADN en créant des liaisons covalentes entre les bases adjacentes (rayons
UV). Les radiations ionisantes (rayons X, radioactivité) produisent des
radicaux libres qui endommagent l'ADN et bloquent la réplication et la
transcription. Elles causent aussi des pertes de bases, des ajouts et des
réarrangements de la séquence d'ADN.
Les produits chimiques:certaines molécules peuvent prendre la place des
bases azotées, s'intercaler entre elles (benzène), modifier leur structure.
D'autres peuvent lier les brins entre eux ou sectionner l'ADN
2) Les conséquences des mutations
Les cellules somatiques : ces cellules ne subissent que des mitoses. Ainsi,
la mutation ne sera présente que dans le clone de la cellule mutée. Les
mutations dans ces cellules entraînent des conséquences uniquement au
niveau de l'individu (cancer, maladies auto-immunes).
Les cellules germinales : comme ces cellules sont à l'origine des
gamètes, la mutation pourra être transmise à un autre individu, elle
donnera naissance à un nouvel allèle. Elle deviendra alors héréditaire et
sera à l'origine de la diversité des allèles, et donc de la biodiversité.
Mutations
Agents mutagènes
Cellules somatiques
Clone
Cellules germinales
Allèle
Biodiversité
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%