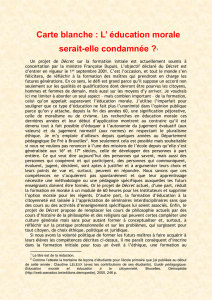un amour sans morale - Editions de la transparence

un amour sans morale ?
Si Duras a souvent excellé dans l’art de la controverse sur le
sujet de l’amour, ce n’est pas par simple goût de la provocation,
dont elle n’était du reste pas dépourvue, mais, plus subtilement
sans doute, parce que l’amour ne relevait, pour elle, d’aucune
morale et ne pouvait en conséquence jamais mieux s’appréhen-
der que dans l’intelligence de ses contradictions, l’exercice de
ses intermittences, loin des normes et des valeurs que l’insti-
tution bourgeoise, donc religieuse, a érigé pour dompter les
affects et rendre contractuelles les passions humaines. Il peut
étonner que la question de la morale ait aussi peu intéressé les
nombreux critiques universitaires qui se sont attelés à l’autopsie
minutieuse de l’œuvre de leur idole, dans la mesure où cette
question, absolument centrale quant à l’amour, y fait l’objet
d’une délibération constante et interroge de façon critique,
souvent subversive, non seulement la manière dont il convien-
drait d’aimer pour soi, mais la valeur d’un amour qui répudie-
rait toute morale, ou ne saurait y consentir sans l’abuser, sans la
détourner à la seule fi n d’en refonder une propre sur les ruines
de sa réfutation. Duras, qui évite l’écueil consistant à répudier
l’idée même de morale — puisqu’il en faut bien une, et, avec
elle, satisfaire à certains devoirs, pour aimer ou savoir aimer
— ébauche moins, en effet, une réfl exion sur la possibilité de
se priver d’une morale que sur les conditions pour en refonder
[23]

une nouvelle. Il ne s’agit pas tant de la répudier que de gommer
son caractère prescriptif, pas tant de la condamner que de l’ac-
cepter à certaines conditions : l’amour durassien implique évi-
demment bien une morale, mais une morale conditionnelle,
qui interprète si librement les valeurs de la morale bourgeoise
qu’elle donne aux garants de cette même morale l’impression
de n’en être pas une ou d’en être une douteuse.
Que la morale s’excepte au point de vouloir se refonder, ne
doit guère surprendre chez un écrivain aussi activement engagé
dans la politique et dont les inclinations partisanes qui l’ont fait
adhérer un temps au Parti communiste, épouser les combats
de la révolution sexuelle, les revendications féministes de son
époque, ne pouvaient que l’ériger contre les valeurs, réaction-
naires, hypocrites et oppressantes à son goût, de l’institution
bourgeoise ; qu’une morale de l’amour cherche ainsi à se redé-
fi nir contre l’institutionnelle ne doit pas faire douter de cette
morale pour la raison précise qu’elle n’obéit à rien de ce qu’on
lui impose : quand bien même il le faudrait, quand bien même
cette morale serait douteuse, elle ne le serait que pour remettre
en cause la morale commune, ainsi que l’atteste ce dialogue
entre le Japonais et la Française dans Hiroshima mon amour :
— Je suis d’une moralité douteuse, tu sais.
— Qu’est-ce que tu appelles être d’une moralité douteuse ?
— Douter de la morale des autres.
Ce serait ainsi faire un procès d’intentions à l’œuvre de
Duras que de la moraliser, quand, faisant de l’Amour un Graal,
un Bien transcendant, d’intentions, elle n’en a, au fond, que
de vertueuses et d’obligeantes pour l’atteindre, l’Amour. Ainsi,
sa morale tient l’amour en si haute estime que non seulement
elle admet la trahison mais la pardonne, se plie à un devoir de
charité et de bienveillance sans réserve qui, expurgeant de ses
préceptes toute idée de faute ou de péché, pourrait se donner
comme devise : rien n’est péché si l’amour permet tout, et si
péché il y a, ce serait de s’interdire d’aimer au nom de la morale.
Dès lors, une fois admise l’idée que l’amour se dote d’une
morale aussi vertueuse que la morale institutionnelle, à laquelle
[24]
[dans le séjour des corps]

elle s’oppose en principe, il importe de s’intéresser aux fonde-
ments de cette morale et d’examiner la manière par laquelle
celle-ci œuvre en vertu du bien et s’oblige à un « bien aimer »
supérieur. L’exemple concret de l’infi délité permettra de vérifi er
cette hypothèse, et notamment, la défi nition paradoxale qu’en
donne l’auteur dans une interview au journal Le Monde, sou-
cieux, comme souvent, d’abolir les antagonismes élémentaires :
« L’amour est un devenir constant comme la révolution. Le
mouvement peut s’inscrire soit dans un couple, soit, dramati-
quement, le dépasser. Qu’est-ce que l’infi délité sinon la fi délité
à l’amour » 1, se demande Duras dont l’œuvre, dans le sillage du
roman moderne de la fi n du XVII
e
siècle qui accorde une place
prépondérante à la problématique du mariage, du couple et de
l’adultère, ne cesse de décliner le motif et fait fructifi er l’héri-
tage d’une abondante littérature sur la question — La Prin-
cesse de Clèves de Madame de Lafayette, La Nouvelle Héloïse de
Rousseau, Les Affi nités électives de Goethe, Anna Karénine de
Tolstoï, Madame Bovary de Flaubert, L’ Amant de Lady Chat-
terley de Lawrence…
Cette formule très rhétorique propose une conception pour
le moins inattendue de l’infi délité, qui ne doit plus se conce-
voir comme un acte de déloyauté mais comme une déclaration
d’amour faite à l’Amour même. En assimilant l’infi délité à une
autre sorte de fi délité, non seulement Duras contrevient à l’idée
commune d’une opposition radicale entre les deux notions,
mais elle pose aussi comme principe la distinction entre deux
types particuliers de fi délité : la fi d é l i t é e n a m o u r s’inscrit dans
le respect d’une prise d’engagements, d’obligations et de devoirs
moraux, tandis que la fi délité à l’amour concerne une dévotion
religieuse à l’Amour. La formule est également intéressante en
ce que, inversant la conception des moralistes qui trouvaient
le vice derrière chaque vertu, elle prône l’indistinction même
du vice et de la vertu : l’infi délité durassienne se fait garante
d’une morale positive selon laquelle l’apparente impiété naît
d’une piété singulière, et le péché, dans cette religion dévolue à
l’Amour, signe pour ses fi dèles un véritable acte de foi.
[25]
[un amour sans morale ?]

le « de matrimonio » durassien
Il se peut que le soupçon que l’institution du mariage
inspire à l’auteur soit né du dépit d’y avoir longtemps cru,
peut-être d’y avoir sacrifi é ses idéaux, puisque si Duras, elle-
même, n’a pas résisté à la tentation de se marier, elle a investi
ses héroïnes de ses propres doutes sur le sujet et, partant, a
poursuivi la réfl exion à travers des doubles qui, à son image,
semblent s’être résolus à faire comme tout le monde, résignés à
faire comme les autres femmes, c’est-à-dire à adopter, au nom
de la raison, une morale légitimante, en conformité avec l’insti-
tution. Faut-il que l’amour ait perdu ses dernières illusions, que
le romantisme des premiers élans se soit mué au fi l du temps
en une trop tendre affection pour que le mariage soit présenté
comme un consentement étranger à l’amour, supposé rendre
aux partenaires l’illusion qu’il existe toujours et que, ainsi légi-
timé par l’institution, il se renouvellera dans des proportions
dignes de ce qu’il était dans les premiers moments : le narra-
teur du Marin de Gibraltar montre ainsi peu d’enthousiasme
à l’idée d’épouser Jacqueline : « On va se marier. Elle y tient
beaucoup, elle ne sera heureuse que lorsqu’on sera mariés. » La
sorte d’étrangeté manifestée à l’égard de sa compagne — qui
n’est pas sans rappeler celle qu’éprouve Meursault pour Marie
dans L’ É t r an g er —, son détachement, ne proviennent pas là
d’une posture masculine du mépris, mais bien des hésitations
coupables de l’idéaliste qui aime trop aimer pour voir son
amour se détériorer et laisser au temps qui passe, à l’habitude
qui enlise, la charge d’un abandon grossier. Dans le lexique
durassien, les termes « contrat » et « engagement social » sont
bannis : ils faussent l’amour. Duras oppose aux sentiments
contractuels une conception trop pure pour ne pas être inno-
cente, selon laquelle l’idée de l’amour — à savoir la construc-
tion sociale que nous nous en faisons, la représentation sociale
que nous en avons — limite l’amour même. C’est ainsi parce
que le mariage arrive après l’amour, dont ne subsisteraient plus
que le souvenir nostalgique, l’invisible trace de l’idéal, la mer-
[26]
[dans le séjour des corps]

veilleuse image de son éblouissement initial, qu’il semble juste
un moyen de lui survivre.
Puisque ce n’est pas l’amour qui incite les femmes à se
marier, mais bien le désir d’acquérir une légitimité sociale
et de faire accéder l’amour à ce que Kierkegaard nomme le
« stade éthique », le souci de se conformer à une norme (« Il
n’y a aucune raison pour que je ne me marie pas un jour, moi
aussi, comme les autres », dit la jeune fi lle du Square), il n’est
pas très étonnant que le mariage représente le renoncement à
son « aventure individuelle », une formidable machine décep-
tive propre à engendrer toutes les vicissitudes, l’usure du désir,
la lassitude et les frustrations, la déchéance et les privations :
« lorsque l’amour procède d’une entente commune, pratique,
dit Duras, on a affaire soit à un meurtre opéré par le couple sur
lui-même, soit tout simplement à la consécration d’une erreur
même durable » 2. Au prétexte de l’amour dont il est la preuve
contractuelle, non seulement le mariage, triomphe de l’intérêt
bourgeois, ne favorise pas l’épanouissement des partenaires,
mais il ne fait qu’aliéner les partenaires entre eux. Explorant
sans relâche les mystères du mariage, Duras compose un De
matrimonio satirique, une sorte de Physiologie du mariage que
n’aurait pas renié Balzac et qui valut à ce dernier de virulentes
critiques. C’est que le sujet, sous son apparente banalité, est
sensible, et qu’il permet de remettre en cause tout un système
de valeurs (morales, sociales…) en même temps que d’en être
une dénonciation radicale. Ainsi dans l’œuvre de Duras où il
n’y a guère de mariages heureux, ou peu, ou provisoirement,
car le bonheur conjugal se vit dans la hantise de sa précarité et
le ressouvenir permanent de son âge d’or, de ses premières réti-
cences, comme dans Détruire dit-elle où Stein se désole rétros-
pectivement de son mariage : « Même si je me suis prêté à la
comédie du mariage, je n’ai jamais accepté sans ce hurlement
intérieur du refus. Jamais. » Heureux, s’il arrive jamais que des
couples le soient, ce n’est jamais que pour exhiber les failles et
les limites du bonheur conjugal, en attiser le regret ou l’espérer
ailleurs. Duras fustige l’idée que l’on puisse faire du couple
un modèle admirable, digne de fi gurer l’Amour, de sorte que
l’association de deux êtres, à ses yeux, ne s’établirait que sur la
[27]
[un amour sans morale ?]
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%