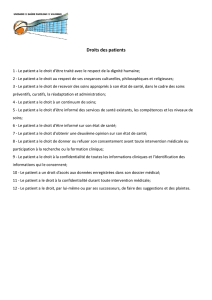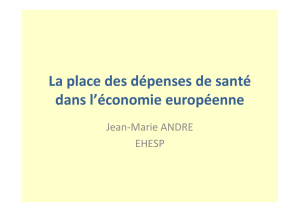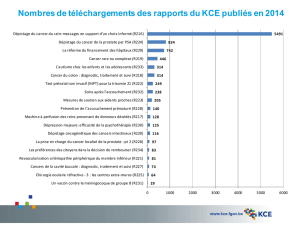Diagnostics Prévisions et Analyses Économiques

Diagnostics Prévisions
et Analyses Économiques N° 71 – Mai 2005
Analyse économique de la prévention des risques pour la santé1
1. Ce document a été élaboré sous la responsabilité de la Direction Générale du Trésor et de la Politique Économique et ne reflète pas nécessairement
la position du Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
Qu'il s'agisse de la conception des programmes de prévention des risques pour la santé ou de leur
sélection, la contribution de l'analyse économique est essentielle. Son apport tient notamment au fait
qu'elle permet de mettre en avant des considérations d'efficacité et d'efficience. A ce titre, les enseigne-
ments que l'on peut en tirer contribuent à nourrir et éclairer le débat public, dans un domaine où les
décisions reflètent fortement des choix de société.
•La première justification du recours à l'analyse économique dans le champ de la prévention tient à la
compréhension et à la caractérisation des comportements qu'elle permet. Pendant longtemps, la
connaissance des comportements a été négligée et les politiques de prévention ont été définies sans
s'interroger sur la capacité réelle des programmes mis en place à infléchir ces comportements. Un
changement de paradigme peut toutefois être récemment noté (cf. la lutte contre les drogues ou les
programmes de réduction des facteurs d'obésité). L'analyse économique permet de conforter cette
évolution en contribuant à préciser les déterminants des comportements face aux risques. Elle aide
aussi à cerner les incitations que les individus peuvent avoir à adopter ou à valoriser des comporte-
ments préventifs. Une telle démarche permet de mieux comprendre la réactivité de la population aux
différents leviers mobilisables (informationnels, financiers, organisationnels), et sur cette base, de les
concevoir de façon à assurer leur plus grande efficacité sur les comportements et in fine leur plus
grand impact sanitaire.
• L'autre aspect sur lequel l'analyse économique se révèle essentielle est celui de l'évaluation et de la
sélection des programmes de prévention. Dans ce domaine, l'analyse économique offre plusieurs
outils (comme les analyses coût-efficacité et coût-bénéfices) permettant d'apprécier l'intérêt des pro-
grammes de prévention et de les classer en fonction de leurs retombées (immédiates et secondaires,
sanitaires - au sens d'amélioration de l'état de santé la population et/ou de son espérance de vie - et
économiques). Ces éléments constituent alors un fondement sur la base duquel il est possible d'ali-
menter le débat sur la définition de priorités en santé. Ils permettent en outre de renseigner sur un
usage optimal (en termes de bien-être) des ressources publiques allouées à la prévention. Le recours
à l'analyse économique, dont les fondements peuvent être contestés notamment sur un plan éthique,
permet d'enrichir le débat d'experts qui doit légitimement fonder la décision publique. En parallèle,
l'analyse économique permet d'éclairer une seconde problématique : celle du seuil de risque sociale-
ment acceptable par une collectivité et par suite du niveau d'investissement en prévention souhaita-
ble. Ce point est essentiel pour la fixation d'objectifs dans la réduction des risques pour la santé.

2
Avril 2005 n°70 • Quelle lecture faire de l’évolution récente des exportations françaises ? Antoine Deruennes
n°69 • Taux d’épargne : quel lien avec les indicateurs de confiance de l’Insee ? Abdenor Brahami
n°68 • Retour sur les évolutions récentes des dépenses en faveur du logement, Frédéric Gilli,
Bertrand Mourre
n°67 • Les anticipations des entrepreneurs industriels de la zone euro sont-elles «rationnelles» ?,
Emmanuel Michaux
Mars 2005 n°66 • La situation économique mondiale au printemps 2005, Pierre Beynet, Nathalie Fourcade
n°65 • Les déterminants des taux longs nominaux aux États-Unis et dans la zone euro,
Sébastien Hissler
n°64 • L'activité aux États-Unis est désormais aussi stable que dans la Zone Euro, Charles-
Antoine Giuliani
n°63 • Les taux marginaux d'imposition : quelles évolutions depuis 1998 ? Ludivine Barnaud,
Layla Ricroch
Fév. 2005 n°62 • Effets macro-économiques à long terme d’un changement d’assiette de la taxe profes-
sionnelle, Emmanuel Bretin
n°61 • Les particularités de la reprise de 2003 en zone euro, Alexandre Espinoza,
Jean-Marie Fournier
Janv. 2005 n°60 • La conjoncture belge : révélatrice de la conjoncture de la zone euro ? Marceline Bodier,
Éric Dubois, Emmanuel Michaux
n°59 • Prix à la production et à la consommation dans le secteur agroalimentaire, Anna Lipschitz
n°58 • Affirmative action et discrimination positive, une synthèse des expériences américaine et
européennes, Denis Maguain
Déc. 2004 n°57 • L’existence d’un biais dans les anticipations de marché sur la politique monétaire en zone
euro, Sébastien Hissler
n°56 • Comment expliquer l’évolution récente du compte courant de la France, Élie Girard
Nov. 2004 n°55 • Les délocalisations d’activités tertiaires dans le monde et en France, Jérôme Letournel
n°54 • Les effets économiques du prix du pétrole sur les pays de l’OCDE, Nicolas Carnot, Caterine
Hagège
n°53 • Le marché pétrolier, Nicolas Carnot, Caterine Hagège
n°52 • Quelques données internationales sur le temps de travail, Jacques Delorme
Sommaire
des derniers numéros parus

3
La politique de prévention (des risques pour la santé)
a pour objectif d'améliorer l'état de santé de la population en
évitant l'apparition, le développement ou l'aggravation des mala-
dies ou accidents (loi du 4 mars 2002 relative aux droits
des malades et à la qualité du système de santé). Elle
couvre un champ très large et mal délimité, allant de la
limitation des risques infectieux à la lutte contre les ris-
ques d'extension ou de complication d'une pathologie
(exemple des règles d'alimentation prescrites en cas
d'hypertension artérielle), en passant par la lutte con-
tre les pratiques addictives (alcoolisme, tabagisme,
toxicomanie) et les conduites à risque (malnutrition,
insécurité routière) ou la réduction des risques liés au
développement urbain, technologique et industriel
(exemple des risques iatrogènes, alimentaires et de
pollution).
Les actions de prévention visent à modifier certains
comportements (individuels et collectifs) ou à amélio-
rer l'environnement dans lequel vit la population.
Elles peuvent requérir un recours au système de santé
mais celui-ci n'est, en raison de la pluralité des déter-
minants de la santé, pas toujours nécessaire ni souhai-
table. La lutte contre l'obésité en atteste : il est
aujourd'hui reconnu que les facteurs de malnutrition
sont avant tout d’origine comportementale et socié-
tale et qu’appréhender le problème sous son seul angle
médical est réducteur et inéfficace.
Sur ces différents types de prévention, l'analyse éco-
nomique offre des outils opérationnels permettant
l'intégration de deux considérations importantes : la
recherche d'efficacité et d'efficience. Tout en recon-
naissant les précautions et limites qu'elle impose, on
fait ici le point sur les principaux apports de l'analyse
économique. On traite d'abord de sa capacité à amé-
liorer l'efficacité des programmes de prévention, sur la
base d'une meilleure compréhension des comporte-
ments individuels puis de son apport pour enrichir la
réflexion sur l'utilisation des ressources publiques
consacrées à la prévention : définition de priorités et
définition d'objectifs de santé publique.
1. Accroître l'efficacité des programmes de
prévention engagés : les enseignements
tirés de l'analyse des comportements
individuels
L'analyse économique a pour avantage de permettre
de caractériser les comportements individuels. Profi-
tant des enseignements des autres sciences sociales
(comme la psychologie et la sociologie par exemple),
des évaluations, des retours d'expériences et des tra-
vaux de santé publique, elle permet de comprendre
quels sont les déterminants des comportements indi-
viduels face aux risques, quelles incitations permettent
de les modifier et de promouvoir des comportements
préventifs. Classiquement, on distingue trois leviers au
moyen desquels les individus peuvent être sensibilisés
aux questions de prévention : les leviers information-
nels, financiers et organisationnels. A ceux-ci, il peut
être ajouté le levier réglementaire qui ne sera pas traité
ici.
1.1 L'efficacité des leviers informationnels
Le premier levier mobilisable par le décideur public
est la diffusion d'informations sur les risques que les
individus encourent ou font encourir aux autres.
L'analyse économique montre que pour être efficace,
il importe au préalable de comprendre les fondements
des comportements individuels et la façon dont
l'information fournie est susceptible de les affecter.
L'analyse économique met en évidence l'importance
des facteurs individuels et subjectifs dans la décision
d'adopter un comportement préventif ou risqué
[LOUBIERE et al. (2004)]. En particulier, elle montre
que la façon dont individus pondèrent les bénéfices et
risques peut rendre optimale, aux yeux de certains,
une prise de risque2. Plus précisément, elle rend
compte du poids prépondérant, dans la rationalité des
individus, des facteurs suivants : (i) le taux d'actualisa-
tion c'est-à-dire la préférence des individus pour le
présent, (ii) la perception qu'ils ont des risques encou-
rus, de leurs conséquences sur leur "capital santé"
(perte d'état de santé, souffrance) et de leur caractère
de bien irrécupérable, (iii) l'idée qu'ils ont des effets
d'un comportement préventif et notamment du lien
entre effort de prévention et probabilité de surve-
nance d'un risque. Ces éléments, à l'origine de com-
portements différenciés face aux risques, sont
influencés par les caractéristiques individuelles
comme l'âge, le niveau de connaissance ou d'éduca-
tion.
C'est cette compréhension des comportements face
aux risques qui donne aux campagnes de communica-
tion un sens et une raison d'être : modifier le calcul
individuel en faisant en sorte que l'information véhi-
culée soit suffisamment personnalisable pour agir sur
l'un de ces facteurs. De ce constat, il est possible de
tirer quatre enseignements importants.
• Le premier est que la compréhension comme la
modification des comportements individuels n'est
pas aisée. Une illustration en est la difficulté de
maîtriser l'étendue des éléments susceptibles d'agir
sur la perception des risques. Dans la lutte contre
le sida, GEOFFARD ET MECHOULAN (2004)
montrent, à partir d'une expérience naturelle en
Afrique, que le fait de proposer des tests de dépis-
tage a entraîné une plus grande prise de risque de
la part de ceux qui y ont eu recours, attestant d'une
forme de substitution entre prévention primaire
(usage du préservatif) et prévention secondaire
(test de dépistage)3.
2. C'est typiquement le cas de la décision de fumer qui peut s'expli-
quer, en autres, par la sous-évaluation du coût de la dépendance et
des risques sanitaires encourus et la sur-pondération des plaisirs
présents.
3. Autre exemple : en matière de sécurité routière, il est parfois
avancé que les améliorations proposées par les constructeurs auto-
mobiles (airbag, ABS…) ont pu contribuer à renforcer le sentiment
de sécurité des conducteurs et induit une baisse du risque perçu.

4
• Le deuxième enseignement est qu'une meilleure
compréhension des comportements doit consti-
tuer un préalable à toute action de communication.
Cet aspect a longtemps été négligé (l'histoire de la
lutte contre la toxicomanie en atteste) et justifie le
changement de paradigme récemment observé
dans ce domaine, avec la révision du périmètre des
drogues notamment4.
• Le troisième enseignement est que l'efficacité des
signaux envoyés est conditionnée à la forme qu'ils
prennent. Aussi, pour atteindre les objectifs fixés, il
est indispensable de réfléchir :
– au type d'information véhiculée de façon à
cibler celle qui est la mieux à même d'influencer
les comportements du public visé (à titre
d'exemple, il est plus efficace de communiquer
auprès des jeunes sur l'impuissance sexuelle que
peut provoquer le tabagisme que sur les risques
de cancer du poumon),
– au degré de ciblage de la campagne (population
totale, frange ou sous-frange de la population),
au type d'acteurs-relais (secteur associatif, milieu
scolaire, professionnel, médical…) les mieux à
même de relayer la politique localement ou indi-
viduellement (la lutte contre l'obésité atteste par
exemple d'une récente remise en cause de la
nature des acteurs-relais mobilisés : alors que le
corps médical a longtemps été en première
ligne, la compréhension des comportements de
malnutrition et de leurs déterminants socio-cul-
turels a conduit à valoriser le rôle de la famille,
des écoles, du milieu associatif et des collectivi-
tés territoriales ; cf. le Plan National Nutrition
Santé et l'expérience «Fleurbaix Laventie»),
– à l'inscription dans le temps de la prévention
menée (campagne ponctuelle ou discours récur-
rent et continu).
• Le quatrième enseignement est que l'hétérogénéité
des réactions implique, dans une logique d'effica-
cité, de combiner simultanément plusieurs types de
politiques informationnelles. ETILE (2004) mon-
tre par exemple que la lutte contre le tabagisme
auprès des adolescents gagne en efficacité dès lors
que l'on distingue deux publics : les fumeurs
"légers" et les fumeurs "plus endurcis". Les pre-
miers sont en effet davantage sensibles aux campa-
gnes d'information médiatique alors que pour les
seconds, ce sont les discussions entre pairs (exem-
ple des groupes de parole pour l'éducation à la
santé) qui se révèlent le plus efficace5.
1.2 L'efficacité des leviers financiers
Une autre façon d'amener un individu à modifier son
comportement consiste à accroître le coût budgétaire
que sa prise de risque lui fait individuellement suppor-
ter. Plusieurs moyens sont mobilisables, selon que l'on
cherche à rendre coûteux le comportement présent
(exemples des taxes sur le tabac ou l'alcool, des con-
traventions pour insécurité routière) ou les consé-
quences probables de celui-ci (conditionnement de la
prise en charge des soins au respect d'un comporte-
ment préventif). La démarche parallèle peut être
entreprise en associant à un comportement de préven-
tion un gain monétaire (système de bonus), sa gratuité
(cas de vaccins, des programmes de prévention
bucco-dentaires chez l'enfant, des tests de dépistage),
ou la réduction de son coût immédiat (exemple de la
baisse du coût des produits de sevrage tabagique).
La littérature économique a largement étayé l'impact
des coûts directs sur les comportements, les études
précurseurs en ce domaine ayant été engagées dans le
domaine de la lutte contre le tabac. Il est couramment
avancé qu'une hausse de 1% du prix des cigarettes
entraîne une baisse de 0,4% de leur consommation
totale. Mais les hausses de prix du tabac ont également
un effet différencié sur les ménages selon leur niveau
de revenu et l'augmentation des taxes sur le tabac a des
conséquences redistributives non négligeables
[GEOFFARD (2003]. Parallèlement, son efficacité
varie selon les publics (elle semble sans effet sur le
tabagisme féminin et sur les adolescents les plus âgés)
et induit plus une réduction du nombre de fumeurs
que du nombre de cigarettes fumées par fumeur
[RECOURS (1999)]. Ce constat confirme la nécessité
d'associer à ce type de politique d'autres actions de
prévention.
L'impact des modalités de prise en charge est plus dif-
ficile à évaluer. D'un côté, on constate que la gratuité
des soins préventifs n'incite pas nécessairement à plus
de prévention (cf. l'étude du CREDES (2002) sur le
bilan bucco-dentaire mis en place par l'assurance
maladie à destination des adolescents). D'un autre
côté, les comportements semblent peu influencés par
les conditions de prise en charge des soins curatifs (la
consommation de tabac ne dépend pas au premier
chef du taux de prise en charge par l’assurance maladie
du cancer du poumon). Sur ce point, il semble toute-
fois qu'une couverture globale ait pour effet d'encou-
rager les comportements de prévention primaire (de
type vaccination) et secondaire (de type dépistage) du
fait d'un plus grand recours au système de soins.
4. Dans la lutte contre la toxicomanie, les programmes ont longtemps
mis l'accent sur l'interdit et la loi et valorisé un discours unique,
négligeant de fait les déterminants du comportement d'addiction et
l'extrême diversité des situations. Depuis près de 10 ans, un chan-
gement de paradigme peut être observé. En attestent la récente révi-
sion du périmètre des drogues, incluant tabac et alcool, qui a permis
de placer le problème de la dépendance au cœur des dispositifs et
d'intégrer la question des polyconsommations, la diversification
des messages et le souci d'être le plus en conformité avec les expé-
riences rencontrées ou encore, les programmes d'études engagés
dans le but de suivre au mieux les évolutions de consommation.
5. Pour le premier groupe, une campagne d'information médiatique
équivaut à une hausse de prix de 6% des cigarettes. Pour le second,
l'impact obtenu de discussions entre pairs est équivalent à une
hausse de prix de 25%.

5
La littérature met traditionnellement en avant le risque
moral ex ante induit par le fait de se savoir assuré et jus-
tifie, par ce biais, le recours à un mécanisme de fran-
chise. Mais, BARDEY ET LESUR (2004) montrent
que ce risque est annihilé dès lors que les individus
accordent suffisamment d'importance à leur état de
santé et tiennent compte du caractère de bien irrem-
plaçable du capital-santé et des coûts non monétaires
de la maladie. Lorsqu’aucune différentiation n'est faite
entre ce qui est de l'ordre du curatif et du préventif
(exemple d'une franchise par acte), l'impact d'un reste à
charge6 est en outre incertain. Il peut en effet tout
autant inciter à un comportement préventif (aller se
faire vacciner pour éviter de supporter les frais de
soins curatifs) que le limiter (éviter le coût des consul-
tations nécessaires à la vaccination).
1.3 Les leviers organisationnels
L'efficacité d'une politique de prévention dépend,
souvent de façon fondamentale, de la capacité des
acteurs-relais à promouvoir les messages préventifs
véhiculés. De fait, les incitations mises en place pour
garantir l'implication et le professionnalisme de ces
acteurs sont essentielles7. Nous prenons l'exemple de
la sensibilisation des professionnels de santé aux ques-
tions de prévention pour rendre compte du type de
leviers organisationnels potentiellement mobilisables
et étudions l'influence des modalités d'exercice de la
médecine (mode de tarification et d'exercice, notam-
ment) sur la façon dont les actes de prévention sont
valorisés auprès des patients. L'analyse économique
du comportement des offreurs de soins apporte plu-
sieurs enseignements importants.
Le premier moyen d'action concerne les règles de res-
ponsabilité (civile ou pénale) imputables aux profes-
sionnels et établissements de santé. Parce qu'elles
modifient la prise de risque des professionnels, il est
possible, par leur intermédiaire, d'inciter ceux-ci à
davantage de prudence et donc de réduire les risques
d'accidents médicaux. Le degré de responsabilité fixé
doit être incitatif sans pour autant conduire à valoriser
une logique de médecine défensive qui conduirait les
professionnels à favoriser certaines pratiques unique-
ment pour échapper aux risques de poursuite.
Le deuxième levier concerne le mode de rémunération
des professionnels (paiement à l'acte versus capitation
ou salariat, budget global versus tarification à l'acti-
vité). Parce qu'elle influence l'allocation de leur temps
disponible entre soins curatifs et soins préventifs, la
tarification des médecins et des établissements doit
être considérée comme un élément essentiel des poli-
tiques de prévention dans lesquelles leur rôle est déci-
sif. En médecine ambulatoire, FRANC ET LESUR
(2004) estiment que la capitation incite plus spontané-
ment les professionnels à faire de la prévention. La rai-
son tient au fait que les médecins internalisent les
effets à long terme des actes préventifs sur leur acti-
vité. En effet, s'ils anticipent qu'une attitude préven-
tive peut conduire à réduire le nombre d'actes curatifs
par patient, promouvoir la prévention permet de
réduire le temps consacré à chaque patient, donc
d'augmenter le nombre de patients inscrits et par suite
leur revenu. Ce schéma peut toutefois être remis en
cause dans certains cas précis (exemple de pathologies
fortement consommatrices en temps de prévention).
Dans ces cas, les auteurs préconisent le versement
d'une rémunération spécifique à l'acte, à l'instar des
mesures entreprises au Royaume-Uni ou en Norvège.
Dans un système de paiement à l'acte, les actes curatifs
entrent en concurrence avec les actes préventifs.
Aussi, pour promouvoir la médecine préventive, il est
nécessaire de la rémunérer autant, sinon mieux, que la
médecine curative. Comme le Québec et le Dane-
mark, la France s'est récemment dotée d'une "consul-
tation médicale périodique de prévention" (loi de
santé publique).
Un autre moyen d'agir en faveur de la prévention con-
siste à façonner dans le sens voulu le contenu du con-
trat signé par les professionnels de santé avec
l'assureur (exemples de contrats reposant explicite-
ment sur des contreparties en terme de qualité et de
respect de référentiels ou protocoles ou de la logique
de conventionnement sélectif). Le développement en
France des accords de bon usage des soins et des con-
trats de santé publique va dans ce sens.
Enfin, et de façon plus générale, la promotion de la
prévention passe par l'amélioration de la formation en
santé publique, par une meilleure répartition des com-
pétences entre professionnels de santé, médecins et
infirmières notamment, à l'instar de ce qui s'est fait au
Royaume-Uni, au Québec ou en Finlande, et une prise
en charge et un suivi des patients rénovés dans le
cadre d'une médecine plus coordonnée où l'activité de
prévention est organisée ou dans le cadre de program-
mes de suivi spécifique des pathologies chroniques
dans lesquels le rôle du patient dans la gestion de sa
maladie est valorisé.
2. Garantir l'intégration des considérations
d'efficacité et d'efficience dans le choix
des programmes de prévention
L'autre champ sur lequel l'analyse économique se
révèle particulièrement utile est celui de l'évaluation et
de la sélection des programmes de prévention. Tant le
poids économique de ceux-ci que leurs enjeux sanitai-
res justifient que l'on cherche à comparer les retom-
bées et que l'on s'intéresse à l'efficience avec laquelle
les ressources publiques sont utilisées dans ce
domaine.
Selon les comptes nationaux de la santé, les dépenses
de prévention s'élèvent en 2002 à 3,6Md€, soit 2,3%
de la dépense courante de santé. Cette estimation ne
recense toutefois qu'une partie des ressources consa-
crées à la prévention des risques pour la santé8. Cher-
chant à identifier au sein des consommations
6. remboursement partiel des actes.
7. Hormis la question de la mise en place d'incitations adéquates, se
pose aussi le problème de la coordination des acteurs-relais et de la
compatibilité de leurs incitations, notamment lorsque ceux-ci évo-
luent dans des sphères très différentes (cf. la pluralité des acteurs-
relais potentiellement mobilisables).
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%