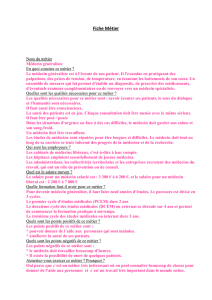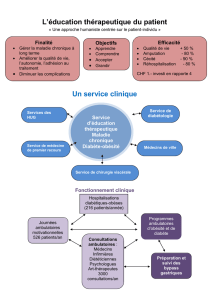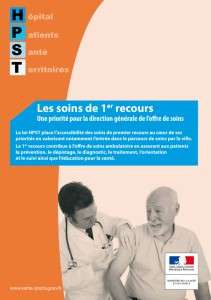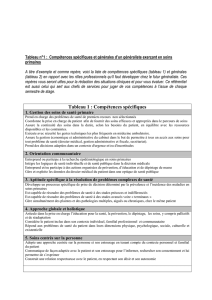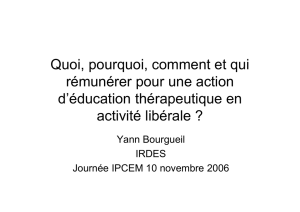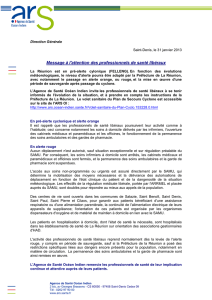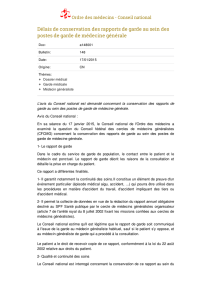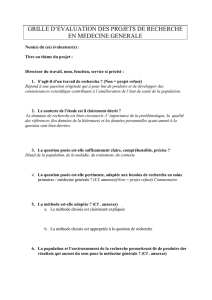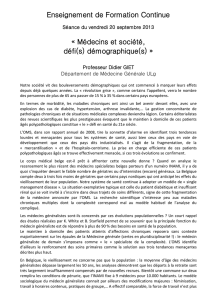Médecine et soins de proximité

Médecine et
Soins de
proximité
Propositions formulées à l’occasion de la mission confiée par Monsieur le
Président de la République à Madame Elisabeth Hubert, Présidente de la
Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile.

28 juillet 2010
2

28 juillet 2010
3
Sommaire
Introduction................................................................................................................5
1. Les définitions et les approches organisationnelles de l’exercice
médical de terrain ne permettent pas de répondre au défi que
constitue aujourd’hui la réponse aux besoins de santé de proximité
tels qu’ils sont exprimés par les usagers du système de santé ...........................6
1.1. Les définitions de la médecine de proximité constituent autant de
références utiles................................................................................................6
1.1.1. Les soins de santé primaires. .....................................................................6
1.1.2. Les soins de proximité ................................................................................7
1.1.3. Les soins de premier recours .....................................................................7
1.2. Les modes organisationnels de la médecine de proximité font apparaître
une offre variée mais dont les éléments sont seulement juxtaposés
sans véritablement de liens entre eux...............................................................8
1.2.1. L’exercice isolé ...........................................................................................8
1.2.2. Les maisons de santé.................................................................................8
1.2.3. Les réseaux de santé..................................................................................9
1.2.4. Les centres de santé...................................................................................9
1.2.5. Les pôles de santé....................................................................................10
1.3. C’est l’approche des besoins des populations qui doit conduire la
réflexion sur la médecine de proximité............................................................10
1.3.1. Le critère géographique............................................................................10
1.3.2. Le critère financier ....................................................................................10
1.3.3. Le critère des besoins de prise en charge ................................................11
1.3.4. Le critère des approches populationnelles................................................11
2. La médecine de proximité doit avoir pour ambition de prendre toute
sa part pour relever le défi des réponses nouvelles adaptées à de
telles attentes...........................................................................................................12
2.1. Garantir l’existence d’une équipe de soins pour un nombre donné
d’habitants ......................................................................................................12
2.2. Confirmer la place du médecin généraliste au cœur de l’offre de
soins de proximité...........................................................................................12

28 juillet 2010
4
2.3. Développer la coopération interprofessionnelle et interdisciplinaire
au sein de structures de soins unifiées...........................................................14
2.3.1. Moderniser et développer les centres de santé ........................................14
2.3.2. Améliorer la liaison entre les différents offreurs de soins
de premier recours ....................................................................................14
2.3.3. Encourager la réalisation de certains actes médicaux de premier
recours par des professionnels de santé non médecins............................15
2.4. Recourir de façon volontariste aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication...............................................................16
2.4.1. Encourager la dématérialisation des prescriptions médicales et des
arrêts de travail..........................................................................................16
2.4.2. Développer la télémédecine en tant que facteur d’amélioration du
service rendu aux usagers du système de santé.......................................16
2.4.3. Offrir rapidement à chaque citoyen qui le souhaite un dossier
médical personnel .....................................................................................16
2.5. Généraliser les modes mixtes de rémunération des médecins de
premier recours...............................................................................................17
2.5.1. Poursuivre la démarche des contrats d’amélioration des
pratiques individuelles...............................................................................18
2.5.2. Introduire une rémunération forfaitaire calculée selon le nombre de
patients du médecin généraliste................................................................18
2.5.3. Adapter la rémunération des médecins spécialistes choisis
médecins traitants .....................................................................................18
2.5.4. Préserver la possibilité du paiement à l’acte direct des médecins
« non traitants » et pour certains actes techniques ...................................18
2.5.5. Valoriser davantage les actes de prévention en évaluant leur
efficacité sociale et sanitaire......................................................................19
2.6. Faire évoluer la médecine libérale de premier recours vers une
médecine régulée ......................................................................................... 20
2.6.1. Garantir une répartition territoriale plus équitable des effectifs
médicaux...................................................................................................20
2.6.2. Garantir la permanence des soins............................................................21
Conclusion...............................................................................................................23

28 juillet 2010
5
Introduction
Les années quatre-vingt et quatre-vingt dix ont été marquées par de vives
discussions sur la sécurité sanitaire et les défis des nouvelles épidémies. Notre pays
a su s’emparer de ces interrogations, souvent sous la pression de l’opinion. Il a su
adopter des solutions, non sans succès dans certains domaines, même s’il reste
évident qu’il y a encore du chemin à parcourir et que l’alerte médiatique reste encore
nécessaire.
Aujourd’hui, ce sont les questions de proximité des soins qui motivent l’inquiétude de
nos concitoyens. Pour beaucoup d’entre eux, il est devenu plus commode d’aller
directement aux urgences de l’hôpital que de trouver un médecin susceptible de
prendre en charge leurs besoins de santé à proximité de leur domicile.
Les médecins de ville sont effectivement devenus moins disponibles. Deux raisons
sont principalement identifiées. L’incapacité des pouvoirs publics à anticiper la baisse
de la démographie médicale, sujet pourtant parfaitement prévisible si l’on croise les
données du numerus clausus avec celles de l’âge moyen des médecins. Les
nouvelles attitudes professionnelles qui voient les nouveaux médecins aspirer à des
conditions de travail moins contraignantes que celles connues de leurs pairs.
Le thème des « déserts médicaux » qui a fait l’objet d’enquêtes journalistiques est
bien quotidiennement une réalité vécue par de plus en plus de nos concitoyens. Mais
les ressources médicales ne sont pas seulement devenues plus rares dans les
territoires, elles sont aussi moins présentes dans le temps : la continuité et la
permanence des soins, légitimement attendues de nos concitoyens qui solvabilisent
par leurs contributions le système de santé, en pâtissent trop souvent.
A ces difficultés s’ajoutent aussi les contraintes financières partagées par un nombre
de plus en plus élevé de nos concitoyens qui ne peuvent payer une consultation
tarifée à 22 euros et qui ici encore préfèrent s’orienter vers les urgences
hospitalières. On mesure ici toutes les conséquences de l’inentendable refus de
pratiquer le tiers payant en consultation de ville.
La prise en charge ambulatoire n’a pas évolué de façon parallèle aux nouveaux
besoins des malades. De plus en plus âgés et souvent chronicisés grâce aux
évolutions de la médecine, nos concitoyens réclament plus de coordination de leur
suivi et de leurs soins ambulatoires. Pour fixer les idées, ce qui a été fait pour les
malades lourds hospitalisés à domicile n’a pas été entrepris pour les malades moins
lourdement affectés mais dont la trajectoire de soin est compliquée par les
conséquences de la maladie. L’exercice isolé de la médecine qui reste encore trop
souvent la règle générale ne permet pas de répondre à ces attentes.
Enfin, pour être complet, les solutions attendues des nouvelles technologies de
l’information et de la communication tardent à se déployer alors qu’elles permettent
plus aisément qu’hier de coordonner les soins et d’en garantir la pertinence.
Soigner en proximité, c’est donc le défi de la décennie si nous voulons faire vivre
notre principe républicain d’égalité d’accès aux soins pour tous et partout.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%