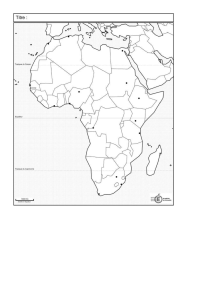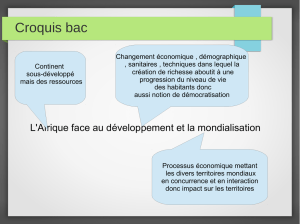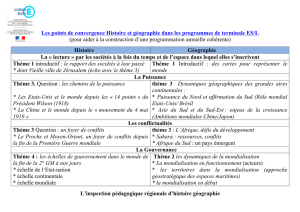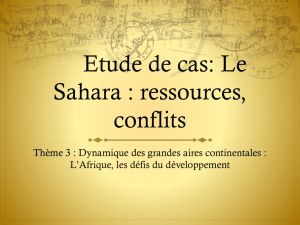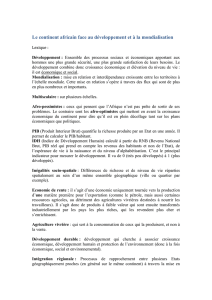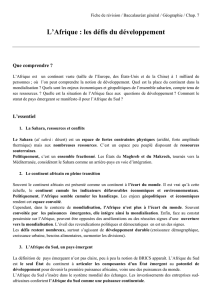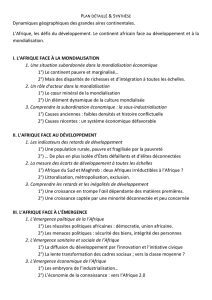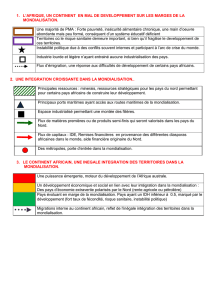Guide de révision

Faculté de Gouvernance, Sciences Economiques et Sociales
1"
"
Guide de révision
à l’usage de la préparation de la Dissertation
de l’épreuve principale
Thématique
Enjeux et dynamique d’un monde nouveau
20ème et 21ème siècle, l’ère des mutations.
Ce document présente un traitement problématisé de la thématique suscitée.
Chacune des 3 sections du guide de révision présente une démonstration facilitant
la compréhension et l’assimilation des connaissances du programme d’Histoire et
Géographie du cycle secondaire, toutes filières confondues.
Section 1 – L’AFRIQUE : les défis du développement
!..................................................!2
!
Section 2 – Dynamiques et enjeux d’un espace mondialisé : l’inégale
intégration des hommes et des territoires dans la mondialisation
!........................!21
!
Section 3 – Le proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la
seconde guerre mondiale
!....................................................................................................!35
!
Période académique : 2016/2017

Faculté de Gouvernance, Sciences Economiques et Sociales
2"
"
Section 1 – L’AFRIQUE : les défis du
développement
PLAN DU COURS
Introduction.
I°) Le désert du Sahara : ressources et conflits (étude de cas).
A) Le désert du Sahara : un milieu contraignant mais riche en ressources
convoitées.
B) Un ensemble politiquement fractionné, mais parcouru par un nombre croissant
de flux de circulation.
C) Un espace de multiples tensions et conflits.
II°) L’Afrique, un continent à l’écart du développement et du monde ?
A) Un continent qui cumule les indicateurs défavorables.
B) Des freins multiples au développement.
III°) Une intégration marginale mais croissante dans la mondialisation.
A) Une meilleure intégration du continent dans la mondialisation (…)
B) (…) Même si tous les pays ne sont pas touchés de la même façon.
IV°) D’importants défis à relever.
A) Faire face à la croissance démographique et urbaine la plus forte de la planète.
B) Faire face aux problèmes de dégradation de l’environnement.
C) Faire face aux divisions et au manque d’intégration régionale.
Conclusion
Bibliographie

Faculté de Gouvernance, Sciences Economiques et Sociales
3"
"
L’Afrique : les défis du développement.
Introduction
■ L’Afrique est un continent d’un milliard d’habitants. Elle rassemble 54 Etats en
incluant les îles de l’océan Indien, des centaines de langues, une grande diversité de
climats et de paysages, le tout sur 7 600 km de Tunis au Cap.
■ Au XIXème siècle, elle est perçue par les Européens comme un continent inférieur.
Encore aujourd’hui, l’Afrique cumule les indicateurs économiques, sociaux et
environnementaux défavorables auxquels s’ajoutent de multiples conflits locaux et
des problèmes de gouvernance… ■ Pourtant, le continent africain n’est pas
homogène en termes de développement et les situations ne sont pas figées. Des
formes de décollage économique existent, malgré la persistance de problèmes aigus.
De même, on ne peut plus considérer que l’Afrique est à l’écart du monde…
Par conséquent, au cours de ce chapitre, on se posera les questions
suivantes :
→ Quelle est la situation de l’Afrique face aux questions de
développement ?
→ Le continent connait-il un réel décollage économique ?
→ Quels défis l’Afrique doit-elle encore relever ?
I°) Le désert du Sahara : ressources et conflits (étude de cas).
■ Le Sahara (« al-sahrà » soit le désert en arabe) est le plus grand désert du monde
avec 8,5 millions de km². Il s’étend de l’Atlantique à la mer Rouge sur une dizaine
d’Etats (dont aucun n’est entièrement saharien) et sépare l’Afrique du Nord de
l’Afrique subsaharienne.
■ Au Moyen-Age, le désert du Sahara connaît un important commerce caravanier
entre la côte méditerranéenne et l’Afrique noire. Mais, avec le développement du
commerce maritime à partir du XVIème siècle et la colonisation européenne au
XIXème siècle, cet espace se trouve marginalisé.
Depuis une dizaine d’années, le désert du Sahara revient sur la scène géopolitique et
médiatique… : il devient une zone de compétition entre les pays du Nord et les pays
émergents pour s’approprier ses richesses minières et énergétiques – il se voit
traverser par des flux migratoires clandestins – il voit le développement de trafics en
tous genres – il voit l’installation de groupes terroristes islamistes…
■
Dès lors, on pourra se poser les problématiques suivantes :

Faculté de Gouvernance, Sciences Economiques et Sociales
4"
"
→ Quels sont les enjeux économiques et géopolitiques de
l’ensemble saharien au regard des ressources qu’il recèle ?
→ Quelles sont les multiples convoitises qui s’y manifestent ?
■ Le désert du Sahara est un espace de fortes contraintes, mais disposant
d’importantes ressources convoitées. Politiquement fractionné, il est cependant
parcouru par un nombre croissant de flux de circulation. Et ainsi, cet espace est
soumis à de multiples tensions et conflits.
A) Le désert du Sahara : un milieu contraignant mais riche en ressources
convoitées.
1- Quelles sont les caractéristiques climatiques du désert du Sahara ? Ce milieu
vous paraît-il contraignant pour l’installation humaine ?
Le climat saharien est un climat tropical aride ou subaride toute l’année ; on peut aussi
le qualifier de climat désertique. Les précipitations annuelles sont inférieures à 200
mm par an voire 100 mm. Les températures atteignent des records de chaleur ; plus
de 21° de moyenne annuelle à Tamanrasset (Algérie). Ce désert s’explique par sa
position en latitude : l’anticyclone du Sahara fait peser un air subsident sec et chaud
sur le tropique du Cancer.
Ainsi, le désert du Sahara est un milieu très contraignant. Aridité, déserts de sable
(ergs), déserts rocheux (regs) rendent la présence humaine difficile en dehors des
oasis (1/1 000ème de la surface du désert du Sahara) d’autant que les contrastes
thermiques sont très importants (38°C en été, 8°C en hiver). D’ailleurs, cet espace est
peu peuplé puisqu’il compte à peine 7 millions d’habitants. Avec à peine 1 hbt par
km² on peut parler de désert humain.
2- Quels sont les différents types de ressources offerts par le désert du Sahara ?
Et où se localisent-elles ?
En contrepoids à ces fortes contraintes, le sous-sol du désert du Sahara est riche en
ressources souterraines. On n’y trouve : de l’uranium au Niger, du fer en Mauritanie,
du phosphate et de la potasse en Tunisie et au Maroc, des hydrocarbures (pétrole et
gaz naturel) en Algérie, Lybie et au Soudan et de grands aquifères, nappes profondes
d’eau tombée au dernier épisode pluvial de l’ère quaternaire. Naturellement, il y a
aussi quelques eaux de surface avec les oasis comme celles de Tamanrasset en
Algérie ou du Fayoum en Egypte et le Nil seule eau de surface courante qui prend sa
source dans la région des grands Lacs et traverse ensuite le désert jusqu’à la
méditerranée.
Le désert du Sahara est aussi propice au tourisme d’aventure pour des populations à
fort pouvoir d’achat qui recherchent des « espaces de sérénité ».
Le désert du Sahara est aussi dans la possibilité de devenir une zone d’énergie solaire
non négligeable pour les pays de la région. L’idée de profiter de l’immense capacité

Faculté de Gouvernance, Sciences Economiques et Sociales
5"
"
solaire du désert saharien a été lancée en 2009 par des ingénieurs allemands. Ils ont
imaginé de grandes centrales solaires qui expédieraient leur courant à travers des
câbles sous-marins vers l’Union européenne. Mais l’ampleur des investissements et
l’instabilité politique de la région rendent le projet utopique.
3- En quoi cette richesse est-elle fragile ?
Cette richesse est fragile pour plusieurs raisons :
- Ces ressources (nappes aquifères – énergies fossiles) sont des ressources
fossiles, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas renouvelables et s’épuisent au fur et à
mesure de leur exploitation. Par exemple, selon les endroits, entre 1950 et 2000,
la nappe d’eau fossile a été rabattue de 25 à 50 mètres…
- Ces ressources sont difficiles à exploiter en raison des contraintes physiques du
milieu. Il faut maîtriser l’accès à l’eau dans les lieux d’extraction et relier ces
gisements aux foyers de consommation qui sont relativement éloignés (Europe,
Amérique du Nord, Asie). Il faut donc faire des aménagements couteux et de de
grande ampleur tels que les stations de pompage, les aqueducs, les grands
canaux d’irrigation… (exemples : les Etats Libyen et Egyptien ont construit de
très nombreux aménagements pour maîtriser leurs ressources en eau pour
développer leur agriculture…).
- Ces ressources sont difficiles à exploiter en raison de l’insécurité de la région.
Idem pour le tourisme qui est très vulnérable aux tensions politiques intérieures
et internationales.
- Ces ressources ont des prix très fluctuants par rapport aux marchés ; ce qui rend
sensible les économies locales (économies de rentes).
4- Le désert du Sahara est donc un enjeu géoéconomique mondial
important. Qui convoite aujourd’hui ses ressources abondantes et vitales…
Donc, le désert du Sahara est devenu un espace aux enjeux géoéconomiques
mondiaux importants…
Le désert du Sahara est convoité pour l’exploitation de ses ressources et ce qui
l’accompagne : construction de mines, construction d’usines, investissements
financiers (IDE)…
Le désert du Sahara est convoité par : les grandes multinationales des pays
développés et des pays émergents – les Etats bordiers du désert du Sahara – les
groupes intra-étatiques ; ethnies, populations locales nomades, groupes de
trafiquants…– les grands Etats du monde (France, Grande-Bretagne / anciens pays
colonisateurs, Etats-Unis, Chine…). Chacun veut en tirer le plus d’avantages
possibles…
Par exemple, les multinationales chinoises en lien avec leur Etat signent des
conventions avec les pays de la région… Si les multinationales chinoises obtiennent
des concessions pour exploiter telle ou telle ressource, en échange elles construiront
des infrastructures diverses pour les populations locales ; on appelle cela la
« diplomatie » du cadeau.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
1
/
51
100%