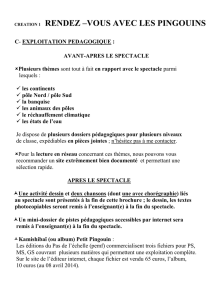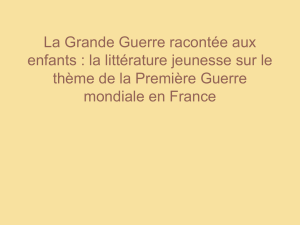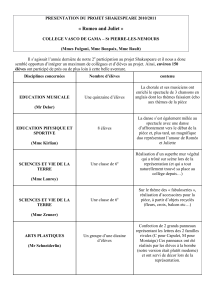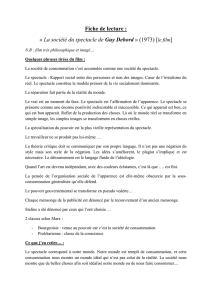31 mars 2010 - Yan Duyvendak

EDITO
NOus sOmmEs TOus DEs EThNOgraphEs hybrIDEs.
C’est avéré, nous ne le savons pas, mais comme Monsieur Jourdain, mais chaque jour un
peu plus, nous sommes tous des ethnographes hybrides. Depuis le début du Festival, nous
plongeons en plein cœur de la réalité, et nous l’écrivons avec nos yeux, nos bouches et nos
oreilles. Paradoxalement, plus les médiations et dispositifs techniques sont présents, plus
elle nous parvient intensément, voire intimement. A regarder l’ensemble des propositions
d’Hybrides, il devient difficile de soutenir que l’art est coupé du réel, comme le suggèrent
pernicieusement les « culturophobes », qui gagnent du terrain depuis quelques années.
Sur les plateaux, en des langages de plus en plus nombreux, s’écrivent des petits bouts de
peuples, et nous en sommes les premiers découvreurs, chroniqueurs, ethnographes de
tous les jours, dimanche compris.
Ecoutez plutôt : la révolte des jeunes, le dialogue avec l’Islam, la rencontre de l’autre, la li-
berté d’agir sous contrainte, le quotidien des classes moyennes face à l’administration, les
violences conjugales, les tremblements de terre, en Haïti, puis au Chili, les satellites, les fu-
nérailles de Milosevic, les procès sans résolutions, nos relations avec la nature… Tous ces
thèmes traversent la constellation des spectacles que vous pouvez voir cette semaine. On
est loin de « l’actualité-de-la-Cerisaie-qui-résonne-si-fort-dans-notre-monde-contempo-
rain ». Une autre époque, une autre manière de faire, qui nous attrape frontalement, capte
nos langues et nos bégaiements, pour tenter d’en proposer quelques instantanés. Et nous
inviter ensuite à prendre position.
EMPREINTE est maintenant bien lancé, vous tenez le numéro3 dans vos mains, il restitue
de nombreuses positions de spectateurs, jeunes et moins jeunes, novices ou vieux routiers.
Nous y retrouvons également deux collectifs au parcours singulier et pour tout dire hybridis-
sime : le collectif Nuz emmené par Anne Joignon, Vivien Sabot et Clément Bardet, et GdRA,
qui rassemble Christophe Rulhes, Sébastien Barrié et Julien Cassier. Et nous avons le plaisir
de publier quelques extraits d’une magnifique conférence donnée dimanche dernier au
CCN par l’astrophysicien Michel Cassé. Une rencontre rare et stimulante, suscitée par Os-
car Gomez Mata, qui s’y connaît lui aussi en matière d’hybridations ! Bonne lecture, et bons
spectacles, je vous laisse avec ce conseil précieux de Franz Kafka : « Il est nécessaire de parler
des danseuses en employant le point d’exclamation. Par là, on imite leur mouvement, on
reste dans leur rythme, on ne trouble pas la pensée dans son plaisir et enfin, l’activité reste
toujours au bout de la phrase, dont l’efficacité se prolonge plus facilement. »
Bruno Tackels
prOgrammaTION
aujOurD’huI
19h Breaking Théâtre de Grammont
19h Artefacto Théatre Jean Vilar
19h Ethnographiques Ancien Lycée Mendès France
19h AJR Un autre jour sans rembobiner Théâtre de Grammont
21h Soupçons Théâtre de Grammont
23h Breaking Théâtre de Grammont
DEmaIN
10h Emulation (master class) La Salle 3
13h Making up Galerie St Ravy
14h Empreinte (rédaction du journal d’Hybrides2) Kawenga
14h La place des anges Café de l’Esplanade
19h Breaking Théâtre de Grammont
19h Too late ! La Chapelle
19h AJR Un autre jour sans rembobiner Théâtre de Grammont
21h Soupçons Théâtre de Grammont
23h Breaking Théâtre de Grammont
ZOOms sur
sENsaTIONs DE spEcTaTEurs
pOINTs DE vuE
Direction De publication : Compagnie Adesso e Sempre - 42 rue Adam de Craponne 34000 Montpellier
réDacteur en chef : Bruno Tackels
Secrétaire De réDaction : Lise Mullot
comité De réDaction : Sandrine Barbiero, Michel Cassé, Yves Flank, Omar-Sabas Gally, Yazgi Giray,
Maeva Guimbi-ngot, Marjolaine Jourdan, Sylvia Lebrun, Sarah Lefèvre, Camille Lopes, Elodie
Massador, Lise Mullot, Jo Papini, Tracy Rodrigo, Christine Tachie, Bruno Tackels
GraphiSte : Christophe Caffier
créDitS photoS : Marc Ginot, Marie Gremillet
Ce journal est imprimé grâce à notre partenaire Arts Hélio
à suivre
1
N'3 - mErcrEDI 31 mars 2010
EmprEINTE
EmprEINTE
Adesso e Sempre présente le festival Hybrides2
du 27 mars au 2 avril 2010 à Montpellier
Réservation : 04 67 99 25 00
Retrouvez l’actu du festival sur http://hybrides.over-blog.com
Contact journal : [email protected]
d'
N'3

ZOOms sur
ENTrETIEN avEc aNNE jOIgNON Du cOllEcTIf NuZ
prOpOs rEcuEIllIs par bruNO TackEls
Le collectif NUZ, c'est quoi, c'est qui?
Le collectif NUZ, c'est d'abord la rencontre entre Vivien Sabot et Clément
Bardet, il y a six ans, à Besançon lors d'une formation aux diplômes des
métiers d'art en régie lumière et son. Au sein du collectif, Vivien Sabot est
régisseur et Clément Bardet s'occupe plutôt de la vidéo. Moi, j'ai rejoint
cette équipe, il y a maintenant deux ans, en tant que comédienne ou « ob-
jet vivant » qui peut travailler avec les machines.
Sauf que là, la comédienne s'éclipse puisque, si je comprends bien,
vous faites du théâtre sans comédien ?
Tout à fait. Tout le travail théâtral et d'enregistrement de voix est fait en
amont du spectacle, qui est entièrement programmé. Nous avons consi-
déré la personne humaine dans l'espace, en amont de cette programma-
tion. J'étais donc le cobaye qui déambulait dans l'espace, la comédienne
jouant le « public ».
Expliquez-nous justement le dispositif. Nous sommes là, dans cet
espace, dans cet appartement interactif. Comment cela se passe
concrètement ?
C'est un parcours individuel. Les gens entrent dans ce que l'on appelle
un « espace de réveil », c'est-à-dire une zone d'immersion, qui permet de
préparer le spectateur à entrer dans cet appartement interactif où de nom-
breux capteurs sont cachés, un peu partout, à l'intérieur des objets.
Donc le spectateur arrive dans cet appartement, et il se déplace dans
cet espace du quotidien, un salon ; il est libre de manipuler les objets
comme il le ferait chez lui. Ses gestes déclenchent, du coup, un cer-
tain nombre d'évènements dans l'espace.
C'est un plus compliqué que cela, dans la mesure où l'on essaie, d'entrée
de jeu, de plonger le spectateur dans cette structure interactive : on va lui
donner des consignes, l'inciter à agir. On va lui donner des pistes pour
le déroulement de l'histoire. Si le spectateur ne touche à rien, l'histoire
ne se déroulera pas. Chaque action, chaque déplacement entraînent une
modification du récit. Et chaque interaction produit une combinaison dif-
férente.
Autrement dit, il peut se passer sur trois heures de temps, cinq, vingt
histoires différentes, et cela ne sera pas forcément la même fiction.
Cela peut même se développer « à l'infini ». Nous avons un certain nombre
d'effets (par exemple 40 interventions téléphoniques), qui se multiplient
et se combinent avec d'autres, en fonction de chaque spectateur, de
chaque parcours, de chaque sensibilité.
Sans déflorer le spectacle, quelle est la thématique que vous avez ex-
plorée dans ce salon, très réaliste, l'intérieur d'un européen moyen,
au sens le plus large.
J'avais envie de relayer des problèmes de société qui me traversent per-
sonnellement. Parmi eux la question du logement. Quand est-ce que tu
peux être mis à la porte ? Qu'est ce qui se passe pour toi ? Quelle est la
suite de ton histoire, si demain on te dit : «il faut que tu quittes ton appar-
tement » ? Est-ce que tu essayes de trouver des solutions pour rester, ou
subis-tu les injonctions administratives extérieures ? C 'était cette série de
questions que j'avais envie d'aborder. J'avais aussi envie d'interroger l'in-
jonction paradoxale, c'est-à-dire le fait que chaque jour nous recevons des
informations contradictoires, qui nous désorientent et nous empêchent
de nous situer. C'est pour cette raison que nous proposons au public
une injonction, suivie d'un ordre contraire, qui va valider ou invalider son
geste. Ce qui pose la question : « Est-ce cela que tu avais envie de faire ?
Est-ce là que tu avais envie d'arriver ? » Tu as fait un choix, et finalement
ce choix peut être remis en question par une suite de combinaisons, par
un système de cause à effet dont tu ne maîtrises pas tous les éléments.
Vous faites un travail sur les aliénations du quotidien, sur notre com-
bat pour rester libre et surmonter tout ce qui vient nous entraver.
Oui, même dans un espace intime, privé, il y a toujours des injonctions
extérieures. L'espace public rentre et vient perturber en permanence ta
bulle ; tu n'es jamais vraiment seul. Ce qui nous intéressait, c'est de plon-
ger un public qui sera seul dans cet espace : il n'y a pas de régisseur, pas
de comédien, et nous observons simplement comment il prend position
par rapport aux diverses injonctions.
Au fond, c'est un peu le K. de Kafka, aujourd'hui à l'heure de l'interac-
tivité, si on veut résumer.
Il y a de ça ! Il y a aussi toute une réflexion sur l'absurde, le mythe de Si-
syphe, les raisons d'une action, leur aboutissement possible, et leur sens.
Quelle croyance mets-tu dans ton pouvoir d'action ? Penses-tu vraiment
pouvoir manipuler ou avoir un impact sur l'histoire, sur ce qui se passe au-
tour de toi ? Ou à l'inverse, est-il impossible d'agir sur les choses, qui se ré-
pètent inlassablement. C'est donc ces questions qu'on essaye d'aborder.
Oui, il faut préciser que c'est une création et que vous êtes d'ailleurs
en train d'imaginer d'autres pièces à cet appartement interactif.
C'est un projet qui est vraiment né en septembre 2009 à Kawenga, où
nous avons eu un premier temps de résidence. Ça a été surtout l'occa-
sion de voir la quantité de travail que représentait un espace interactif.
En terme de programmation, c'est assez énorme. Il faut parler à tout le
monde, c'est-à-dire à la lumière, au son, aux capteurs, qui se répondent
entre eux, et ce de manière perpétuelle. En permanence, il faut que tout le
monde parle à tout le monde.
Ethnographiques
2

Belgrade
« EThNOgraphIquEs »
ENTrETIEN avEc gdra
prOpOs rEcuEIllIs par bruNO TackEls
Un mot sur la genèse de ce regroupement finalement assez im-
probable ?
Nous nous sommes connus il y a sept ou huit ans en travaillant en-
semble sur une création de cirque contemporain pour le CDN de Tou-
louse, Théâtre de la Cité. Projet qui ne s’est pas très bien passé et dont
le metteur en scène a été chassé. Christophe était musicien, Julien,
acrobate-comédien et moi assistant à la mise en scène. Notre amitié
est née suite à ce projet. On a continué à travailler ensemble, on avait
un goût commun pour se poser aux terrasses à Toulouse et prendre un
café au Florida en regardant longuement les gens passer, les hommes
et les femmes.
Une grande part de l’observation quand même ?
Oui, on avait cette curiosité, et on a décidé de créer une compagnie
à trois – pas un collectif, une compagnie, pour raconter des histoires
partant de l’observation des gens que l’on rencontre.
Comment nommez-vous le théâtre que vous faites ? Théâtre docu-
mentaire, théâtre de l’expérience, théâtre social ?
Oui, théâtre documentaire, théâtre anthropologique – du théâtre sur
l’homme. Il y a des universitaires qui le font, on s’inspire de leurs
écrits, on réfléchit, on écrit, au travers du corps, du texte, de la mise en
scène, de la musique.
Le titre de la pièce est « Ethnographiques », l’idée est d’écrire le
peuple, de raconter le peuple, mais ce peuple au fond n’est qu’un
petit bout de peuple.
Etymologiquement, « ethnos », c’est le peuple mais c’est aussi la com-
munauté ; donc on pourrait très bien faire un spectacle sur le 16ème à
Paris ou sur une batterie de cuisine dans un restaurant trois étoiles,
ça nous intéresserait énormément. « L’étiquette populaire » ça n’existe
pas vraiment. Ce qui nous intéresse ce sont « les peuples », l’assem-
blée nationale par exemple
C’est un spectacle sur l’Usine, lieu de fabrication dédié aux arts de la
rue à Toulouse, une singularité ordinaire. C’est un spectacle qui parle
d’une allégro-togolaise, éduquée par des italio-arméniens dans les
quartiers noirs à Marseille. Qui aurait le privilège ou la prétention de
s’extraire de la gent humaine ? Dès qu’on observe quelqu’un, on re-
garde un morceau de peuple, et dés qu’on se rapproche d’une per-
sonne, au fil d’un entretien, d’une rencontre assidue, à long terme on
touche à la personne, à des choses très singulières, particulières, à
l’universel.
Ce qui est très beau dans le spectacle, c’est la démonstration
qu’observer les humains dans une rue repose sur ce que font les
anthropologues. On a un exemple magnifique avec l’histoire de
cet homme – Malinowski – au fond mal dans sa peau, qui part
au bout du monde et regarde des êtres à moitié à poil, qui passe
sa vie à raconter leur vie. Il va vers l’autre pour régler un certain
nombre de problèmes mais finalement ne règle rien, et vous dites
« ça c’est notre position à tous ».
Oui, et cette mise en risque qu’offre l’altérité, on la partage tous. On
n’a pas besoin d’être anthropologue. Si demain on invite des membres
du public d’Hybrides à participer à une fête dans l’Aveyron, ils risquent
de se sentir pris dans le syndrome de Malinowski. C’est la mise en
risque de cette altérité qui fait qu’il y a des moments où on se sent
plus ou moins à sa place.
Je suis dans le même rapport avec l’autre mais je ne suis pas dans
le rapport avec l’autre.
C’est plus compliqué que ça. Malinowski est quand même entré en
rapport avec une véritable empathie, pas sans difficulté. Mais toute
relation a un prix, je pense, relation affective, amoureuse, de grande al-
térité comme celle que Malinowski a vécue. C’est un beau prix à payer.
Les extraits qu’on cite, au-delà du texte que Christophe a écrit et du
sampling du texte de ces auteurs qui ont observé ce lieu, l’Usine, sont
tirés non pas d’un des grands bouquins de Malinowski sur la sexualité,
sa répression ou sur tout ce qu’il a amené à l’époque et qui a un peu
bouleversé toutes les théories freudiennes en Europe, mais sont tiré de
son journal d’ethnographe, qui est en fait un carnet intime qui n’était
pas destiné à être publié et qui a été publié bien après sa mort. C’est là
qu’il évoque ses troubles, sa solitude, sa nostalgie, son envie d’amour,
sa mère… Malinowski était malade, il se shootait à l’arsenic pour te-
nir le coup, la chaleur l’écrasait ; c’est un bouquin vraiment très tou-
chant. Il parle aussi de sa profonde déprime, d’être si loin de chez lui
(il a été rapatrié, il est parti en Angleterre, aux Etats-Unis). C’est donc
quelqu’un qui allait profondément mal et le raconte dans son journal
intime. C’est la métaphore que Christophe a proposée qu’on mette en
scène, de dire que ces auteurs qui viennent dans ce lieu, l’Usine, sont
arrivés un peu comme Malinowski, un peu perdus, un peu loin de chez
eux, un peu en manque de repères et qu’ils ont un peu erré comme
Malinowski dans ce lieu en tournant en rond et en essayant de saisir
un peu l’altérité qui leur échappait le plus souvent. C’est ça qu’on a
choisi de montrer dans ce spectacle, mais leurs textes ne racontent
pas que ça. Leurs textes intégraux sont disponibles sur un site internet
de la boutique d’écriture de Toulouse. C’est une commande un peu
particulière, ce ne sont pas eux qui ont choisi d’aller là et d’écrire sur
ces gens-là. Ils ont beaucoup remis en question aussi bien le rapport
qu’ils ont eu avec les gens de là-bas que le fondement.
Au fond, dés le moment où on s’installe dans un espace, on vient
perturber les relations qui sont dans le lieu– ce serait ca le syn-
drome de Malinowski.
C’est le syndrome de Malinowski.
3
N'3 - mErcrEDI 31 mars 2010
EmprEINTE

sENsaTIONs DE spEcTaTEurs
« maDE IN paraDIsE »
Le paradis ne nous laisse pas indif-
férents. Le paradis nous appartient à
tous. « Made In Paradise » en est la
preuve, mais aussi la démonstration.
Cette voie nous ouvre des perspec-
tives insolites. Dans les faits, il faut
juste trois hommes pour nous pous-
ser à la réflexion, à la confrontation
avec nous même. Parce qu'il faut le
dire, pendant que la télévision nous
impose un choix entre « l'identité na-
tionale » et la rancoeur, une nouvelle
voie s'offre à nous : celle de la com-
préhension de l'autre. Et c'est sur ce
schéma que Yan Duyvendak et Omar
Ghayatt nous dessinent une nouvelle
pédagogie, et une nouvelle façon de
découvrir l'autre, l'étranger. On pour-
rait résumer cette performance en
quelques mots : compréhension, ami-
tié, conflit, concession. Mais ça reste-
rait trop léger. Cette compagnie nous
pousse dans nos moindres retranche-
ments. Pendant deux heures, nous
apprenons à assumer nos craintes, et
plus encore, à les dépasser.
L'autre est là, en face de nous. Il
existe. Il est différent, mais il nous
ressemble. Et nous devons assumer
ce paradoxe pour le dépasser. Il faut
l'avouer, c'est une expérience éprou-
vante, déstabilisante. Ces heures sont
presque épouvantables, tellement on
se sent nu. Et alors? On se sent telle-
ment mieux ensuite. Nous finissons
par le comprendre, ni la dictature, ni
le destin, ni même la démocratie, ne
jouent en notre faveur. C'est un choix
personnel, intime.
Avec « Made In Paradise », nous re-
trouvons le sens de l’âme. Car nous
avons le choix de notre direction. Ici,
personne ne décide à notre place.
Nous sommes les maîtres de notre
colère, de notre peur, de notre bon-
heur. Cette performance nous offre
une liberté entre quatre murs. Ici,
nous découvrons la poésie de nos
vies, la poésie de l'autre. Ici, nous
avons, vraiment, le choix d'aimer ou
non ; d'accepter ou de nous en aller.
Ici, nous avons le choix de participer,
ou non. Ici, nous avons, réellement,
le libre arbitre. Et c'est comme ça que
« Made In Paradise » nous montre
que le Paradis, c'est un choix.
omar-saBas Gally
Cela commence par une crainte. A
l’entrée même du lieu, une invitation
sympathique mais ferme : « Nous
vous convions à vous délester de vos
affaires personnelles, votre sac et
votre manteau. La compagnie pense
que vous serez plus à l’aise pour vous
déplacer » .
Se déplacer, se mouvoir dans l’es-
pace, ça veut dire, pas moyen d’être
tranquille, les fesses noyées dans un
bon fauteuil.
Inquiétude renforcée, lorsque cinq
minutes plus tard, alors que vous n’y
pensiez déjà plus, on vous demande
d’enlever vos chaussures. Pas moyen
d’y échapper. « Est-ce que mes chaus-
settes ne sont pas trop… ce matin j’ai
mis… ce matin… ce matin, c’est loin
ça ! » Regard rapide sur les autres
pieds et inspiration discrète mais
profonde « chaussettes pourries… ça
sent déjà mauvais, je peux enlever
mes chaussures ». Vous n’en êtes
pas complètement sûr mais vous sa-
vez que vous entrez dans une forme
contraignante pour vous.
Dès les premières minutes, on vous
explique les règles du jeu : le spec-
tacle est composé de onze fragments,
cinq seulement peuvent être présen-
tés. Vous devrez voter à main levée et
choisir ceux qui seront joués. Pas de
séparation marquée entre les aires de
jeu et le public. Comme annoncé, les
spectateurs doivent se déplacer. Petit
échauffement spatial où vous vous
mettez à suivre les acteurs sur leur
invitation. « Ça va, rien de trop com-
promettant et puis vous pouvez tou-
jours vous coller aux autres, comme
ça, aucun risque ». Suis-je à peine
habitué au flux et reflux de la masse
que les choses s’emballent. Par un jeu
habile, les acteurs arrivent à dérouter
le public. « C’est où que ça se passe ?
C’est qui, qui va jouer ? ».
Et là tout devient clair, vous sentez
bien que vous êtes au cœur d’une ex-
périmentation dont le sujet est : vous.
Vous, non pas individuellement, mais
vous, en interaction avec d’autres :
reconstruction d’une communauté,
celle formée par le public, avec ses
jeux sociaux, tel l’exercice d’une dé-
mocratie à laquelle chacun se prête
avec plus ou moins de conviction.
Expérimentation de la frustration
(ce n’est pas le fragment que je vou-
lais) ou du sentiment « de victoire »
qu’offre la majorité (ouf, je ne suis pas
tout seul !). Votre schizophrénie so-
ciale, entre autocensure et désir d’af-
firmer vos positions, entre singularité
et crainte d’être en marge du groupe,
trouve dans « Made in Paradise » sa
pleine expression. Au final, on peut se
demander si le sujet véritable de cette
proposition n’est pas une réflexion
globale sur notre comportement so-
cial et de notre conditionnement.
chrisTine Tachie
uNE auTrE vIsION
« maDE IN paraDIsE »
« Made in Paradise » est un petit bijou de fragments sur le thème du point
de vue de l’Autre ? Ici il s’agit d’Islam, mais ces trois-là, Yan Duyvendak,
Omar Ghayatt, Adnane Mouhejja, pourraient nous entretenir, à la ma-
nière des mille et une nuits, des soucoupes volantes, de la démocratie,
du moteur à explosion, ou de la course en sac, ce serait toujours magni-
fique. Ils sont tellement différents, contradictoires, mystérieux, humains
en quelque sorte. Ça se jouait à La Chapelle, en plein quartier gitan. Et,
sauf erreur, aucun gitan dans la salle, mais il est vrai que je n’ai pas fait
d’enquête ethnographique. Mais c’est un sujet, non ? Pourquoi aucun
gitan dans la salle ? Les gadjo que nous sommes ne les intéressent-ils
pas avec leurs questions sur le point de vue de l’Autre ? Ce soir-là, dans
La Chapelle, quelqu’un a suggéré (rappelé) que la religion, c’est l’opium
du peuple. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ?
« DOmINI públIc »
L’autre jour, Dimanche, le second jour du festival, je vais assister à
« Domini Públic », Place de la Comédie, devant l’Opéra. Un charmant
garçon me propose d’échanger un casque noir très design, moderne et
tout, contre une pièce d’identité. Je lui fais remarquer que depuis que
les situationnistes nous ont aidés à mettre quelques pensées les unes
derrière les autres, ce genre d’échange était un signe symbolique de la
société spectaculaire et marchande dans laquelle nous continuons de
baigner, et pour un certain temps. Il a bien ri, nous avons échangé à ce
moment-là quelques signes de connivence, mais j’ai donné ma vielle
carte d’identité toujours en cours de validité, après avoir payé ma place,
évidemment. D’autres participants ont échangé leur casque contre un
objet de valeur, une pipe, un accordéon, un bon pour un séjour de tha-
lassothérapie à la Grande-Motte, une horloge russe... Un autre échange,
payer sa place. Dans « Domini Públic », j’ai pu constater, grâce à la sa-
gacité de l’artiste qui nous proposait cet hymne à la vie urbaine et soli-
daire, que la moitié des participants, ce jour-là, n’avait pas payé ; je les
ai repérés à ce qu’ils devaient se séparer des autres, ceux qui payaient.
L’ouvreuse de « Domini » avait un sifflet, et tout le monde obéissait aux
demandes répercutées dans nos casques tellement seyants. Un court
instant, je me suis dit merde, ça me rappelle ce jeu issu d’une expérience
très sérieuse, au cours de laquelle on demandait à des types d’envoyer
des décharges électriques de plus en plus puissantes. Vous la connais-
sez, cette expérience, non, tous les types, sauf un, je crois, y allaient
de leurs décharges électriques, et ceux qui les recevaient, ou faisaient
semblant, étaient des comédiens qui jouaient la terreur, la douleur, plus
vraies que nature. Si les décharges avaient été réelles, ils seraient tous
morts. Rien que parce qu’un autre type, en blouse blanche, avec un dis-
cours « scientifique », le leur demandait. Non, on n’en était pas là avec
« Domini », non, bien sûr que non.
« lET ThE suNshINE IN »
Serions-nous entrés dans l’âge de l’amour, de l’humanité, de la lumière ?
C’est ce que nous laissait penser le titre « Let the Sunshine In (Anti-
gone) contest #1 » de la compagnie Motus. Probablement pas encore.
Antigone, Etéocle, Polynice, Créon, Hémon, Ismène ont fait ce qu’elles
et ils ont pu, ça n’a pas marché. Et depuis ces millénaires, on se traîne
avec sa solitude malgré la présence de l’Autre. Malgré ? Une question de
point de vue, justement. Pourtant, « Hair », comédie musicale rock, dont
est tirée la chanson « Let the Sunshine In » produit de la contre culture
hippie et de la révolution sexuelle des années 1960, a été jouée à par-
tir de 1968 pendant quatre ans sans interruption. 68, 68, 68, (encore),
ça me rappelle Léo Ferré qui poussait sa gueulante sur les poètes et
les anarchistes. Dans le spectacle de Motus, Silvia Calderoni et Benno
Steinegger nous apportent sur un plateau la violence et l’amour, am-
biance fumigène et hall désaffecté. Parmi les spectateurs, 20 hommes
et 60 femmes, c’est un fait. Faut-il rechercher absolument son double ?
Vouloir la réconciliation en dépit de tout ? S’habiller en combinaison de
mécanicien ou en sweat à capuche ? Crier ou se taire ? Se venger ? Il y a
aussi d’autres interrogations.
yves Flank
4

« makINg up »
Dans un cadre hors du commun, la galerie Saint Ravy accueille la projec-
tion du montage vidéo de Claire Engel. Il retrace le quotidien de Paula,
une femme battue. L'acte en lui-même n'est pas montré mais dévoilé
avec subtilité.
On entre dans un espace fermé, à triple ouverture donnant accès à dif-
férentes périodes de sa vie. Ces trois portes sur lesquelles sont proje-
tées les images illustrent les choix de sortie, de libération ou d'empri-
sonnement. Ainsi elles évoquent une échappatoire possible à tout ce
tourment. Le sujet et les techniques utilisées sont bouleversants et nous
laissent impuissants face à la déstructuration de l'image et du son.
L'attente et la patience de Paula sont représentées par le fredonnement
et le silence qui viennent illustrer ces images douces et frappantes à
la fois. La souffrance « non verbale » est en opposition totale avec le
rythme des voix, transmettant ainsi une certaine incompréhension du
déroulement de l'histoire. « Ne vous inquiétez pas, une fois que c'est
passé, on oublie...»
Son cauchemar inévitable, nous plonge dans ce combat perpétuel avec
elle-même : un souvenir du passé mêlé à l'impuissance du présent. Mais
pourquoi résiste-elle à cette atroce situation ? Peut-être par engagement
envers sa fille ? Ses amis ? Ces liens si précieux conduiraient-ils enfin à
une nouvelle porte, synonyme d'espoir et de renaissance ?
C'est ainsi que naît le traumatisme chez le spectateur. Celui-ci assiste à
une progression déroutante tout au long du film ; la protagoniste évo-
lue à travers ses attitudes : elle se maquille pour effacer les traces des
violences conjugales qu'elle subit, elle se redresse pour regagner la di-
gnité qu'elle a perdue et enfin ouvre la porte et s'en va à la recherche du
bonheur laissé de côté. Dans cette projection, Claire Engel alerte avec
beaucoup de sensibilité sur ce sujet encore tabou, qui n'est pas sans
rappeler que l'impossible n'est pas inévitable.
yazGi Giray, sylvia leBrun, marjolaine jourdan,
sarah leFèvre, sandrine BarBiero
« DOmINI públIc »
Ce qui rend cette œuvre originale, c'est
son approche, différente des spec-
tacles habituels. Il n'y a ni comédiens,
ni scène, pour nous spectateurs qui de-
venons les artistes du spectacle. Grâce
à des casques, on nous donne des
instructions : nous marchons dans un
espace semi-fixe, afin de nous mettre à
l'aise et de nous familiariser avec notre
propre personnage. Les questions po-
sées abordent de nombreux sujets. Au
fur et à mesure de notre avancée dans
le spectacle, les questions deviennent
plus personnelles, des groupes se font
et se défont au gré des interrogations...
Certains sont évidents, d'autres plus
inattendus, voire surprenants. C'est
une œuvre qui donne à réfléchir, diver-
tissante au début, pour ensuite nous
faire méditer sur nous-mêmes, notre
vie, nos rêves. Comme si, le temps d'un
spectacle, nous devenions les acteurs
de notre propre vie, la regardant d'un
œil extérieur. Ce spectacle nous ins-
truit sur nous-mêmes ainsi que sur les
autres, et nous invite à nous remémo-
rer les instants importants de notre vie :
de l'enfance à l'instant présent. Cette
œuvre a la capacité de faire sortir ou
ressortir des sentiments, des émotions
cachées, ou ce que l'on croyait oubliés.
C'est une leçon sur notre propre vie.
maeva GuimBi-nGoT
« NOcTurNEs pOur lE
rOI DE rOmE »
L'originalité de cette œuvre repose
sur le mode de sa réalisation : elle a
été tournée par la caméra d'un té-
léphone portable. L'atmosphère du
film est déstabilisante avec un jeu
perpétuel entre l'image et la musique.
La forme de l'image donne le rythme
à la musique : plus la première sera
dure, plus la seconde sera cadencée,
forte et intense. Le monologue nous
donne une direction, et révèle peu à
peu l'esprit du film, à mesure que les
images et la musique donnent libre
cours à notre imagination. Le film met
en scène un vieux compositeur alle-
mand, qui se remémore les moments
importants de sa vie.
Cette incertitude visuelle, liée au té-
léphone portable, donne une autre
vision aux spectateurs : nous ne
nous contentons pas seulement de
regarder l'image, nous cherchons à
comprendre le message du narra-
teur ; l'image se charge d'une grande
intensité. Le compositeur parle de sa
femme morte, et nous montre son
portrait, pendant les trois quart du
film – comme s'il cherchait à graver
son visage à jamais dans son esprit,
comme s'il cherchait à nous dire :
« Elle a existé ». Alternent images du
présent et images du passé, douces
ou violentes, dures ou amusantes.
Il nous décrit sa vie traversée par la
guerre comme un mélange de ten-
dresse et de violence, de calme et
de panique. La musique de grands
compositeurs renforce toute l'émo-
tion du film, soulignant l'intensité des
images : du classique pour la simplici-
té et l'amour, du rock pour les événe-
ments inattendus et tragiques. Dans
le monologue, la voix du compositeur
est paradoxale : constante, grave, à la
limite de l'apaisement ; néanmoins
nous ressentons toute l'émotion, le
vécu, la force et la faiblesse de celui-
ci. Dans les dernières minutes du film,
le narrateur fait ses adieux au monde ;
il dit au revoir à ses fantômes et au
non-sens de son existence, mais c'est
un pas vers une nouvelle éternité de
sérénité où il retrouvera sa femme.
Ce film est la déclaration d'amour d'un
compositeur à son épouse, son plus
grand chef d'œuvre, il nous montre
que la vie et l'amour sont la même
chose : quand il n'y a pas d'amour, il
n'y a pas de vie.
maeva GuimBi-nGoT
En sortant de cette projection, notre
premier ressenti se porta sur la qualité
de la vidéo. Il est vrai qu’avec la camé-
ra microscopique d’un téléphone por-
table, les images étaient particulière-
ment floues. Cependant, les défauts
de l’image sur grand écran avaient un
rôle central dans le film. Ils apparais-
saient inhérents aux souvenirs du nar-
rateur, des rêves de son passé. Ainsi,
les spectateurs pouvaient laisser libre
cours à leur imagination. C’est dans le
flou de l’image que l’on se fait notre
propre interprétation des scènes.
L’enchaînement de celles-ci se fait au
rythme de la musique plus ou moins
forte selon l’intensité de l’émotion
du narrateur. Une émotion que nous
ressentons à travers sa voix. Nos
sentiments se mêlent tout au long
du film, on ressent tout d’abord de la
pitié pour cet homme seul, hanté par
le fantôme de sa femme et les sou-
venirs de la guerre. On s’attache à lui
et on compatit à sa délivrance finale.
On peut quand même noter la durée
parfois excessive de certaines scènes,
notamment la scène de la « grande
réception » ; l’image se fixe et l’on se
perd dans notre propre interprétation.
Cette nouvelle technique nous a per-
mis d’enrichir notre culture cinémato-
graphique.
Tracy rodriGo,
elodie massador,
camille lopes,
maeva GuimBi-nGoT
Let The Sunshine In
5
N'3 - mErcrEDI 31 mars 2010
EmprEINTE
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%