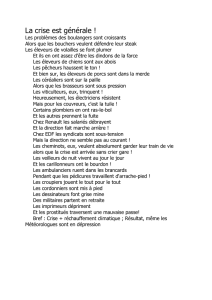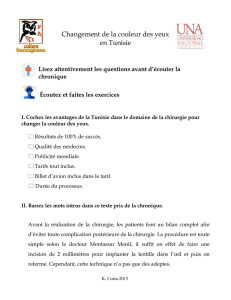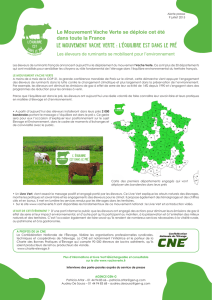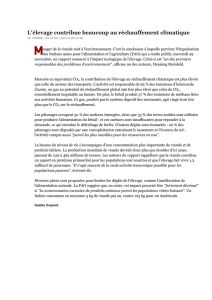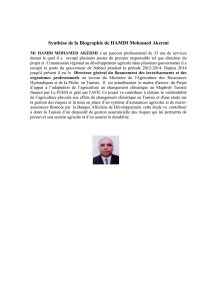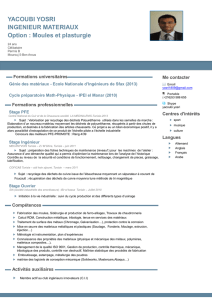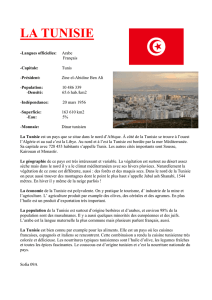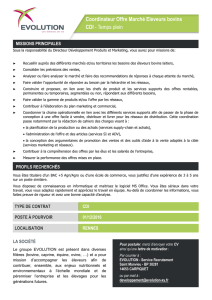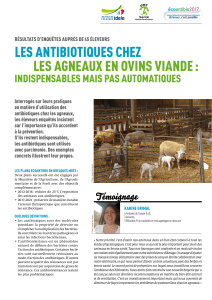Fiche-Petits ruminants-S. Bouzid

Programme de Gestion des Ressources Naturelles dans les Territoires Ruraux
Vulnérables de Tunisie
1
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la
Pêche de Tunisie
DGACTA
Formulation du Programme de Gestion des Ressources Naturelles dans les
Territoires Ruraux Vulnérables de Tunisie
Document de travail : fiche filière petits ruminants
EL LAYOUN (CEBBALET OULED ASKAR, SIDI BOUZID)
Décembre 2015

Programme de Gestion des Ressources Naturelles dans les Territoires Ruraux
Vulnérables de Tunisie
2
Ce texte constitue un des documents de travail produit dans le cadre de la faisabilité du
programme de gestion des ressources naturelles dans les territoires ruraux vulnérables de
Tunisie. Il retrace brièvement les éléments issus d’un diagnostic amorcé sur le terrain lors
de la faisabilité, puis consolidé à travers l’exploitation de la bibliographie disponible. Il
s’agira dans le cadre de la mise en œuvre du futur programme GRN-territoires vulnérables,
en particulier à travers son résultat 4, de procéder avec les groupes d’intérêts locaux
concernés à une véritable faisabilité de projets structurants et viables de valorisation des
ressources naturelles au profit des populations du territoire. Cette faisabilité conjointe
devra déboucher sur la mise en œuvre et la concrétisation des projets pertinents de
développement économique des ressources naturelles des territoires et de leurs filières.
1. IMPORTANCE DU POTENTIEL DE PRODUCTION DANS LA ZONE
CONSIDEREE
La zone d’El Ayoun compte 525 éleveurs de petits ruminants dont la majorité
(81%) des éleveurs naisseurs d’ovins et 15% des éleveurs naisseurs de caprins.
Les engraisseurs ne représentent que 4 % des éleveurs. En termes d’effectif, le
secteur compte plus de 5600 têtes dont 85% de race ovine. Ce cheptel prélève
l’essentiel de son alimentation des parcours naturels et de la forêt faisant partie
du domaine de l’Etat.
La superficie totale des forêts, des parcours naturels forestiers et des parcours
collectifs de la zone est estimée à 8500 ha. Le potentiel en UF varie de 150 UF/ha en
années de faible pluviométrie à 250 UF/ha en années pluvieuses. Les disponibilités
fourragères globales en année moyenne peuvent atteindre 1,7 M UF. Les besoins des
animaux en UF ont été estimés à 2,8 Million d’UF sur la base d’une consommation
moyenne annuelle de 500 UF/Tête/an. Les ressources alimentaires locales ne couvrent
que 60 % des besoins du cheptel. Le déficit fourrager est comblé par l’orge, le son de blé,
les aliments concentrés, la paille et le foin amenés des régions du Nord.
La production annuelle de viande rouge est estimée sur la base d’un agneau de 25 kg
poids carcasse par brebis à environ 140 tonnes de viande rouge.
2. LA DEMANDE DU MARCHE LOCAL, NATIONAL ET
INTERNATIONAL
La production des viandes rouges en Tunisie est estimée à 123 000 tonnes en 2014. La
part de la viande ovine est de 48 mille tonnes alors que la production de viande caprine
est estimée à 10 million de tonnes. Les importations de viande rouge sont dépendantes
des conditions climatiques et ne représentent qu’une proportion infime (environ 8%) de
la production nationale. Les viandes ovines importées ne représentent que 26% des
importations de viandes rouges. L’importation d’ovin sur pied est très récente et est

Programme de Gestion des Ressources Naturelles dans les Territoires Ruraux
Vulnérables de Tunisie
3
destinée à régulariser les prix pendant les périodes de l’Aïd. Le Tunisien consomme en
moyenne 9,5Kg/an de viande ovine et caprine.
L’autosuffisance de la Tunisie en viande de petits ruminants est précaire et tout effort
d’accroitre la productivité et de développement de la filière permettrait de garantir au
moins l’autosuffisance et pourquoi pas l’exportation des produits de qualité avec des
labels bio ou IP. Les marchés Libyen et Algérien constitueront des destinations
potentielles.
3. L’ORGANISATION ACTUELLE DE LA FILIERE
Le système d’élevage est du type extensif, où le pâturage des forêts et des parcours
naturels assure 60% des besoins en UF des animaux. L’élevage d’ovin/caprin est une
activité assez généralisée au sein de troupeaux familiaux de 10 à 30 brebis (avec des
extrêmes de 5 à 50 têtes).
Pratiquement le tiers des éleveurs appuie l’alimentation par la distribution du cactus qui
est comptabilisé plus haut dans les apports des parcours.
Les stratégies de lutte contre la sécheresse peuvent être différentes d'un éleveur à
l'autre. La plus importante actuellement est l’apport fourrager. Une deuxième stratégie,
utilisée par la moitié des éleveurs, est la diminution du nombre de têtes, allant de la
vente rapide des jeunes agneaux et chevreaux jusqu'à la vente des reproductrices et la
réduction globale de la taille du troupeau. Cette stratégie répond mieux à l’absence de
production fourragère locale et à la sensibilité du parcours à la sécheresse.
4. LA CHAINE DE VALEUR EXISTANTE
La marge brute dégagée par brebis est de l’ordre de 65 DT. Toutefois l’engraissement de
l’agneau issu de cet élevage permet de générer environ 104 DT. Il serait plus intéressant
pour l’éleveur–naisseur de garder les agneaux trois à quatre mois additionnel pour
profiter de l’accroissement de valeur.
Le manque de moyens financiers est l’une des causes de la vente précoce des agneaux.
L’organisation de la profession et l’adhésion à des SMSA pourraient permettre
d’apporter les solutions au problème de financement des ateliers d’engraissement dans
la zone de production.

Programme de Gestion des Ressources Naturelles dans les Territoires Ruraux
Vulnérables de Tunisie
4
Fiches technico-économiques moyennes d’une brebis et d’un agneau
Recettes et charges
proportionnelles
Unité
Prix
unitaire
en D
Brebis
Agneau
Quantité
Valeur
en D
Quantité
Valeur
en D
1. Recettes (Valeur de la production)
Dinar
351,2
510
- Viande (agneau 5 à 6 / 9 à 10 mois)
Kg
12//11
25
300
45
495
- Brebis de réforme
Tête
200
0,2
40
0
0
- Laine
Kg
2
2
4
0
0
- Fumier
Tonne
60
0,12
7,2
0,25
15
2. Charges proportionnelles
285,5
406,05
2.1 Alimentation
155,5
68,55
- Son
Tonne
250
0,09
22,5
0,016
4
- Orge grain
Tonne
450
0,1
45
0,019
8,55
- Foin
Balles
8
11
88
7
56
- Pâturage et déchet des cultures
UF
0
260
0
0
0
2.2 Autres charges
70
307,5
- Renouvellement cheptel/Achat maigres
Tête
300//12
0,2
60
25
300
- Vaccination
Tête
5
1
5
1
5
- Eau
Tête
5
1
5
1
2,5
2.3 Main-d'œuvre
60
30
- Main d'œuvre (Berger)
Tête
60//30
1
60
1
30
3. Marge brute / brebis / agneau
Dinar
65,7
103,95

Programme de Gestion des Ressources Naturelles dans les Territoires Ruraux
Vulnérables de Tunisie
5
5. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DES EXPERIENCES
D’AMELIORATION DE LA FILIERE
La durabilité de ce système d’élevage est soumise à des menaces importantes,
notamment celles qui découlent de la dégradation des ressources du fait de la restriction
des espaces de parcours, de la réduction de la mobilité du cheptel et de sa dépendance
de plus en plus forte des ressources extérieures. Dans le contexte d’un renchérissement
des aliments de bétail, la durabilité de ce système est de nouveau remise en cause. Le
risque est, de fait, plus grand si la fréquence de la succession des années sèches
augmente. Cette situation de pression sur les ressources risque de s’aggraver suite à
l’absence d’organisation des producteurs qui peut prendre en charge la régulation de
l’accès aux ressources, notamment les ressources collectives ou celles du domaine de l’Etat.
Enfin sur le plan économique, l’envolée des cours des matières premières sur le marché
international et la stagnation du prix de la viande au niveau de la production peuvent
aussi contribuer à la remise en cause de la durabilité de ces systèmes.
Malgré les efforts déployés par l’OEP et le CRDA en matière d’encadrement et de
sensibilisation, la conduite des effectifs en surnombre reste traditionnelle. Ainsi
l’introduction des béliers et des boucs à haut indexe génétique n’était pas facile en
raison de la réceptivité partielle des éleveurs qui ont eu toujours l’habitude de choisir les
béliers à partir de leurs propres produits. Les maladies parasitaires qui devraient être à
la charge de l’éleveur ne sont traitées qu’en cas d’attaques sévères.
La création de réserves fourragères sur pied à base de cactus s’est avérée très bénéfique
en années de disette. Toutefois, le pacage direct au lieu de la coupe des raquettes risque
de faire diminuer cette ressource et l’apport fourrager des bandes herbacées des
interlignes.
6. DISCUSSION SUR LES PERSPECTIVES ET LA STRATEGIE A
DEVELOPPER PAR LE PROJET SUR LA FILIERE
L’apport du programme pour soutenir cette activité vise un double objectif à savoir
améliorer la productivité de l’élevage et alléger la pression sur les ressources naturelles.
Il s’agit de mettre en œuvre les actions suivantes:
i) Approfondir l’analyse de la filière et élaboration d’un plan d’action
ii) Mettre en œuvre, un programme de formation et sensibiliser les éleveurs à
l’organisation professionnelle.
Appui au maillon production.
iii) Mettre en place un service d’accompagnement des éleveurs, en conseil technique et
de gestion,
iv) Améliorer le taux de productivité de l’élevage et
v) Promouvoir la valorisation des produits et sous-produits disponibles localement en
aliments de bétail.
 6
6
1
/
6
100%