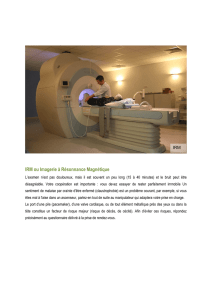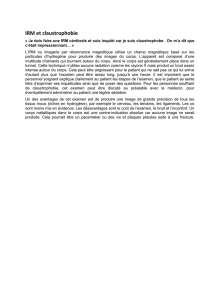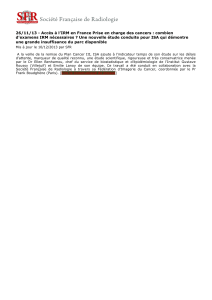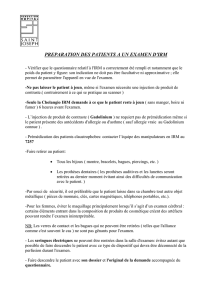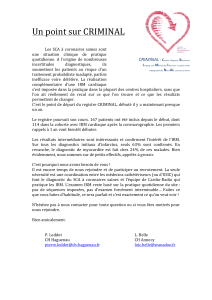Imagerie des pachyméningites intra-crâniennes : Etude d`une série

Imagerie des
pachyméningites intra-crâniennes :
Etude d’une série de 10 cas
1
N. Ech-Cherif El Kettani (1), M. Fikri (1), W. Regragui (2), Y. Arkha (3), N. Chakir (1),
MR. El Hassani (1), A. El Khamlichi (3), M. Yahyaoui (2), M. Jiddane (1).
(1) Service de Neuroradiologie. (2) Service de Neurologie B. (3) Service de Neurochirurgie.
Hôpital des Spécialités. CHU Ibn Sina. Rabat. Maroc.

Introduction :
•Les pachyméningites intra-crâniennes correspondent
à un épaississement inflammatoire chronique de la
dure-mère.
•Elles sont relativement rares, et peuvent être
secondaires ou idiopathiques.
•Elles sont bien explorées par l’imagerie en coupe
(IRM +++).
2

Matériel et méthode :
•Série de 10 patients colligés sur une période de 2 ans.
•Tous nos patients ont bénéficié d’une TDM en acquisition
hélicoïdale :
–coupes fines avant et après injection de produit de contraste,
–reconstructions coronales et sagittales,
–
lt fêt h t t
–
l
ec
t
ure en
f
en
êt
res parenc
h
yma
t
euses e
t
osseuses.
•Une IRM encéphalique a été systématiquement réalisée :
–3 plans de l’espace,
–SpT1, SpT2, FLAIR, diffusion et SpT1 après injection de produit
de contraste paramagnétique.
–un complément d’IRM médullaire a été réalisé dans 2 cas.
3

Résultats :
•Tous nos malades étaient de sexe féminin, avec un âge moyen de 40
ans.
•L’imagerie en coupe a retrouvé un épaississement méningé localisé
et asymétrique (n=6) ou diffus (n=4), qui se réhaussait de façon
importante après injection de produit de contraste.
•Des lésions intra-parenchymateuses associées (n=5) et/ou clinico-
bi l i ( 6) ét i t t é i i l’ i t ti
bi
o
l
og
i
ques
(
n=
6)
ét
a
i
en
t
re
t
rouv
é
es, ce qu
i
a perm
i
s
l’
or
i
en
t
a
ti
on
étiologique.
•La confirmation diagnostique était comme suit : sarcoïdose (n=3),
maladie de Behçet (n=1), maladie de Horton (n=1), tuberculose
(n=1), hypotension intra-crânienne chronique (n= 1) et
carcinomatose leptoméningée (n=1).
•Les autres cas se sont révélés être idiopathiques (n=2).
•Une extension intra-canalaire a été enregistrée dans 2 cas.
4

Mme N, 55 ans, antécédents de tuberculose pulmonaire traitée, hémoptysie il y a un mois avec signes
d’imprégnation tuberculeuse, actuellement HTIC fébrile.
Bilan biologique : IDR tuberculine positive, étude des crachats : bacille de Koch.
Diagnostic : tuberculose.
TDM encéphalique C- (coupe axiale : a)
et C+ (coupes axiales et coronales : b,c,d) :
épaississement méningé basi-temporal et fronto-
insulaire bilatéral, des loges caverneuses et de la
faux du cerveau, avec foyer d’encéphalite frontale
droite.
5
a
bcd
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
1
/
31
100%